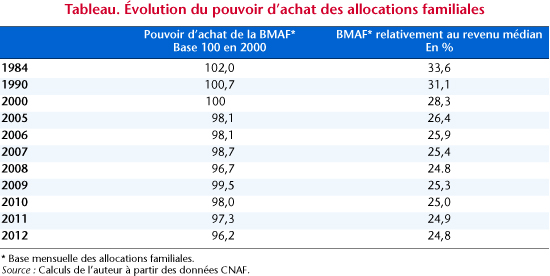RSA : un non-recours de 35% ?
Par Guillaume Allègre, @g_allegre
Le non-recours au RSA est souvent invoqué pour justifier une réforme du système d’aide aux personnes à bas revenus (Revenu universel, mise en place d’une allocation sociale unique qui fusionnerait RSA, Prime d’activité et Allocation logement). Selon la CNAF, le non-recours au RSA-socle serait de 36%. (CNAF, 2012). Pour faire cette estimation, la CNAF s’appuie sur une enquête quantitative, réalisée au téléphone auprès de 15 000 foyers sélectionnés à partir de leurs déclarations fiscales. L’enquête quantitative sur le RSA a été spécifiquement conçue pour reproduire un test d’éligibilité à cette prestation. Pourtant, certains foyers non éligibles au RSA déclarent en bénéficier. Cette catégorie représente 524 foyers dans l’enquête, soit 11% des bénéficiaires. Elle peut résulter d’une erreur de déclaration au moment de l’enquête, ou d’une approximation du test d’éligibilité de l’enquête. En tout état de cause, l’existence de cette catégorie montre qu’il est difficile d’estimer un non-recours à l’aide d’une enquête, même spécifique. Par ailleurs, le Secours catholique estime à 40% le non-recours au RSA-socle (sur l’ensemble des ménages rencontrés en 2016 par l’association)[1].
Il existe un autre moyen d’estimer le non-recours au RSA. Depuis peu, l’INSEE et la DREES ont mis en accès libre le logiciel de micro-simulation INES. INES permet de simuler la législation socio-fiscale en s’appuyant sur l’ERFS (Enquête sur les revenus fiscaux et sociaux). L’ERFS a pour source les déclarations fiscales ; l’enquête – issue de données administratives – est donc très exhaustive (les ménages sont tenus de déclarer leurs revenus tous les ans). L’ERFS a cependant des limites, elle ne concerne que les ménages dits ordinaires. Sont exclues les personnes qui n’ont pas de logement (sans-abris) et les personnes qui habitent dans des institutions (armée, maisons de retraite[2], …). Le champ est celui de la France métropolitaine. Les déclarations de revenus sont annuelles, or la base ressource du RSA sont les revenus trimestriels, ce qui implique, pour simuler le RSA, de « trimestrialiser » les revenus sur la base d’hypothèses ad hoc.
Selon la simulation faite sur INES (législation 2015), le nombre d’éligibles au RSA-socle au quatrième trimestre 2015 devrait être d’environ 2 000 000 de foyers, alors que le nombre réels de bénéficiaires du RSA-socle selon la CNAF en décembre 2015 était de 1 720 000[3]. Selon l’enquête ERFS (et la microsimulation), le non-recours au RSA socle serait donc de 14%[4].
Le non-recours au RSA-socle est-il de 14% ou de 36% ? La vérité se situe très certainement entre les deux mais à quel niveau ? Le non-recours aux allocations-logement est estimée à 5% (Simon, 2000). Or les deux prestations (RSA, allocations logement) ont des publics proches. Le non-recours au RSA est certainement plus élevé que celui aux allocations logement (la population cible est plus pauvre, les démarches administratives sont plus importantes pour le RSA). Par contre, l’écart entre 5% (non-recours estimé aux allocations-logement) et 36% (non-recours estimé par la CNAF au RSA) est difficilement explicable.
Pour citer ce billet : Guillaume Allègre (2018), « RSA : un non-recours à 35% ? », OFCE Le Blog, janvier.
[1] Source : rapport 2017 du Secours catholique : https://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/rs17_0.pdf
[2] Mais ceci n’est pas important pour le RSA car les personnes de plus de 65 ans sont éligibles à un autre minimum social, l’ASPA.
[3] RSA socle + RSA socle et RSA activité, France métropolitaine. CAF+MSA Sources : http://data.caf.fr/dataset/foyers-allocataires-percevant-le-revenu-de-solidarite-active-rsa-par-caf
[4] Ce résultat varie de quelques pourcentages selon les années, ce qui montre que le modèle est – comme tout modèle – imprécis. L’équipe INES (INSEE-DREES) considère que l’on ne peut pas utiliser le modèle pour mesurer le non-recours notamment parce que l’ERFS capte mal les très bas revenus (le non-recours estimé avec INES sous-estimerait alors le non-recours réel). Historiquement, l’ERFS n’est pas jugée très bonne pour estimer l’éligibilité au RSA socle. Il est vrai que les bénéficiaires du RSA n’étant par construction pas imposable, ils ne risquent pas de pénalité en cas de mauvaise déclaration. Ce problème a été (en partie) résolu avec la déclaration pré-remplie.