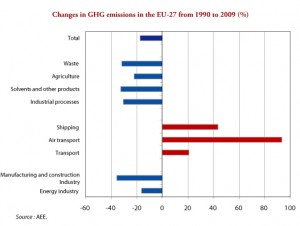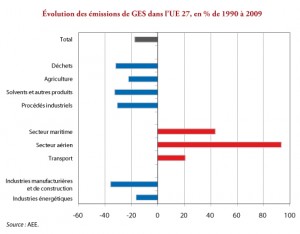Négocions un signal-prix mondial du carbone, et vite !
par Stéphane Dion [1] et Éloi Laurent
Vingt ans après la Conférence de Rio, et alors qu’une nouvelle conférence sur le climat s’ouvre à Bonn lundi 14 mai 2012, un constat d’échec s’impose sur le front de la lutte contre les changements climatiques induits par l’activité humaine. Nous ne pourrons pas échapper à un grave dérèglement du climat si nous continuons de la sorte. Il nous faut changer de direction, et vite.
L’Agence internationale de l’Énergie prévoit un réchauffement de plus de 3.5° C à la fin du 21e siècle si tous les pays respectent leurs engagements, et de plus de 6° C s’ils se limitent à leurs politiques actuelles. À ce niveau de réchauffement, la science du climat nous prévient que notre planète deviendra bien moins hospitalière pour les humains et moins propice à toutes les formes de vie.
À la Conférence de Durban de décembre 2011, les pays ont exprimé leur vive inquiétude quant à l’écart entre leurs propres engagements et l’atteinte de l’objectif de limiter le réchauffement en-deçà de 2° C (par rapport à l’ère pré-industrielle). Ils ont promis de redoubler d’effort en vue d’abolir cet écart. Pourtant, ils ne se sont pas engagés à atteindre des cibles plus contraignantes. Nous faisons dès lors face à une distance de plus en plus insoutenable entre l’urgence de l’action et l’inertie des négociations mondiales.
Les pays développés refusent de renforcer leurs politiques climatiques tant que les autres grands émetteurs n’en feront pas autant. Mais les pays émergents, en particulier la Chine et l’Inde, avec des taux de croissance annuelle de leur produit intérieur brut de 8 à 10 %, n’accepteront pas, dans un avenir prévisible, de cibles de réduction en volume de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ces pays pourraient en revanche être plus ouverts à l’idée de prélever un prix sur la tonne de CO2, harmonisé au plan mondial, dont le revenu leur appartiendrait, et auquel leurs compétiteurs économiques seraient eux aussi astreints.
Selon nous, le meilleur instrument de coordination internationale qu’il faille établir pour lutter contre les changements climatiques est ce signal-prix mondial du carbone. C’est pourquoi nous proposons de concentrer les négociations à venir sur cet objectif essentiel.
Voici ce que nous proposons (voir le détail, en version française http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/dtravail/WP2012-15.pdf et anglaise) : chaque pays s’engagerait à instaurer, sur son territoire, un prix du carbone aligné sur une norme internationale validée par la science, en vue d’atteindre, ou du moins, de nous rapprocher le plus possible, de l’objectif de plafonnement du réchauffement planétaire à 2° C. Chaque pays choisirait de prélever ce prix par la fiscalité ou par un système de plafonnement et d’échange de permis d’émissions (un « marché du carbone »).
Les gouvernements seraient libres d’investir à leur gré les revenus issus du paiement du prix pour les rejets de carbone et de l’abolition correspondante des subventions aux énergies fossiles. Ils pourraient, par exemple, investir dans la recherche-développement en matière d’énergies propres, dans les transports en commun, etc. Ils pourraient aussi choisir de corriger les inégalités sociales dans l’accès à l’énergie.
Les pays développés auraient l’obligation de réserver une partie de leurs revenus pour aider les pays en voie de développement à instaurer des politiques d’atténuation, d’adaptation et de création de puits de carbone (reforestation, par exemple). L’apport respectif de chaque pays développé serait proportionnel à ce que représentent ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à l’ensemble des émissions de tous les pays développés.
En vertu de cet accord international, les pays auraient le droit de taxer, aux frontières, les produits en provenance d’un pays qui n’aurait pas établi un prix du carbone conforme à la norme internationale. Le message serait clair pour tous les grands émetteurs : si vous ne prélevez pas un prix carbone sur vos produits avant de les exporter, les autres pays le feront à votre place, et ce sont eux qui en tireront des revenus. Chaque pays verrait ainsi que son intérêt commercial est de se conformer à l’accord international, à tarifer ses propres émissions et à utiliser comme il l’entend les revenus qu’il en tirerait.
Ainsi, le monde serait doté à temps d’un instrument essentiel à son développement soutenable. Les émetteurs de carbone seraient enfin obligés d’assumer le coût environnemental de leurs actions. Les consommateurs et les producteurs seraient incités à choisir les biens et les services à plus faible teneur en carbone et à investir dans de nouvelles technologies qui réduisent leur consommation d’énergie et leurs émissions polluantes.
Nous devons négocier ce signal-prix mondial du carbone, et vite. Quel meilleur endroit pour engager cette démarche qu’à Rio, là-même où le problème du changement climatique a été reconnu par la communauté internationale voilà 20 ans ?
[1] Stéphane Dion est député à la Chambre des Communes du Canada ; ancien ministre de l’Environnement du Canada, il a présidé la 11e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, tenue à Montréal en 2005 (COP 11).