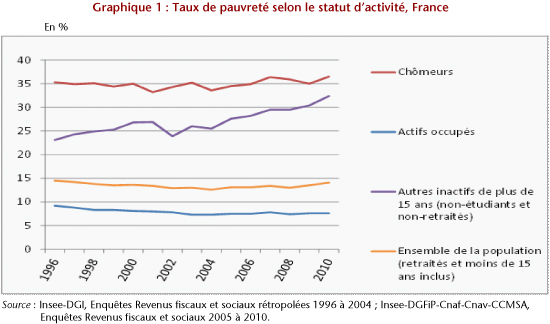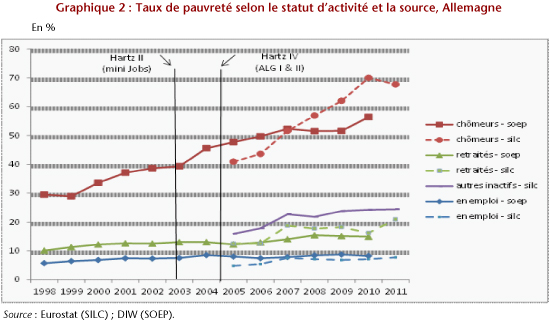par Guillaume Allègre et Hélène Périvier
Dans le cadre d’un réexamen des dispositifs d’aide aux familles, dont les motivations sont discutables par ailleurs, le gouvernement a annoncé vouloir réduire en 2014 le plafonnement du bénéfice du quotient familial dans le calcul de l’impôt sur le revenu (IR). L’avantage fiscal lié à la présence d’enfants à charge dans le foyer sera réduit de 2 000 à 1 500 euros par demi-part. La réflexion ouverte sur le quotient familial aurait dû être l’occasion de repenser plus globalement la prise en compte de la famille dans le calcul de l’impôt sur le revenu et notamment l’imposition des couples.
Comment les couples sont-ils imposés aujourd’hui ?
En France, l’imposition conjointe est obligatoire pour les couples mariés ou pacsés (et leurs enfants à charge) qui ne forment ainsi qu’un seul et même foyer fiscal. On suppose que les membres d’un même foyer mettent intégralement en commun leurs ressources, peu importe qui apporte ces ressources. En attribuant deux parts fiscales à ces couples, on applique la progressivité du barème à la moyenne des revenus du couple [(R1 +R2) /2]. Lorsque les deux conjoints gagnent des revenus proches, le quotient conjugal ne procure pas d’avantage particulier. En revanche, dès lors que les deux revenus sont inégaux, l’imposition conjointe apporte un avantage fiscal par rapport à l’imposition séparée.
Dans certaines configurations, l’imposition séparée est plus avantageuse que l’imposition conjointe, ceci est dû notamment au fonctionnement particulier de la prime pour l’emploi et de la décote[1], ou encore au fait que l’imposition séparée permet d’optimiser l’affectation des enfants entre les deux foyers fiscaux, ce que ne permet pas l’imposition conjointe par construction. L’optimisation fiscale est complexe car peu lisible pour le contribuable lambda. Quoiqu’il en soit, dans la grande majorité des cas, le mariage (ou le pacs) procure un avantage fiscal : 60 % des couples mariés ou pacsés payent moins d’impôts que s’ils étaient imposés séparément, avec un gain annuel moyen de 1 840 euros, tandis que 21 % bénéficieraient d’une imposition séparée qui leur ferait gagner 370 euros en moyenne (Eidelman, 2013).
Pourquoi accorder cet avantage aux seuls mariés ou pascés ?
Le quotient conjugal repose sur le principe de mise en commun totale des ressources dans le couple. Le contrat privé passé entre deux personnes via le mariage ou encore le pacs constituerait une « garantie » de cette mise en commun. En outre, le contrat de mariage est assorti d’une obligation alimentaire entre époux, ce qui les lie au-delà du mariage à mettre en commun une partie de leurs ressources. Toutefois, le Code civil n’associe pas « mariage » et « mise en commun intégrale » des ressources entre conjoints. L’article 214 du Code civil prévoit que les époux contribuent aux charges du mariage « à proportion de leurs facultés respectives », ce qui revient à reconnaître que les facultés contributives des époux peuvent être inégales. Depuis 1985, l’article 223 pose le principe de libre jouissance des revenus professionnels, ce qui renforce l’idée que le mariage n’implique pas que les conjoints partagent le même niveau de vie : « chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage ». L’autonomie professionnelle des conjoints et le droit de disposer de ses gains et salaires sont pleinement reconnus dans le Code civil, alors le Code fiscal reste cantonné à une vision globale des ressources et des dépenses du couple.
Par ailleurs, il existe une dissonance dans le traitement social et fiscal des couples. Le montant du RSA versé à un couple est le même qu’il soit marié, pascé ou en union libre. S’agissant du RSA majoré versé aux mères isolées ayant un enfant, l’isolement s’entend comme la vie sans conjoint y compris en union libre. L’union libre est donc reconnue comme une situation de mise en commun des ressources par le système social mais pas par le système fiscal.
Les couples mettent-ils effectivement en commun leurs ressources ?
Les études empiriques montrent que si les couples mariés ont tendance à pratiquer davantage la mise en commun totale des revenus que ceux vivant en union libre, ce n’est pas le cas de tous : en 2010, 74 % des couples mariés déclaraient mettre totalement en commun leurs ressources, mais seulement 30 % des couples pacsés contre 37 % des couples en union libre. La pratique dépend beaucoup de ce qu’il y a à partager : si 72 % des couples du premier quartile de revenu déclarent mettre en commun intégralement leurs ressources, ce n’est le cas que de 58 % des couples du dernier quartile (Ponthieux, 2012). Plus les ressources sont élevées moins les membres du couple mettent en commun leurs ressources. La mise en commun totale n’est donc pas aussi répandue que supposée : les conjoints ne partagent pas nécessairement exactement le même niveau de vie.
Capacité contributive et nombre de parts accordées
Le système fiscal reconnaît une mise en commun des ressources chez les couples mariés ou pascés, et leur attribue deux parts fiscales. L’attribution de ces parts fiscales repose sur le principe de capacité contributive dont on doit tenir compte pour être conforme au principe d’égalité devant l’impôt : autrement dit, on cherche à imposer le niveau de vie plus que le revenu en tant que tel. A revenu identique, une personne vivant seule a un niveau de vie plus élevé qu’un couple, mais du fait des avantages liés à la vie en couple, il n’est pas deux fois plus élevé. Pour comparer les niveaux de vie de ménages de tailles différentes, des échelles d’équivalence ont été estimées (Hourriez et Olier, 1997). L’INSEE attribue 1,5 part (ou unité de consommation) aux couples et 1 part aux célibataires : selon cette échelle, un couple ayant 3 000 euros de revenu disponible a ainsi le même niveau de vie qu’un célibataire dont le revenu s’élève à 2 000 euros. Or le quotient conjugal attribue 2 parts aux couples mariés quand il en donne une seule au célibataire. On sous-estime donc de 33 % le niveau de vie des couples relativement aux personnes vivant seules, et donc on ne les impose pas à hauteur de leur capacité contributive réelle.
En outre, on note encore une fois une incohérence entre le traitement des couples par les politiques sociale et fiscale : les minima sociaux tiennent compte des économies d’échelle liées à la vie en couple conformément aux échelles d’équivalence. Le RSA-socle perçu par un couple (725€) est 1,5 fois plus élevé que celui perçu par un célibataire (483€). Il y a une asymétrie dans le traitement des conjoints selon qu’ils font partie du haut de l’échelle des revenus et sont soumis à l’impôt sur le revenu, ou du bas de l’échelle des revenus et perçoivent des prestations sociales sous conditions de ressources.
Quelle norme familiale portée par le quotient conjugal ?
Le quotient conjugal a été pensé en 1945 en cohérence avec une certaine norme familiale, celle de Monsieur Gagnepain et Madame Aufoyer. Il contribuait aux côtés d’autres dispositifs à encourager cette forme d’organisation familiale, jugée comme celle souhaitable. Jusqu’en 1982, l’imposition reposait sur les seules épaules du chef de famille, à savoir l’homme ; la femme était perçue comme à la charge de l’homme. Or, loin de constituer une charge pour son conjoint, elle produit un service gratuit, via le travail domestique qu’elle fournit. Cette production domestique (garde et éducation des enfants, ménage, cuisine, …) a une valeur économique qui n’est ainsi pas imposée. Ainsi, les couples mono-actifs sont-ils les grands gagnants du système qui leur donne un avantage par rapport aux couples bi-actifs, qui doivent payer pour externaliser une partie des tâches domestiques et familiales.
En résumé, le système d’imposition conjointe actuel conduit à pénaliser les célibataires ou les couples en union libre par rapport aux couples mariés ou pascés, et à pénaliser les couples biactifs par rapport aux couples mono-actifs. Il est dans ses fondements défavorables à l’émancipation économique des femmes.
Que faire ?
La réalité des familles est aujourd’hui multiple (mariage, union libre, …) et mouvante (divorce, remariage, ou remise en couple, recomposition familiale), l’activité des femmes a changé profondément la donne en la matière. Si tous les couples ne mettent pas en commun leur ressources, certains le font, totalement ou partiellement, qu’ils soient en union libre ou mariés. Doit-on en tenir compte ? Si oui, comment en tenir compte face à cette multiplicité des formes d’union et leur mouvance ? Tel est le défi qu’il nous faut relever en réformant les principes et les normes familiales qui sous-tendent l’Etat social. En attendant, des modifications et rééquilibrages pourraient être réalisés.
Aujourd’hui, le bénéfice de l’imposition commune n’est pas plafonné par loi. Il peut s’élever à 19 000 euros par an (pour des revenus supérieurs à 300 000 euros, niveau de revenus qui atteignent la dernière tranche d’imposition) et même à presque 32 000 euros (pour des revenus supérieurs à 1 000 000 d’euros) si on inclut le bénéfice de l’imposition commune à la contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus. A titre de comparaison, on note que le montant maximal de la majoration du RSA pour un couple par rapport à une personne vivant seule est de 2 900 euros par an. Le plafond du quotient familial (QF), qui lui est explicite, est de 1 500 euros par demi-part. Un plafonnement du quotient conjugal à 3 000 euros (soit deux fois le plafonnement du QF) ne toucherait que les 20 % des ménages les plus aisés (à partir de 55 000 euros annuels pour un couple mono-actif avec deux enfants). A ce niveau de revenu il est probable que l’avantage de l’imposition commune soit lié à une inégalité de revenus qui est la conséquence d’une spécialisation (complète ou non) entre les conjoints dans la production marchande et non-marchande ou que les ressources ne sont pas intégralement mises en commun entre les conjoints.
Une autre solution, complémentaire, consisterait à laisser le choix à tous les couples, entre la déclaration conjointe et la déclaration séparée et conformément aux échelles de consommation couramment utilisées, à n’accorder à la déclaration conjointe qu’une part et demie, au lieu de deux aujourd’hui. L’administration fiscale pourrait calculer la solution la plus avantageuse, les ménages ne choisissant pas systématiquement la bonne option pour eux.
Une véritable réforme exige d’ouvrir un débat plus large sur la prise en compte des solidarités familiales dans le système socio-fiscal. En attendant, ces solutions rééquilibrent le système et reviennent sur une norme de couple contraire à l’égalité femmes-hommes. A l’heure où le gouvernement cherche des marges manœuvre budgétaires, pourquoi s’interdire de modifier la fiscalité des couples ?
[1] Une décote est appliquée à l’impôt pour les foyers fiscaux dont le montant de l’impôt brut est peu élevé (moins de 960€). Comme la décote est calculée par foyer fiscal et qu’elle ne dépend pas du nombre de personnes inclues dans le foyer, elle est relativement plus favorable pour les célibataires que pour les couples. Elle permet d’éviter que les personnes seules rémunérées au SMIC travaillant à temps plein soient imposables. La décote vient ainsi compenser pour les bas revenus le fait que les célibataires sont pénalisés par les parts de quotient conjugal. Aucun mécanisme similaire n’est prévu pour les hauts revenus.