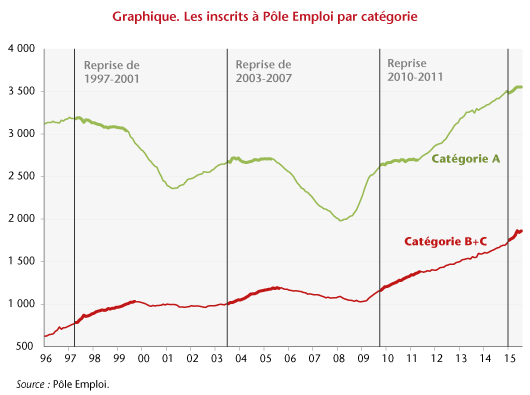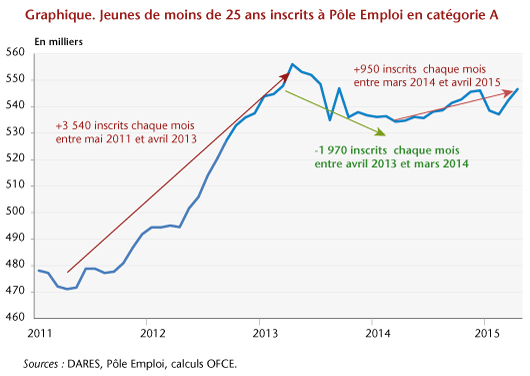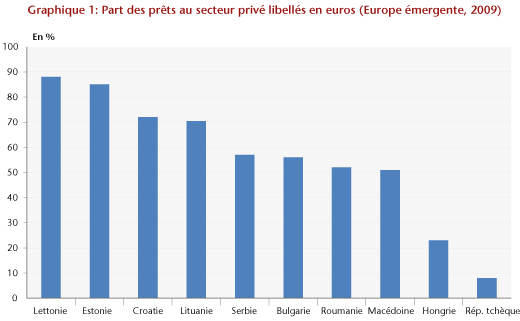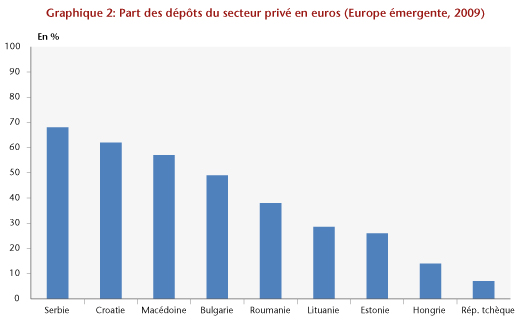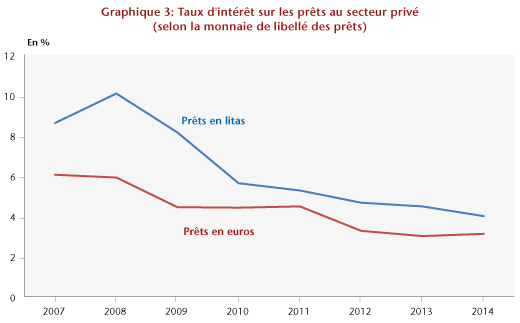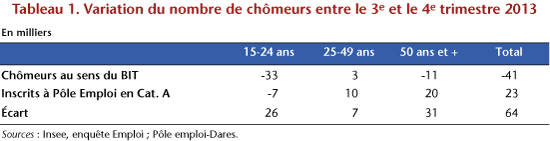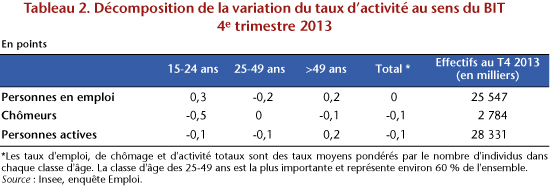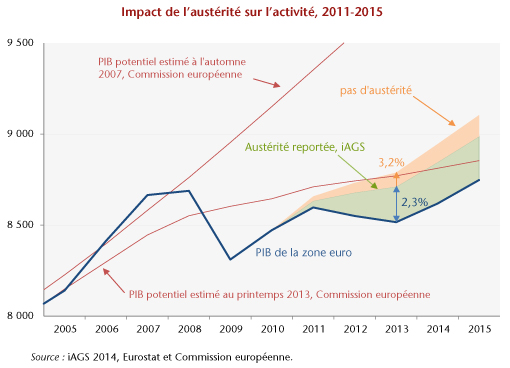Par Pierre Madec et Henri Sterdyniak
Le 24 octobre dernier, le conseil d’analyse économique (CAE) a publié une note proposant une nouvelle politique du logement locatif en France. Cette note remet en question un certain nombre de mesures gouvernementales figurant dans la loi ALUR, actuellement en discussion au Parlement, comme l’encadrement des loyers et la garantie universelle des loyers (GUL)[1]. Ces critiques sont-elles justifiées ?
En fait, les auteurs reconnaissent que le marché du logement est spécifique, qu’il faut le réguler, que l’Etat doit construire des logements sociaux et aider les familles pauvres à se loger. Aussi, leurs divergences avec la politique qu’entend suivre le gouvernement actuel ne peuvent-elles être que limitées, et concernent les moyens plutôt que les objectifs. Le libéralisme ne fonctionne pas en matière de logement. Il faut mettre en place des dispositifs d’intervention publique, qui doivent viser, nous le verrons, des objectifs contradictoires, dispositifs dont la structure est obligatoirement ouverte à la discussion.
Le parc locatif privé : cogestion et aléa moral
Concernant le parc locatif privé, les auteurs proposent essentiellement l’instauration d’un système de flexi-sécurité du logement, inspiré de celui préconisé pour le marché du travail : diversification et libéralisation des baux, nouveaux droits pour le bailleur, plus grande flexibilité des conditions de résiliation de bail, ou encore mise en place d’un système de cogestion du marché locatif privé autour d’une « régie du logement » dont les prérogatives s’étendraient de la fixation des loyers « de référence » à la gestion des baux. Cette « régie », gérée paritairement par les locataires et les propriétaires, jouerait un rôle de médiateur lors des conflits opposant locataires et propriétaires à l’image des prud’hommes pour les conflits du travail.
L’argument principal utilisé par les auteurs pour condamner un dispositif tel que la GUL est qu’elle créerait des problèmes d’aléa moral trop importants, c’est-à-dire que l’assurance inciterait les personnes couvertes à prendre « trop de risques ». En l’espèce, le locataire, assuré de voir ses défauts de paiement pris en charge par le fond, se soucierait moins de verser ses loyers ; il pourrait porter son choix sur un logement plus cher que ses besoins réels. Le propriétaire serait moins soucieux de la sélection de son locataire. Les auteurs utilisent également l’argument de l’aléa moral pour défendre la mise en place de baux flexibles : cela permettrait selon eux de lutter contre la dégradation des logements ou encore les conflits de voisinage.
L’idée du locataire systématiquement « mauvais payeur volontaire » et prêt à dégrader le logement qu’il loue nous paraît excessive et réductrice. Or, cette idée est assez largement développée par les auteurs. Ceux-ci semblent oublier que la GUL couvrira surtout des locataires qui ne peuvent plus payer leurs loyers en raison de difficultés financières (chômage, divorce …).
Cette garantie est avant tout une protection nouvelle pour le propriétaire. Protection financée à part égale entre bailleurs et locataires au travers d’un système de mutualisation. En cas d’impayé de loyer, le propriétaire sera directement remboursé par le fond. Ce dernier examinera ensuite la situation du locataire et procédera soit à un recouvrement forcé soit à une prise en charge personnalisée en cas d’impossibilité de paiement.
La GUL devrait permettre aux propriétaires de louer un logement à des personnes qui se trouvent dans des situations fragiles (travailleurs en contrat précaire, étudiants issus de familles modestes), sans que celles-ci aient à rechercher des cautions. Les propriétaires seraient moins incités à rechercher des locataires sûrs (fonctionnaires, étudiants issus de familles aisées, salariés des grandes entreprises). L’Etat est pleinement dans son rôle en couvrant un risque social, accru par la crise et la précarisation des emplois. Cela ne vaut-il pas le risque fantasmé d’augmentation de l’aléa moral ?
La question du bail pose une question de fond. Faut-il encourager le développement des propriétaires bailleurs individuels qui génère obligatoirement des problèmes délicats entre le souci du propriétaire de disposer librement de son bien et d’avoir le maximum de sureté quant au paiement du loyer, celui des locataires d’avoir une sécurité de maintien dans les lieux et l’exigence de droit au logement ?
Un ménage à revenus faibles ou irréguliers, plus fragile, doit aussi pouvoir se loger dans le parc privé. Aussi, il peut paraître préférable d’inciter soit les investisseurs institutionnels à investir dans ce domaine ou les ménages à utiliser plutôt des instruments de placement collectif dans la pierre et de mettre en place des dispositifs, comme le GUL, qui permettent de traiter collectivement la question des non-paiements de loyer.
Le logement est loin d’être un bien ordinaire. Se loger est, et les auteurs le soulignent, avant tout un besoin essentiel, un droit fondamental. La précarisation massive de ce dernier à travers la mise en place d’un système de baux libéralisés ne peut être la solution. Au contraire, les auteurs se nourrissant du modèle allemand, l’introduction de baux à durée indéterminée (baux de référence en Allemagne) constituerait une avancée majeure en termes de sécurisation du locataire[2].
Encadrement contre loi du marché
Concernant l’encadrement des loyers, les auteurs s’appuient sur un certain nombre d’études visant à démontrer l’existence d’une corrélation entre l’état de dégradation du parc locatif et les mesures d’encadrement des loyers. Or, dans la loi ALUR, des dispositifs destinés à la prise en compte de la réalisation de travaux existent. Certes, un risque de détérioration du parc persiste, mais une fois ce dernier explicité, on doit mentionner l’existence, elle aussi probable, d’une montée en gamme du parc due justement au mécanisme de prise en compte des travaux.
Les auteurs développent également l’idée selon laquelle les mesures d’encadrement conduiraient à une baisse significative de la mobilité résidentielle. Si ce risque est réel pour les dispositifs visant à encadrer les loyers en cours de bail et non lors de la relocation (cause principale du creusement des inégalités de loyers observé en France depuis la loi de 1989), le dispositif d’encadrement présent dans la loi ALUR a, au contraire, pour objectif de conduire à une convergence des loyers[3]. Cette convergence, bien que modeste, compte tenu de l’écart important encore autorisé (plus de 40 %), va plutôt dans le sens d’une meilleure mobilité.
En réalité, le risque le plus important, soulevé par les auteurs, est le risque de diminution du nombre de logements offerts à la location. Bien qu’il semble peu probable que les bailleurs déjà sur le marché retirent massivement leurs biens de la location[4], la mesure d’encadrement peut désinciter les nouveaux investisseurs sur le marché locatif compte tenu de la baisse induite des taux de rendement. Ceci aggraverait encore davantage le déséquilibre offre/demande au sein des zones tendues. Dans les faits, cela paraît peu probable. Même en cas de baisse significative du nombre de nouveaux investisseurs, ceux déjà présents sur le marché de l’ancien, compte tenu des conditions de bail (et au grand dam des auteurs), ne pourront pas vendre facilement leur bien, sauf à le vendre à un nouvel investisseur qui au vu de la baisse des taux de rendement réclamera une baisse du prix. Les dispositifs d’incitation fiscale (type Duflot) actuellement en vigueur sur le marché du logement neuf laissent à penser que les bailleurs qui y investissent ne seront que peu touchés par l’encadrement.
Certains investisseurs pourraient cependant délaisser en effet la construction de logements neufs, ce qui, à court terme, jouerait plutôt en faveur d’une baisse des prix de l’immobilier[5], ce qui encouragerait l’accession à la propriété et la baisse du prix du foncier. Il faudrait cependant que le secteur public soit prêt à prendre la relève des investisseurs privés.
Près d’un ménage sur trois du 1er quartile de revenu (les 25 % les plus pauvres) est locataire du parc privé et subi un taux d’effort médian net des aides au logement de 33 %, en hausse de près de 10 points depuis 1996. Encadrer les loyers est avant tout une protection pour ces ménages modestes, ménages qui compte tenu de l’engorgement du parc social et du durcissement des conditions d’accès à la propriété, n’ont d’autres choix que de se loger dans le parc locatif privé.
La stratégie proposée par la loi Duflot consistant à « mettre en place un certain encadrement des loyers pour réduire les comportements prédateurs des propriétaires. Ne pas chercher à attirer des investisseurs par des loyers exorbitants et les anticipations de hausse du prix de l’immobilier » ne nous semble pas illégitime, si elle s’accompagne effectivement d’un effort en faveur du logement social.
Les tensions sur le marché du logement (où l’offre et la demande sont rigides) permettent de fortes hausses de loyers, qui aboutissent à des transferts injustifiés entre propriétaires et locataires. Ces transferts pèsent sur le pouvoir d’achat des plus pauvres, sur l’indice des prix, sur la compétitivité… En sens inverse, ces hausses peuvent stimuler la construction de logements neufs via la hausse de la valeur du foncier, mais cet effet est faible et lent (compte tenu des contraintes du foncier). L’encadrement peut contribuer à mettre un coup d’arrêt aux hausses de loyer, même s’il nuit quelque peu à l’incitation à l’investissement privé dans le logement. Il ne peut être écarté a priori.
Logement social malmené
Bien que le constat des auteurs est juste – le logement social ne joue pas son plein rôle, les systèmes de construction et d’attribution sont complexes et inefficaces – les solutions qu’ils proposent, et leur cohérence, nous le semblent moins.
Le débat sur le rôle et la place du logement social en France est ancien. Faut-il le réserver aux ménages pauvres et ainsi renoncer aux objectifs de mixité sociale ? Faut-il pour ce faire diminuer les plafonds d’éligibilité alors qu’aujourd’hui plus de 60 % de la population peut prétendre à un logement social ? Le logement social doit-il être rentable ? L’offre de logement social est-elle suffisante ?
L’idée défendue par les auteurs, selon laquelle l’Etat, à travers les prêts aidés aux organismes HLM, ne doit prendre en charge que le logement des ménages les plus pauvres, non rentable par nature, et doit laisser à la concurrence (promoteurs et investisseurs privés) le logement des classes populaires et moyennes, est critiquable, notamment en ces temps de crise économique. Il faut au contraire augmenter la part des logements sociaux mais aussi des logements intermédiaires aux loyers « modérés» construits avec financement public pour loger les classes populaires à des loyers raisonnables et faire baisser les tensions dans les zones critiques.
L’idée des auteurs selon laquelle le logement social ne peut être un droit accordé ad vitam aeternam peut paraître justifiée. En 2006, selon l’INSEE, plus d’un locataire du parc social sur 10 appartenait au cinquième quintile de revenu (20 % les plus riches). Sauf à considérer que le parc social doit être, en vertu du principe de mixité sociale, ouvert à tous, les mécanismes visant à inciter ces ménages à quitter le parc social pour les diriger vers le parc privé ou l’accession doivent être renforcés, les surloyers appliqués actuellement n’étant pas suffisamment efficaces. Mais il faut tenir compte de l’âge des occupants et de la disponibilité à proximité des logements à loyers « libres ».
Les auteurs proposent également, pour le logement des classes populaires et moyennes (c’est-à-dire les opérations « rentables ») de mettre en concurrence des structures privées (promoteurs, constructeurs privés, …). Une fois la durée d’amortissement du prêt de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) expirée, le logement ainsi construit pourrait changer de statut et basculer soit dans le parc privé soit être vendu. Cette idée laisse à penser que la pénurie de logements sociaux serait la conséquence d’un manque de fonds disponibles. Or, grâce aux montants déposés sur les livrets A, l’argent ne manque pas. Les freins à la construction de logement se trouvent ailleurs (manque de volonté politique, pénurie de foncier, …).
Bien qu’il soit nécessaire de lutter contre la ségrégation urbaine et que c’est effectivement en « disséminant les ménages défavorisés dans l’ensemble du tissu urbain » que cet objectif peut être rempli, les propositions des auteurs de la note du CAE sont peu réalistes. L’indice de ségrégation spatial proposé (voir encadré 10 du document de travail) amènerait à ne plus construire de logement sociaux là où la concentration de ces derniers est déjà importante. Or, compte tenu des contraintes foncières dans les zones tendues, ceci n’est pas tenable. L’objectif de lutte contre la ségrégation ne peut pas être prioritaire mais complémentaire de l’objectif de construction.
Un financement public conditionné de façon rigide à la valeur d’un ou deux indicateurs, même les plus transparents, comme le proposent les auteurs, serait extrêmement complexe à mettre en œuvre. La loi SRU fixant des objectifs identiques à des communes aux caractéristiques très disparates doit être aménagée. Il faut construire du logement social selon la demande et les besoins. Or, actuellement, il n’y a pas d’adéquation entre offre et demande et ce même dans les zones les moins tendues (logements trop grands ou trop petits, trop vieux, …). Selon l’INSEE, 14 % des locataires du parc social sont ainsi en situation de sur-occupation (soit le double de la proportion observée dans le parc privé). Non seulement l’entrée dans le parc social est difficile mais la mobilité au sein de ce parc l’est tout autant. Il faut donc construire massivement des logements sociaux non seulement pour accueillir des populations nouvelles mais aussi pour loger dans de meilleures conditions les populations y résidant actuellement.
Faut-il dé-municipaliser la question du logement ? Laisser aux seules municipalités le pouvoir de décision (et d’action) sur les politiques de la ville est une erreur, certains pouvant être incités à préférer céder les terrains disponibles à des promoteurs privés qu’à des organismes d’HLM, que ce soit pour des raisons directement financières ou pour choisir d’attirer une population relativement aisée, sans problèmes sociaux. Ainsi, la politique du logement nécessite de fortes incitations à la construction de logements sociaux, comme des aides spécifiques aux communes où ils sont implantés, comme des contraintes légales et une imposition spécifique compensatrice pesant sur les communes qui n’ont pas de logement sociaux. La loi SRU est nécessaire.
Notons que les propositions allant dans ce sens sont difficiles à faire adopter au niveau politique. Ainsi, la mesure visant à offrir aux intercommunalités le pouvoir de décision concernant notamment le Plan local d’urbanisme (PLU), disposition présente dans la loi ALUR, a été en grande partie rejeté par le Sénat, avec l’appui de la ministre du Logement[6]. De même, l’Union sociale pour l’habitat, tout en déplorant le manque de mobilité au sein du parc social, s’oppose régulièrement à toutes modifications importantes des processus d’attribution pouvant aller dans le sens d’un regain de mobilité, chaque organisme voulant garder ses critères propres.
Loyers et aides au logement entre imposition et imputation
Dans la note du CAE, la prise en compte des dépenses de logement par la fiscalité fait l’objet de propositions contestables. Certes, nous sommes d’accord avec le point de départ : il serait souhaitable d’aboutir à une certaine neutralité fiscale entre les revenus du capital financier et les loyers implicites. C’est nécessaire du point de vue de l’efficacité économique (ne pas trop favoriser le placement en logement) comme de la justice sociale (à revenus imposables égaux, un propriétaire et un locataire n’ont pas le même niveau de vie). Mais, selon nous, ceci ne peut se faire qu’en taxant effectivement les loyers implicites. Cette réforme est délicate aujourd’hui, car les impôts ont déjà beaucoup augmenté. On ne peut plus guère introduire un nouvel impôt. Elle devrait donc s’accompagner d’une translation vers le haut des tranches du barème, de sorte que, si les propriétaires payent plus, les locataires payent moins. Par ailleurs, elle risque de détourner certains ménages de la construction de logement ; son produit doit donc être utilisé en partie pour la construction de logement, ce qui est contradictoire avec la proposition précédente de l’utiliser pour réduire les impôts des locataires. Elle ne peut donc être introduite que très progressivement. Il faudrait d’abord revaloriser les bases de la taxe foncière. Puis, utiliser cette base (dont les propriétaires accédant pourraient déduire les charges d’emprunt) pour taxer les valeurs locatives à la CSG ou à l’IR (avec un certain abattement).
Craignant l’impopularité de la mesure, les auteurs proposent que les locataires puissent déduire leur loyer de leur revenu imposable (avec un plafond relativement élevé de l’ordre de 1 000 euros par mois). Cette proposition n’est pas acceptable :
– elle est arbitraire : pourquoi ne pas déduire aussi, toujours avec des plafonds, ses dépenses alimentaires (on ne peut vivre sans manger), ses dépenses de vêtements, de transports, de téléphone portable (devenus indispensables aujourd’hui). C’est sans fin. Le barème de l’IR prend déjà en compte le fait qu’un niveau minimum de revenu est indispensable (pour un couple avec 2 enfants, l’imposition ne commence qu’au-delà d’un revenu salarial de 2 200 euros par mois). La mesure favoriserait les dépenses de logement au détriment des autres dépenses, ce qui n’a guère de justifications ;
– l’économie d’impôt ainsi réalisée serait nulle pour les personnes non-imposables, faible pour les personnes juste à la limite de l’imposition : une famille de deux enfants dont le revenu est de 3 000 euros par mois et 600 euros de charges de loyer paierait 700 euros d’impôt de moins ; une famille aisée imposée au taux marginal de 45 % pourrait économiser 5 400 euros au titre de l’impôt, soit 450 euros par mois, c’est-à-dire plus que les allocations logement de la plupart des familles pauvres ;
– la mesure serait très coûteuse. Les auteurs ne nous donnent pas une estimation précise, mais réduire de 10 000 euros, le revenu imposable de 40 % des 18 millions de ménages imposables en France (la proportion des locataires) pourrait réduire de 14 milliards le produit de l’IR. En fait, ceci devrait obligatoirement être compensé par une translation vers le bas des tranches de l’impôt. Au bilan, là-aussi, si les locataires payaient moins, les propriétaires paieraient plus. Reste que la mesure serait moins efficace du point de vue économique que la taxation des loyers implicites, puisqu’elle introduirait un biais en faveur des dépenses de logement et qu’elle ne tiendrait pas compte de la valeur du logement occupé.
Les auteurs proposent d’intégrer l’allocation-logement dans l’IR et de faire gérer l’ensemble par l’administration fiscale, qui serait chargée de la mise en cohérence de la politique redistributive en direction des bas revenus. Certes, le système actuel d’aides au logement est perfectible, mais une fois encore leur analyse est partielle, n’intègre pas la totalité des aides dont bénéficient les plus pauvres (RSA socle, RSA activité et PPE). Ils oublient que l’aide aux personnes à bas revenus nécessite un suivi personnalisé, en temps réel, sur une base mensuelle ou trimestrielle que l’administration fiscale est incapable d’assurer. En fait, ils aboutissent à un système qui n’est guère simplifié : l’administration fiscale déterminerait l’aide au logement des ménages non-imposés que la CAF (Caisse d’Allocations familiales) verserait mensuellement et qui serait régularisé par l’administration fiscale l’année suivante. Mais il n’est pas dit si la même formule s’appliquerait au RSA. Pour les personnes imposées, l’aide serait gérée par l’administration fiscale. Les auteurs nous disent « l’aide ne pourrait être inférieure à l’allocation-logement actuelle », mais leur proposition augmenterait fortement le nombre de ménages non-imposés pour lequel il faudra comparer le gain en impôt et l’allocation ancienne formule. Ce n’est pas gérable. Certes, il serait souhaitable de simplifier le calcul de l’allocation-logement, de mieux l’intégrer avec le RSA. Ce sera un élément de la réforme nécessaire du RSA que le gouvernement devrait engager (voir rapport Sirugue et sa critique par Guillaume Allègre), mais l’ensemble doit continuer à être gérer par ceux qui savent le faire, les CAF et non l’administration fiscale.
—
Le lecteur intéressé par les problématiques liées au logement pourra consulter la Revue de l’OFCE « Ville & Logement », n°128, 2013.
[2] Rappelons que le marché allemand est bien différent du marché français (majorité de locataires, peu de tensions démographiques, …) et que ses règles ne peuvent donc y être transposées.
[3] Actuellement, en région parisienne et plus généralement dans l’ensemble des zones dites tendues, les différences de loyers entre ceux ayant emménagé dans l’année et les locataires présents depuis plus de 10 ans dans leur logement est supérieur à 30 % (38 % pour Paris) (OLAP, 2013)
[4] En effet, les investisseurs « anciens » ont potentiellement des taux de rendement supérieurs à ceux des « nouveaux » investisseurs.
[5] D’autant que le nombre de nouveaux ménages a tendance à baisser (Jacquot, 2012, « La demande potentielle de logements à l’horizon 2030 », Observation et statistiques, N°135, Commissariat au Développement Durable).
[6] Un amendement accordant une faible minorité de blocage aux communes lors des modifications de PLU (25 % des communes et 10 % des habitants) a été adopté au Sénat le vendredi 25 octobre. Amendement réduisant de fait le pouvoir des intercommunalités dans ce domaine.