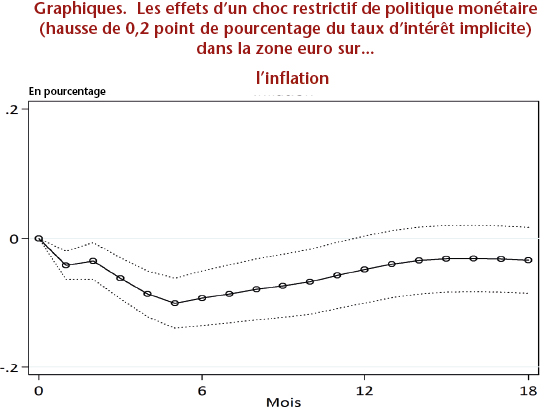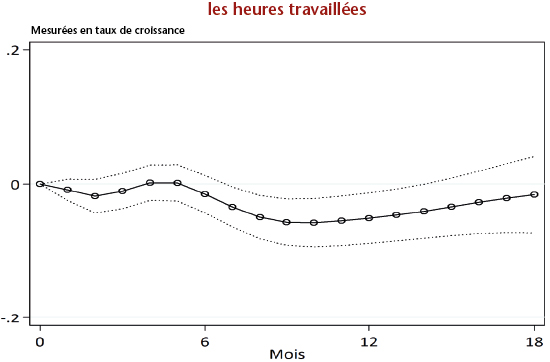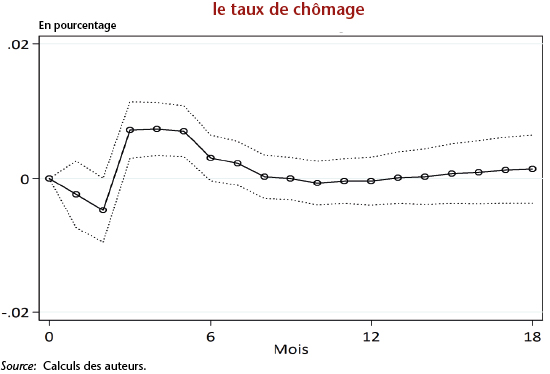Comment sauver l’Europe ? Comment changer de paradigme ?
par Xavier Ragot
On assiste à des inflexions nouvelles dans les débats sur la construction européenne. Moins visibles que des déclarations publiques, des conférences essentielles et ateliers se tiennent pour aborder de nouvelles options, sous des angles économiques et politiques différents. Le débat est plus vif en Allemagne qu’en France. En cause probablement le débat caricatural français pendant les élections présidentielles, sur la forme « pour ou contre la monnaie unique », alors que le débat préalable est de discuter comment orienter les institutions de la zone euro au service de la croissance et des inégalités.
Deux conférences ont eu lieu à Berlin à une semaine d’intervalle, considérant les options les plus opposées. La première a abordé les conséquences de la sortie d’un pays de la zone euro ; la seconde la recherche d’un paradigme alternatif pour réduire inégalités en Europe. Autant dire que ces deux conférences couvrent presque tout le spectre des politiques économiques envisageables.
Se faire peur : la fin de la zone euro ?
Première question : Que se passerait-il si un ou plusieurs pays sortaient de la zone euro ? Faut-il le souhaiter ou comment peut-on l’empêcher ? Une conférence a eu lieu le 14 mars avec pour titre « L’euro est-il viable en l’état, et que faire si ce n’est pas le cas ? » a rassemblé des présidents d’instituts influents comme Clemens Fuest, des membres des cinq sages allemands comme Christoph Schmidt et des économistes médiatiques en Allemagne, comme Hans-Werner Sinn, ou encore des économistes comme Jeromin Zettelmeyer. La présence de l’OFCE, en ma personne, a peut-être permis de rappeler des éléments simples, mais utiles.
Cette première conférence a parfois joué sur l’ambiguïté de la question, certaines contributions semblant souhaiter la fin de la zone euro alors que d’autres contributions étaient plus analytiques afin d’en montrer les risques. Dans ces débats la voix de Hans-Werner Sinn est singulière par sa radicalité. Sans aller jusqu’à souhaiter la sortie de l’Allemagne de la zone euro, ce dernier insiste de manière systématique (et biaisée) sur les coûts pour l’Allemagne de la politique monétaire européenne. Sinn insiste en particulier sur le rôle de l’exposition cachée de l’Allemagne à la dette des autres pays par l’intermédiaire de la Banque centrale européenne et de TARGET2, qui enregistre les surplus et déficits des banques centrales nationales vis-à-vis de la Banque centrale européenne. Le solde TARGET2 montre que les pays du sud de l’Europe ont un déficit alors que l’Allemagne a un excédent substantiel de près de 900 milliards d’euros, ce qui représente 30% du PIB allemand. Ces montants sont très importants mais ne sont en aucun cas un coût pour l’Allemagne. Dans le cas le plus extrême d’un non-paiement par une banque centrale nationale (autant dire une sortie de la zone euro), la perte serait partagée par tous les autres États de manière indépendante des surplus. Ces soldes TARGET2 font partie de la politique monétaire européenne pour atteindre un objectif sur lequel on s’était mis d’accord : un niveau d’inflation moyen de 2%. Cette cible n’est pas atteinte depuis de nombreuses années. Par ailleurs, cette politique a conduit à des taux d’intérêt bas dont profitent les Allemands qui paient des charges d’intérêt faibles sur leurs dettes publiques, comme le rappelle Jeromin Zettlemeyer. Enfin, la balance commerciale fortement excédentaire de l’Allemagne montre que l’absence d’ajustement de taux de change dans la zone euro a largement bénéficié à l’Allemagne. Rappelons, que l’Allemagne a exporté plus que la Chine en volume en 2016, selon l’institut allemand Ifo !
Ma présentation s’est basée sur les nombreux travaux de l’OFCE sur la crise européenne. L’OFCE a publié un billet analytique sur les effets d’une sortie de la zone euro en montrant tous les coûts associés. Les travaux de Durand et Villemot fournissent des bases analytiques pour donner des ordres de grandeur. Quelle serait la réduction de la richesse des Allemands en cas d’explosion de la zone euro ? Le résultat n’est, somme toute, pas très surprenant. Les Allemands seraient les premiers perdants avec une perte de richesse de l’ordre de 15% du PIB. Bien sûr, ces chiffres sont extrêmement fragiles, et il faut les interpréter avec la plus grande des prudences. L’explosion de la zone euro nous plongerait dans le domaine de l’inédit, qui nous surprendrait par des déstabilisations que l’on ne soupçonnent pas.
Après ces éléments préliminaires, le cœur de ma présentation s’est ensuite concentré sur un point simple. Notre véritable défi est de construire des marchés du travail cohérents au sein de la zone euro, tout en diminuant les inégalités. Après la politique monétaire commune, la coordination des politiques budgétaires qui a été réalisée dans la douleur après 2014 et les errements des politiques fiscales récessionnistes (l’austérité), la question principale pour l’Europe dans les dix ans à venir est de rendre cohérents les marchés du travail. En effet, une puissante force déstabilisatrice en Europe est la modération salariale en Allemagne, fruit de la difficulté de la réunification au début des années 1990, comme on l’a montré dans un article avec Mathilde Le Moigne. Ce que l’on appelle le problème de l’offre en France est en fait le résultat des divergences européennes sur le marché du travail après la modération salariale allemande. J’ai proposé au Parlement européen l’introduction d’une discussion européenne de la dynamique des salaires nationaux afin de faire converger les salaires de manière non déflationniste et en évitant un chômage élevé dans le sud de l’Europe. Cette coordination des politiques économiques sur le marché du travail est désignée par l’anglicisme wage stance. Coordination de l’évolution des salaires minimums et des salaires réglementés, indication de l’orientation des évolutions salariales pour les négociations sociales, autant d’outils de coordination des marchés du travail.
Un second outil est bien sûr la constitution d’une assurance chômage européenne, qui est bien moins complexe que l’on pourrait le penser. Cette assurance-chômage européenne a vocation à être complémentaire des assurances chômage nationales et non un substitut. En effet, les systèmes nationaux d’assurance chômage sont hétérogènes car, d’une part les marchés du travail sont distincts, et d’autre part les préférences nationales sont différentes. Les systèmes d’assurance chômage sont le fruit de compromis sociaux historiques pour la plupart.
Comment interpréter cette relative radicalité allemande contre l’Europe actuelle ? Peut-être représente-elle le mécontentement d’économistes perdant de l’influence en Allemagne. Cela peut sembler paradoxal, mais nombre d’économistes et d’observateurs allemands évoluent pour reconnaître la nécessité de construire une Europe différente, non assise sur des règles, mais laissant la place à des choix politiques au sein d’institutions fortes. Des institutions agiles et respectées plutôt que des règles. Cette position est associée à la France dans le débat européen : le choix plutôt que la règle. L’accord de coalition allemand qui a rendu possible un gouvernement SPD/CDU place la question européenne au centre de cet accord mais avec un grand flou sur le contenu. Quelques évolutions permettront de tester la pertinence de cette hypothèse, notamment la question d’un ministre de la zone euro, de la nature des règles de décision au sein de l’institution-clé pour résoudre les crises, le mécanisme européen de stabilité.
Europe : Changer de logiciel/modèle/paradigme/narration
Une seconde conférence plus confidentielle s’est avérée plus passionnante encore. Avec la présence de l’European Climate Foundation sur la question du climat, la présence de l’institution INET sur l’évolution de la pensée économique, de l’OFCE sur les déséquilibres européens ; le but de la conférence étant de réfléchir à un changement de paradigme, ou de narration, pour penser une articulation nouvelle entre politique et économie, État et marché, afin de penser une croissance soutenable, sur le plan climatique mais aussi social. Une narration est une vision du monde véhiculée par un langage simple. Ainsi la narration « néolibérale » se construit-elle sur des mots positifs : « concurrence », « marchés », « liberté », et des mots négatifs : « rentes », « interventionnisme », « égalitarisme », qui ont permis de créer un langage. Donald Trump produit une narration tout aussi efficace : « giving power back to the people », « America first » ; cette narration marque le retour du politique sur le mode d’un nationalisme assumé.
Comment construire une autre narration qui place au centre l’évidence de la lutte contre le réchauffement climatique, l’augmentation des inégalités, l’instabilité financière ? Pendant une journée des économistes renommés en Europe ont parlé de l’intelligence artificielle, du réchauffement climatique, des formes actuelles de politiques économiques et industrielles, de la dynamique du crédit et des bulles financières, etc. Des travaux empiriques à la pointe de la recherche et des réflexions sur la possibilité d’un discours cohérent se sont mélangés dans la promesse d’un discours (narration) alternatif. Ce n’est qu’un début. On perçoit là la possibilité d’un renouvellement de la pensée au-delà des clivages politiques pour parler au fond que de l’essentiel : comment mettre l’économie au service d’un projet politique qui ne vise pas à reconstruire des frontières pour exclure mais à penser notre humanité commune ?
Ces deux conférences montrent la vitalité du débat européen, qui est présenté sous un angle trop technique en France. La raison d’être de l’euro, c’est un projet commun. C’est à ce niveau qu’il faut amener le débat avant les échéances électorales européennes de 2019.