Ce que révèlent les stratégies de relance budgétaire aux États-Unis et en Europe ?
par Christophe Blot et Xavier Timbeau
Parallèlement aux décisions de la Réserve
fédérale et de la BCE,
les gouvernements multiplient les annonces de plans de relance pour tenter
d’amortir les conséquences économiques de la crise sanitaire du COVID19 qui a
déclenché une récession d’une ampleur et d’une vitesse inédites. Le confinement
de la population et la fermeture des commerces non essentiels induisent
respectivement une baisse des heures travaillées et un empêchement de la
consommation ou de l’investissement combinant un choc d’offre avec un choc de
demande.
Aux États-Unis comme en Europe, les réponses à la crise se
dévoilent au fur et à mesure du temps, mais les choix effectués des deux côtés
de l’Atlantique livrent déjà des enseignements sur les idéologies, les
caractéristiques fondamentales des économies et le fonctionnement de leurs
institutions.
Budget fédéral :
en avoir un ou pas
Après quelques jours de négociations entre Démocrates et
Républicains, le Congrès américain vient de voter un plan de soutien à
l’économie de 2 000 milliards de dollars (9,3 points de PIB)[1],
prévoyant notamment des transferts vers les ménages, des prêts pour les PME et
des mesures de soutien aux secteurs en difficulté sous forme de report
d’échéances. Du côté des Européens, la Commission a proposé de créer un fonds
doté de 37 milliards d’euros dans le cadre d’une initiative en faveur de
l’investissement. L’Union réaffecterait
également un milliard d’euros « en garantie au Fonds européen
d’investissement pour encourager les banques à octroyer des liquidités aux PME
et aux petites entreprises de taille intermédiaire »[2].
À
l’échelle de l’Union, ces sommes représentent 0,2 point de PIB et peuvent
sembler d’autant plus dérisoires qu’il ne s’agit pas de débloquer des fonds
additionnels mais de réallouer des fonds au sein du budget.
Ces différences de taille rappellent en premier lieu que le
budget européen est limité par construction et qu’il ne permet pas de répondre
à un ralentissement économique touchant l’ensemble des États membres. Au sein de l’Union
européenne, les prérogatives budgétaires sont la compétence des États
membres, tout comme les principaux instruments régaliens de réponse aux crises.
Ce sont les budgets nationaux qui sont mobilisés pour soutenir
l’activité économique. Ainsi, en cumulant les annonces faites au niveau des 5
plus grands pays de l’Union, on atteint une somme dépassant 430 milliards d’euros
(3,3 % du PIB), à laquelle il faut ajouter les garanties qui pourraient
s’élever à plus de 2 700 milliards, soit plus de 20 points de PIB de
l’Union européenne[3]. Les
mesures prises aux États-Unis et par les pays européens sont donc d’un ordre
de grandeur comparable et se distinguent donc par l’échelon auquel elles sont
prises puis par la répartition des sommes allouées. Aux États-Unis, le budget fédéral représente
33 % du PIB, ce qui permet de mettre en œuvre une action commune et
centralisée, qui bénéficie à l’ensemble des ménages et des entreprises selon
les décisions votées par le Congrès et opère donc implicitement une
stabilisation entre les États. En effet, les
impôts ou taxes versés par les ménages et les entreprises des États
les plus touchés diminueront relativement et ces mêmes États pourront aussi bénéficier
plus largement de certaines mesures fédérales. Surtout, le Congrès américain
peut voter un budget en déficit, ce qui permet de mettre en œuvre des mesures
de stabilisation intertemporelle[4].
À l’opposé, l’UE n’a pas la capacité de s’endetter et ce
sont les États
membres qui s’endettent. Cette capacité de stabilisation peut être contrainte
par la difficulté à se financer, induisant une hausse des taux d’intérêt dans
un premier temps ou un assèchement des marchés dans un second temps. Les
différents États
membres ne sont pas égaux devant les marchés, du fait de leur situation
macroéconomique ou du niveau de leur dette, comme l’Italie. Mais au-delà de ces
différences, c’est surtout parce que les épargnants, par l’intermédiaire des
marchés financiers, peuvent arbitrer entre des dettes de différents pays dans
un espace juridique (l’UE) qui garantit la libre circulation des capitaux que
les mouvements de taux d’intérêt peuvent amplifier de petites différences
macroéconomiques et alimenter des dynamiques autoréalisatrices. La crise des
dettes souveraines en 2012 a montré que la contagion par les taux souverains
entraînant, après la Grèce, l’Italie et l’Espagne dans la spirale du doute des
marchés financiers, pouvait induire des transferts considérables des pays en
difficulté vers les pays considérés comme vertueux. La contrepartie de
l’arbitrage avait été la baisse des taux pour l’Allemagne ou la France. Ces
transferts peuvent atteindre plusieurs points de PIB, au point qu’ils
engendrent un risque d’éclatement de la zone euro : il peut être
préférable de mettre fin à la libre circulation des capitaux, capturer
l’épargne nationale pour financer la dette publique (et donc monétiser le
déficit public) plutôt que laisser s’envoler la charge de la dette et devoir se
soumettre à un plan de redressement humiliant en échange de l’aide européenne.
L’envolée des taux souverains italiens, avant la
clarification de la communication de la BCE, a alors logiquement relancé le
débat sur la possibilité d’émettre des euro-bonds (appelés corona-bonds)
et qui permettraient de mutualiser une partie des dépenses budgétaires des États
de la zone euro et d’éviter cette spirale de l’arbitrage entre dettes
souveraines que rien ne justifie et dont les conséquences peuvent aller jusqu’à
l’éclatement de la zone euro.
Tant que ces titres de dette commune ne sont pas mis en
place ou que la Banque Centrale Européenne répugne à intervenir pour racheter
telle ou telle dette publique européenne, le rôle des institutions européennes
doit se situer à une autre échelle. Il s’agit d’abord de favoriser la
coordination des décisions prises par les États membres et d’inciter les
gouvernements à prendre des mesures fortes afin d’éviter des passagers
clandestins, qui attendraient des mesures prises par leurs voisins un effet
positif[5].
Ces effets risquent cependant d’être limités et on n’imagine pas vraiment qu’un
pays ne prenne pas les mesures nécessaires pour aider directement les ménages
et les entreprises à faire face au choc.
Plus que la coordination, il est essentiel d’assouplir les
règles budgétaires en vigueur comme annoncé afin de donner les marges de
manœuvre nécessaires aux États en faisant jouer la clause de circonstances
exceptionnelles. Mais au-delà d’une réponse à court terme, il importe que la
crise ne soit pas l’occasion d’exercer une pression vers plus de discipline
budgétaire. La légitimité des États membres dans la crise et la pertinence
de leurs réponses sera scrutée de près après la crise. L’Union européenne ne
doit pas s’engager sur un débat décalé qui ne ferait que compromettre
définitivement sa légitimité politique.
Puisqu’il n’existe aucun outil de dette mutualisée, la BCE
joue un rôle crucial pour maintenir un faible niveau de taux d’intérêt pour
l’ensemble des États de l’Union, aujourd’hui et demain.
Adapter les
plans au fonctionnement du marché du travail
Au-delà des sommes engagées et du niveau institutionnel
auquel les décisions sont prises, le contenu des plans rappelle que le
fonctionnement du marché du travail est bien différent de part et d’autre de
l’Atlantique. Les États membres de la zone euro ont privilégié le recours au
chômage partiel, ce qui permet de maintenir les salariés en emploi et de
socialiser la perte de revenu à la source. Le tissu productif est préservé
parce qu’il n’y a pas de rupture du contrat de travail et les États
offrent, selon les dispositifs en vigueur, de compléter partiellement les
pertes de salaire afin de maintenir le pouvoir d’achat des ménages. Ces
mécanismes, déjà largement répandus en Allemagne et en Italie, ont été
récemment amplifiés en France ou développés en Espagne. Ce faisant, une fois la
récession sera passée, la reprise de l’activité pourra se faire dans de
meilleures conditions puisque les entreprises disposent déjà de la main-d’œuvre
et évite ainsi les coûts de recrutement et de formation.
Aux États-Unis, ces mécanismes sont peu répandus et le marché
du travail américain est très flexible. Les délais pour licencier les salariés
sont très courts si bien que les entreprises ajustent rapidement leur demande
de travail. La chute de l’activité se traduira rapidement par une hausse du
taux de chômage comme semble l’indiquer les premières remontées du ministère fédéral
du travail (graphique). En deux semaines, le cumul d’inscription au chômage a
effectivement dépassé 10 millions, bien plus que ce qui a été observé après la
faillite de Lehman Brothers en septembre 2008 ou après l’effondrement de la
bulle internet en 2000. Par ailleurs, la durée d’indemnisation des chômeurs,
définie au niveau des États[6],
est généralement plus courte, ce qui expose rapidement les ménages au risque de
perte de revenu. C’est pourquoi une part importante des mesures du plan d’aide
voté par le Congrès prévoit un soutien direct aux ménages par le biais de
transferts ou de baisses d’impôts selon le niveau de revenu. Les mesures
prévoient également l’extension des périodes d’indemnisation et une aide supplémentaire
aux salariés licenciés qui pourra s’ajouter aux indemnités perçues dans le
cadre de l’assurance-chômage standard. Mais au lieu de cibler directement ceux
qui perdent leur emploi, ces mesures ont un spectre large. Un plan de relance
vigoureux sera sans doute nécessaire après la crise sanitaire. Mais, là aussi, les
effets d’aubaine consommeront une large partie du stimulus et il coûtera très
cher de remettre l’économie sur les rails d’avant la crise.
À l’approche des élections, ces choix expliquent aussi sans doute pourquoi Donald Trump semble parfois réticent à prolonger le confinement des Américains arguant que la crise économique pourrait faire plus de dégâts que la crise sanitaire[7]. Mais en laissant se répandre le virus, le nombre de personnes infectées et présentant des formes graves risque d’exploser et d’exposer les États-Unis à une crise sanitaire de grande ampleur. Il n’est pas certain que le bilan du Président s’en trouve plus favorable et que la stratégie américaine s’avère plus efficace, que ce soit sur le plan sanitaire ou économique.
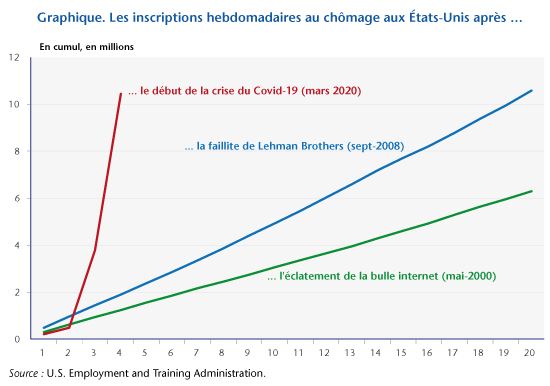
[1] Ce plan
fait suite aux mesures précédentes dont le montant d’élevait à un peu plus de
100 milliards de dollars. Il inclut l’ensemble des mesures en faveur des
ménages et des entreprises (prêts et soutiens à la liquidité).
[2] Voir https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_459.
[3] Notons
de plus que certaines mesures ont été prises en fonction d’une durée supposée
du confinement et pourraient donc être recalibrées suivant l’évolution de la
situation.
[4] La
grande majorité des États ont par contre des contraintes en matière de déficit
ou de dette. Face à l’ampleur de la crise, certains d’entre eux débloquent
cependant également des dépenses qui peuvent donc s’ajuster au plan de soutien
fédéral.
[5] Si un
pays A décide d’augmenter ses dépenses, le pays B peut espérer en tirer partiellement
profit par la hausse induite des importations du pays A en provenance de B, et
particulièrement s’il est petit par rapport à A.
[6] Le
système d’assurance-chômage américain s’appuie sur un régime propre aux États.
L’État
fédéral intervient sur la gestion des coûts de l’ensemble du système. Voir
Stéphane Auray et David L. Fuller (2015) : « L’assurance
chômage aux Etats-Unis ».
[7] Voir ici
pour une analyse des risques économiques et sanitaires.