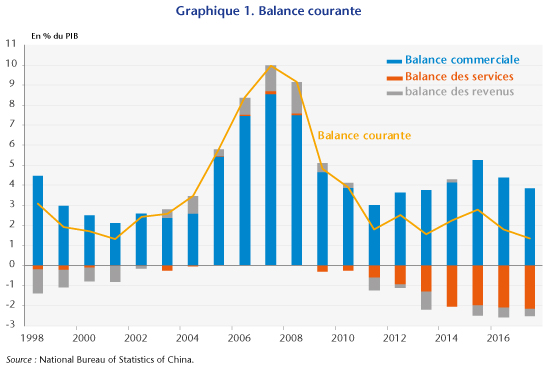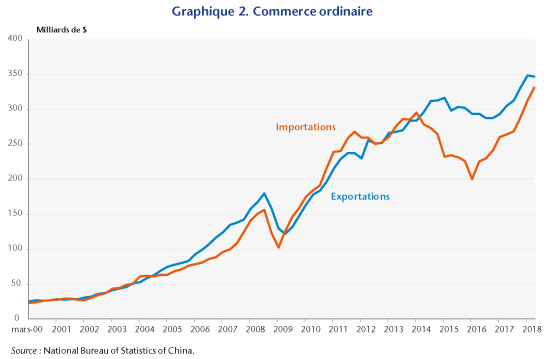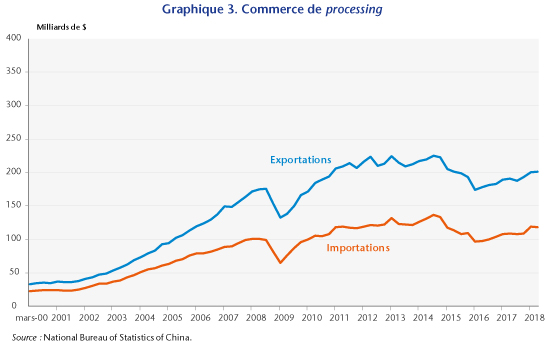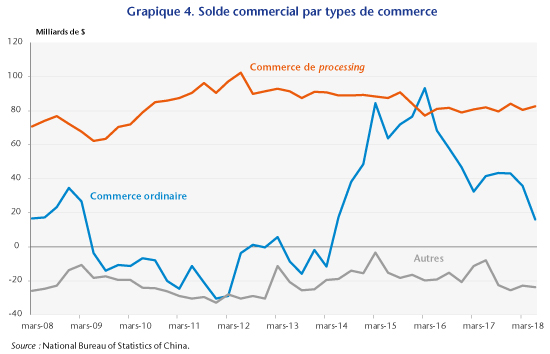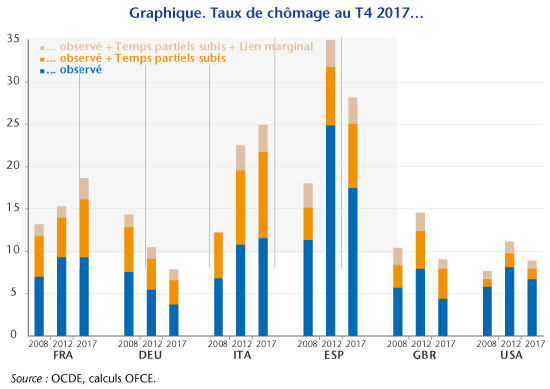On voit du numérique partout sauf….
Par Cyrielle Gaglio et Sarah Guillou
Tous les observateurs s’accordent à reconnaître la numérisation croissante de l’économie, de ses usages, de ses processus de production, et des sources de la croissance. Tous s’accordent aussi à y voir le futur des économies comme standard de son fonctionnement mais aussi le déterminant de sa compétitivité future. La mesure de cette numérisation est multidimensionnelle. La numérisation prend des définitions très variables selon les disciplines, les experts et ce que l’on cherche à montrer. Cette caractéristique multidimensionnelle révèle que le phénomène est bien réel mais difficile à quantifier, à circonscrire et donc à appréhender concrètement.
Quand on s’intéresse au tissu productif, la numérisation peut s’apprécier tout d’abord par l’importance de la production de numérique, c’est-à-dire de biens et services qui sont la matière première de la numérisation. Mais la numérisation peut aussi se saisir par le nombre de jeunes entreprises qui, fortement numérisées voire disruptives par rapport au fonctionnement du marché, peuplent l’économie ; ou encore par le changement des pratiques des entreprises, déjà existantes, qui augmentent le contenu numérique de leur technologie ou processus de production.
L’approche sectorielle permet de saisir une grande partie de cette numérisation, non seulement en mesurant la place des secteurs producteurs de biens et services numériques mais aussi en mesurant la consommation des secteurs de l’économie en intrants numériques.
Cette approche est proposée dans l’étude de Gaglio et Guillou (2018) et permet de situer la France vis-à-vis de ses partenaires. Comme ailleurs, le tissu productif français a profité, depuis le début des années 2000, de la baisse des prix des services des télécommunications et des prix du manufacturier numérique. Cette baisse des prix explique en grande partie la nature insaisissable du numérique dans la création de richesse. C’est pourquoi on est en droit de se demander si finalement cette étude ne butte pas sur le paradoxe énoncée en 1987 par Robert Solow au sujet des TIC et de la productivité dont la version serait ici : « on voit du numérique partout sauf dans les statistiques de la production ». La prégnance et la montée du numérique ne sont, en effet, pas aussi manifestes que l’on pourrait s’y attendre.
C’est un constat qui est encore plus justifié pour la France, qui se retrouve, une fois n’est pas coutume, dans une position médiane. Le secteur producteur numérique est quelque peu à la traîne relativement aux pays les plus dynamiques. Les Etats-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni et les pays du nord de l’Europe, très dynamiques, sont devant la France. Elle devance en revanche les pays du sud. La hiérarchie des pays en termes de consommation numérique est la même que celle en matière de contribution du numérique à la valeur ajoutée. Et si pour l’ensemble des pays étudiés, on observe le rôle moteur des services d’ingénierie informatique et numérique (SIIN) dans la numérisation du tissu productif (la production, les exportations et la consommation des branches), ces services, marqueurs de la numérisation des pays riches, augmentent moins vite en France que dans les autres pays.
L’enjeu numérique est au centre des débats sur les transformations du tissu productif, du marché de l’emploi, de la concentration du pouvoir économique et de l’énigme de la productivité. L’évaluation proposée dans Gaglio et Guillou (2018) offre des ordres de grandeur et un positionnement relatif qui appellent une réflexion sur les mesures de soutien aux secteurs numériques en France.