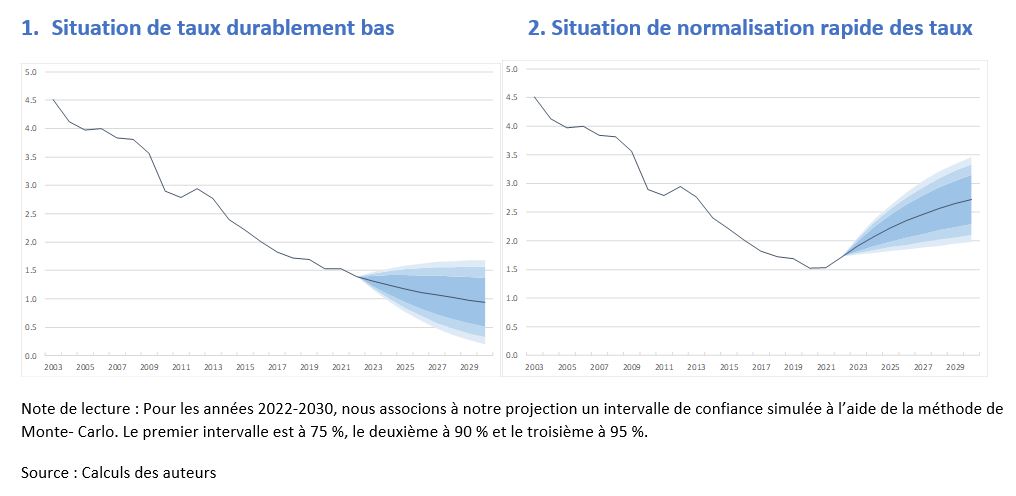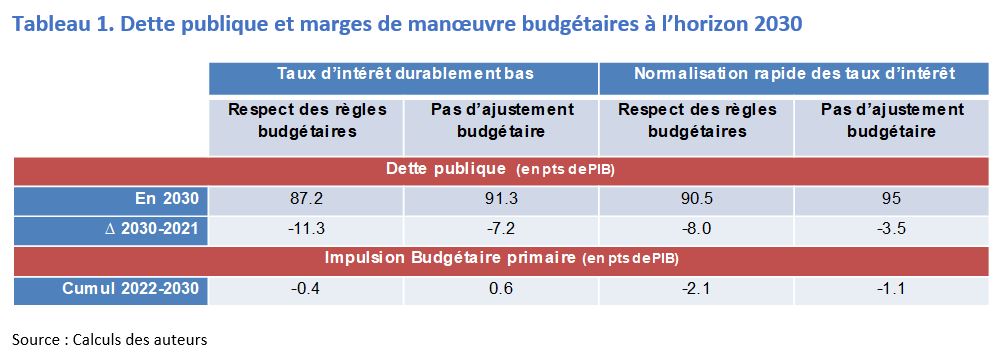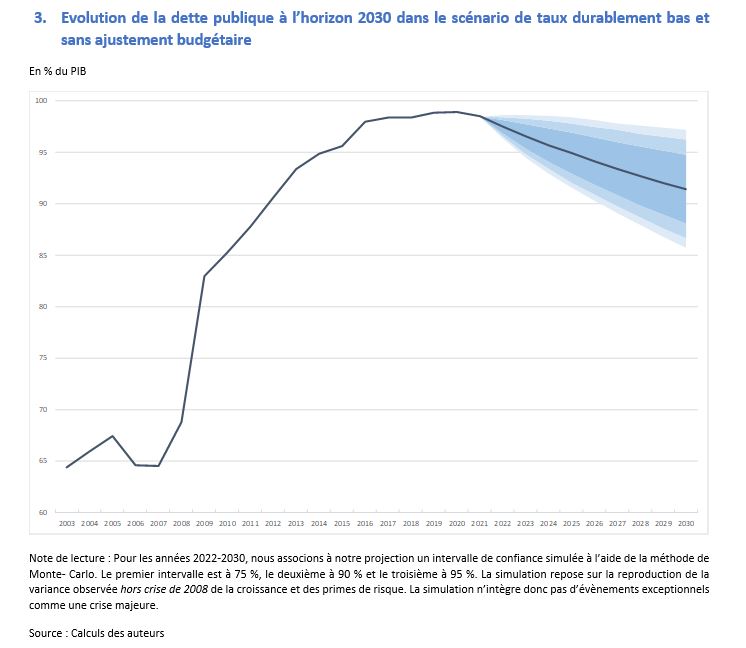Le casse-tête de l’inflation dans la zone euro : c’est la tendance, pas le cycle!
Par Thomas Hasenzagl, Filippo Pellegrino,
Lucrezia Reichlin, Giovanni Ricco
Que se passe-t-il avec l’inflation et la productivité dans la zone euro ?
La Banque centrale européenne semble avoir perdu la capacité de relever
l’inflation et les anticipations de prix ont glissé depuis la dernière
récession. Une grande partie du débat politique a porté sur l’aplatissement de
la courbe de Phillips. Pourtant, les estimations du processus conjoint
d’inflation et de production indiquent que les éléments les plus pertinents du
puzzle sont la diminution du potentiel de production et de l’inflation
tendancielle.
La dernière prévision d’inflation (HICP) de la BCE montre
une révision à la baisse brutale par rapport à ce qui avait été prévu il y a
deux ans (voir BCE, 2017, 2019). Par exemple, l’inflation pour cette année
était estimée à 1,5%, contre 1,2% aujourd’hui. Les chiffres correspondants pour
2020 sont respectivement de 1,7% et 1%.
En janvier 2018, dans notre billet de blog, nous avions
prévu que l’inflation globale de la zone euro serait de 1,1% cette année et
resterait proche de 1% pour les cinq prochaines années. Cette prévision était
basée sur notre modèle semi-structurel d’inflation américaine (Hasenzagl et al., 2018a) adapté aux données de la
zone euro. À l’époque, nous étions beaucoup plus pessimistes que la BCE, mais
conformes aux attentes du marché (Hasenzagl et
al., 2018b).
Dans ce billet, nous posons deux questions. Premièrement,
avec l’avantage de près de deux ans de données supplémentaires, notre vision a-t-elle
changé ? Deuxièmement, qu’implique la réponse pour nos estimations de la
courbe de Phillips et de l’écart de production dans l’Union ?
La réponse à la première question est négative. Nos prévisions pour cette année sont conformes à celles prédites il y a deux ans et indiquent 1,48% pour le T4-2022. Ceci est proche de ce que la BCE prévoit pour 2021.
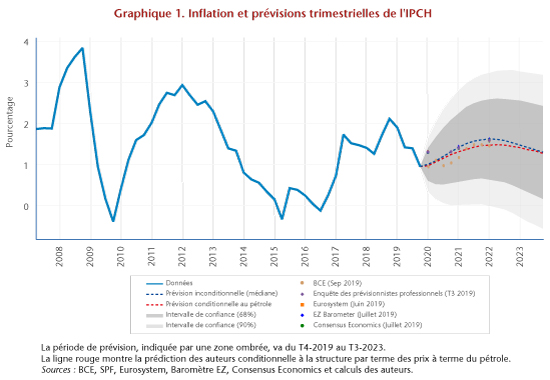
Pour répondre à la deuxième question, nous pouvons utiliser le modèle pour
obtenir une vue cohérente. En effet, notre modèle produit des estimations d’un
certain nombre des composantes structurelles – production potentielle, écart de
production, loi d’Okun, cycle de prix de l’énergie – et décompose l’inflation
en (i) un cycle expliqué par la courbe de Phillips qui connecte l’écart de
production aux prix, (ii) une composante liée aux prix du pétrole, et (iii) l’inflation
tendancielle identifiée comme une anticipation d’inflation à long terme.
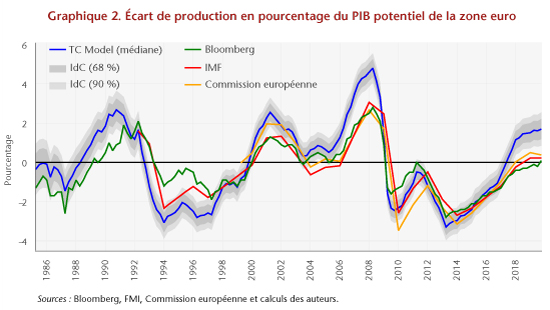
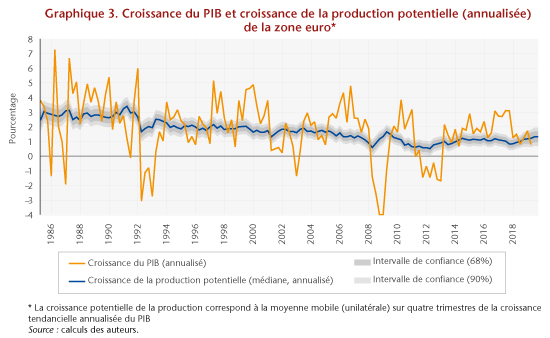
La figure 2 présente notre estimation de l’écart de production par rapport
aux estimations du FMI, de la Commission européenne et de Bloomberg, et la
figure 3 montre notre taux de croissance de la production potentielle.
Notre mesure de l’écart de production est assez corrélée aux mesures
institutionnelles. Cela implique une tendance adaptative qui montre un déclin
constant depuis le début de notre échantillon au milieu des années 1980 et un
ralentissement supplémentaire persistant depuis la grande crise financière (la
croissance potentielle est maintenant estimée à 1%). Celles-ci, en accord avec
l’idée selon laquelle de profondes récessions créent une hystérèse dans l’activité
économique réelle (voir, par exemple, Galì, 2015). Nous attribuons le
ralentissement de la croissance moyenne de la production depuis la crise à la
tendance plutôt qu’au cycle. Cette opinion est également corroborée par
l’observation selon laquelle la récession de 2008 est associée à une baisse
persistante de l’investissement privé, ce qui est en contradiction avec les
régularités du cycle économique précédent (Caruso et al., 2019).
Notre modèle implique une courbe de Phillips relativement pentue par
rapport aux estimations de la littérature selon lesquelles, elle s’est affaiblie
ou a même disparu (voir, par exemple, Ball et Mazumder, 2011 ; FMI, 2013 et
Hall, 2013). Cependant, l’écart de production étant relativement faible et, à
l’heure actuelle, le prix de l’énergie ayant un effet neutre sur l’inflation
globale, la dynamique de l’inflation est expliquée en grande partie par sa
tendance. Le graphique 4 montre la décomposition de la composante cyclique de
l’inflation mesurée par l’IPCH en énergie (en rouge), le cycle économique (en
bleu) et le bruit (en jaune) et fait le bilan.
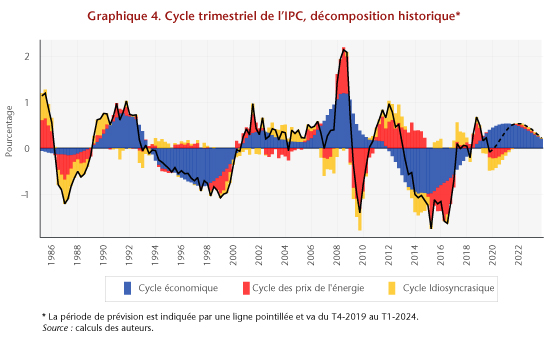
Cette vision de la dynamique macroéconomique de la zone
euro peut être résumée comme suit.
Nous avons toujours un écart de production positif qui
est proche du sommet (premier trimestre de 2020) et l’économie devrait
maintenant retrouver une croissance tendancielle estimée à environ 1%. La
baisse de l’inflation est principalement imputable à sa composante tendancielle
que nous identifions comme des anticipations de long terme. La courbe de
Phillips, bien que pentue, contribue peu à la hausse car la baisse de la
croissance de la production est due en grande partie à un ajustement à la
baisse du potentiel de production.
Bien que la discussion politique ait principalement porté
sur la courbe de Phillips et le cycle économique, il convient de comprendre les
tendances. Cela est vrai tant pour la production que pour l’inflation.
En ce qui concerne les implications politiques, le point
à retenir dans la zone euro devrait être le fait que les anticipations
d’inflation (la tendance) sont en baisse depuis le début de 2014 et que, malgré
une certaine volatilité, elle devrait rester inférieure à l’objectif pendant
longtemps. Le retard de l’action de la politique monétaire en 2012-2014 pourrait
être une explication. Il est intéressant de noter que nos estimations aux
États-Unis indiquent une tendance à la hausse de l’inflation (voir Hasenzagl et al., 2018b). Cette tendance est
également corroborée par la dynamique des anticipations d’inflation sur un
horizon de cinq ans par les prévisionnistes professionnels, illustrée à la
figure 5.
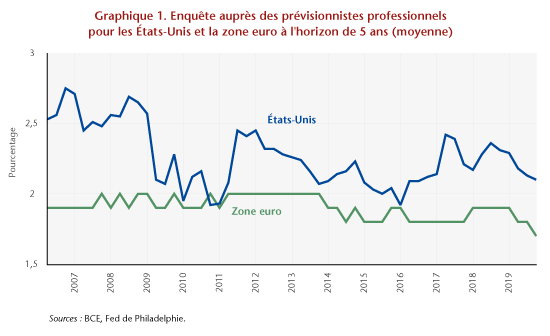
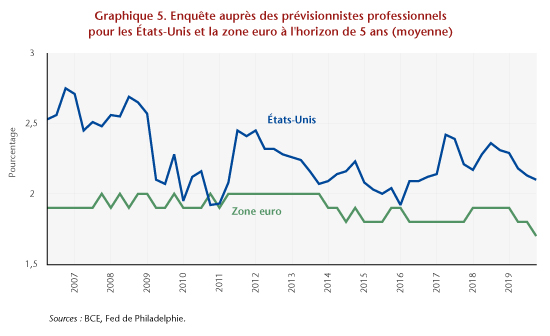
Un objet de réflexion intéressant est la compréhension
des causes communes de la baisse de la croissance de la production tendancielle
et de l’inflation tendancielle. La dette héritée et l’aversion pour le risque,
qui sont la conséquence de la grande crise, ainsi que des incertitudes liées à
une profonde transformation de nos économies, du changement climatique à la
technologie, en passant par le vieillissement, pourraient peser de manière
persistante sur la production et l’inflation. Cela nécessite une politique
monétaire et budgétaire non standard pour faire face aux tendances du PIB
nominal.
Notez également que la même prévision d’inflation aurait
pu être obtenue en appliquant au modèle un écart de production plus important
(et une tendance plus prononcée du PIB) mais une courbe de Phillips plus plate
(voir, par exemple, Jarociński et Lenza, 2018). Par conséquent, la question qui
se pose n’est pas de savoir quelle est la pente de la courbe de Phillips, mais
bien de savoir si nous croyons à un monde caractérisé par une courbe de
Phillips pentue et une croissance de la production potentielle en baisse, ou
dans un monde où la courbe de Phillips est plate et une croissance de la production
potentielle constante.
Ce billet a été publié en anglais sur le site de Vox.eu
Références
Ball, Laurence, et Sandeep
Mazumder, 2011, “Inflation Dynamics and the Great Recession”, Brookings Papers on Economic Activity,
42 (Spring): 337-381.
Caruso, Alberto, Lucrezia Reichlin,
Giovanni Ricco, 2019, “Financial and Fiscal Interaction in the Euro Area
Crisis: This Time was Different”, European
Economic Review, 119: 333-355.
European Central Bank, 2017, “ECB
Staff macroeconomic projections for the euro area”, décembre :
European Central Bank, 2019, “ECB
Staff macroeconomic projections for the euro area”, septembre :
Galí, Jordi, “Hysteresis and the
European unemployment problem revisited”, ECB Forum on Central Banking, mai
2015.
Hall, Robert E., 2013, “The Routes into
and Out of the Zero Lower Bound”, Paper presented at the Global Dimensions of
Unconventional Monetary Policy Federal Reserve Bank of Kansas City Symposium,
Jackson Hole, Wyoming:
Hasenzagl, Thomas, Filippo
Pellegrino, Lucrezia Reichlin, Giovanni Ricco, 2018a, “Low inflation for longer”,
janvier :
Hasenzagl, Thomas, Filippo
Pellegrino, Lucrezia Reichlin, Giovanni Ricco, 2018b, “A Model of the Fed’s View on Inflation”, CEPR Discussion Paper, No. 12564.
IMF, 2013, “The Dog that Didnt
Bark: Has Inflation Been Muzzled or Was It Just Sleeping?” In World Economic Outlook, avril 2013:
Hopes, Realities, Risks. Chapter 3.
Jarociński, Marek et Michele Lenza,
2018, “An Inflation‐Predicting Measure of the Output Gap in the Euro Area,” Journal of Money, Credit and Banking,
Blackwell Publishing, vol. 50(6), pages 1189-1224, septembre.