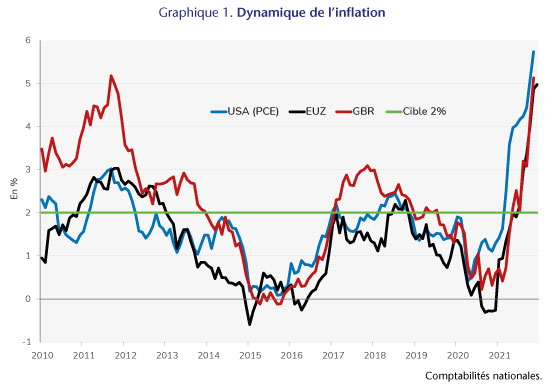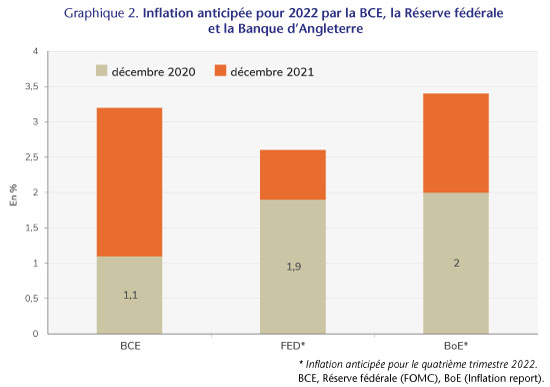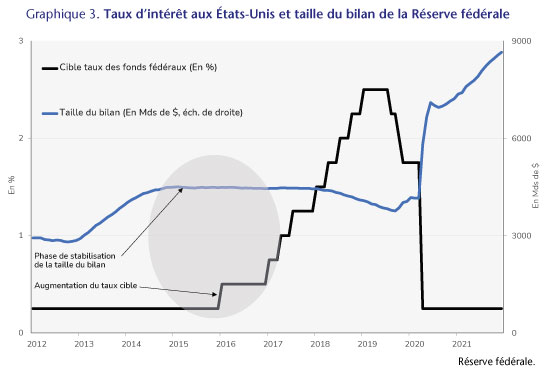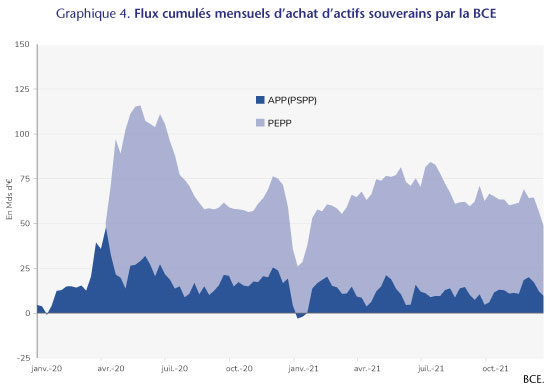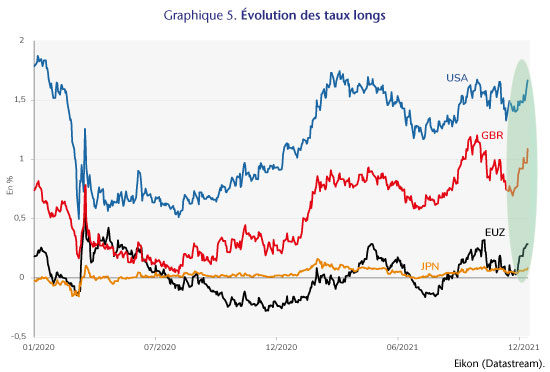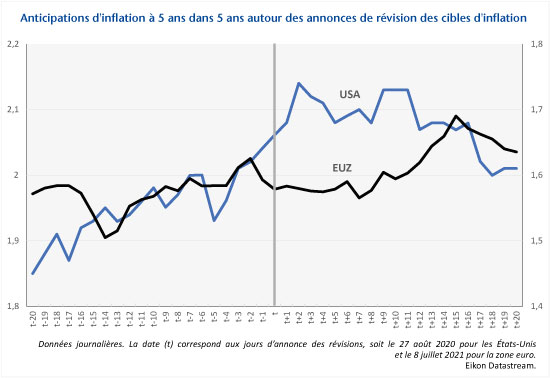Droits de succession : pourquoi les économistes ne sont-ils pas écoutés ?
Le 12 décembre 2021 le Centre d’Analyse Economique, instance
pluraliste de conseil du Premier ministre sous l’autorité de celui-ci, publiait
une note, Repenser l’héritage, plaidant notamment pour
l’augmentation des droits de succession. Le diagnostic est relativement
consensuel. La valeur du patrimoine relative au revenu a fortement
augmenté (300% du revenu national en 1970, 600% en 2020) ; le patrimoine
est très concentré, beaucoup plus que le revenu, et il n’est pas consommé en
fin de vie mais transmis. Par conséquent la part de l’héritage dans le
patrimoine total est passée de 35% au début des années 1970 à 60% aujourd’hui.
Ceci pose un problème d’équité dans la constitution du patrimoine, d’autant
plus grand que sa valeur est élevée et que certains actifs ne sont plus
accessibles sans apport. À l’image du discours de Vautrin
repris par Piketty dans son livre Le Capital au XXIe siècle,
pour avoir une bonne position économique dans la société, il vaut mieux épouser
une héritière que de trouver un travail bien rémunéré. Ce type de situation
pose un problème économique, politique et moral. La Note du CAE ne
s’appesantit pas sur la littérature ou la morale mais souligne justement que si
l’on se fixe un objectif d’accès équitable au patrimoine (et à son revenu),
l’imposition des successions de façon progressive et sans exemption, en tenant
compte de l’ensemble des actifs reçus au long de la vie, est préférable au
système actuel. Le rapport souligne, sur la base d’études empiriques, que les
différentes exemptions ne sont pas justifiées d’un point de vue économique.
Aussi, pour les auteurs l’augmentation des droits de succession pourrait
permettre de financer la garantie d’un capital pour tous, versé à la majorité.
Alors que la note fait parler d’elle entre la bûche de Noel et la galette des rois – la question de la transmission est un marronnier des repas familiaux –, le Président de la République, dans un entretien au Parisien du 4 janvier, annonce qu’il n’a pas l’intention d’augmenter les droits de succession, mais au contraire de les réduire pour les petites transmissions. En réalité, la séquence ressemble à celle qui a déjà eu lieu il y a cinq ans : en janvier 2017, France Stratégie publie un rapport semblable, signé par un des auteurs de la Note du CAE. France Stratégie est alors présidé par Jean Pisani-Ferry, qui fut ensuite en charge de l’écriture du projet d’En Marche. Or, aucune réforme des droits de succession ne figure dans le programme d’En Marche. L’impôt ne fera pas plus l’objet d’une réforme durant le quinquennat, contrairement aux deux précédents. En effet, sous la présidence de Sarkozy, le seuil d’imposition pour les donations avait été augmenté et la durée entre chaque donation défiscalisée, raccourcie. La présidence Hollande opéra un retour en arrière complet. Au final, que ce soit via l’alternance ou le « en même temps », la fiscalité sur les successions a assez peu évolué : l’assiette est mitée mais les taux peuvent être très élevés, ce qui pose des problèmes d’équité horizontale, notamment entre ceux qui préparent leur succession et ceux qui ne la préparent pas.
Pourquoi les économistes ne sont-ils pas écoutés ? Il
n’y a pas de grands mystères : les sondages et les enquêtes plus poussés
montrent tous que les droits de succession sont apparemment impopulaires. Une
des raisons, pointée par la Note du CAE est que les individus
connaissent mal les caractéristiques de l’impôt sur la succession et
surestiment son poids et la probabilité d’être eux-mêmes soumis à cet impôt.
Toutefois, cette explication n’est pas suffisante : l’impôt progressif est
impopulaire auprès de toutes les catégories sociales. Son impopularité ne
proviendrait pas seulement du fait que les individus évaluent mal leur intérêt
(plus de 80% des successions en ligne directe ne paient pas de droits), mais aussi
parce qu’ils trouvent juste de pouvoir léguer leur patrimoine à leurs enfants :
selon un sondage récent, même les individus qui ont peu de
chance de recevoir un héritage sont contre une augmentation des droits. Il est
donc probable que plus de pédagogie n’y changerait rien et que les économistes,
s’ils veulent peser, doivent changer leur fusil d’épaule et proposer une
réforme MAYA (Most Advanced Yet Achievable), plutôt qu’une réforme
optimale. Il est utile de réfléchir en termes de taxation optimale mais il n’est
pas toujours évident que la taxation optimale soit celle à mettre en avant dans
le débat, compte-tenu des préférences fiscales du public et des
caractéristiques actuelles du système fiscal, de toute façon très éloignées de
l’optimal théorique. Aussi, certains rapports mériteraient peut-être une
approche pluridisciplinaire[1],
surtout si la problématique initiale est : « Pour chacun de ces
défis, des solutions existent : pourquoi y a-t-il peu de progrès ? » (Blanchard et Tirole, p. 13).
Si l’on suit le diagnostic de la Note du CAE, le poids
grandissant de l’héritage dans les patrimoines est dû au poids grandissant du
patrimoine ainsi qu’à sa concentration. Tous les instruments qui pèsent sur ces
deux métriques auront donc un effet sur l’objectif poursuivi en termes de
mobilité sociale. C’est vrai de tous les impôts qui pèsent sur l’ensemble du
patrimoine, d’autant plus s’ils sont progressifs. C’est donc particulièrement
vrai d’un impôt sur la fortune et des impôts sur le revenu du patrimoine (CSG,
IR). L’impôt sur les hauts revenus (du travail ou du capital) réduit également
la concentration du patrimoine car les hauts revenus nets sont pour l’essentiel
épargnés et contribuent ainsi à l’accumulation du patrimoine. Tous ces impôts
concourent, à moyen-terme, à la mobilité patrimoniale intergénérationnelle. À l’instar de la Note du CAE, un autre objectif que
l’on peut assigner à une réforme est l’équité horizontale : les différents
revenus et patrimoines sont imposés de façon équitable. Cela impliquerait
d’imposer les revenus réels du patrimoine au barème de l’IR et de remettre en
place un ISF sur les patrimoines immobiliers et financiers. Ces mesures font
néanmoins l’objet de controverses dont l’évaluation dépasse ce billet.
Il existe néanmoins au moins une réforme avancée et réalisable,
potentiellement populaire dans l’opinion, qui pourrait augmenter l’équité
horizontale et la neutralité fiscale. Il s’agit d’imposer toutes les
plus-values réelles, sans oubli, effacement, abattement ou exemption.
Aujourd’hui, les plus-values sur la résidence principale sont exonérées. Les
autres plus-values immobilières et certaines plus-values mobilières sont
exonérées après une certaine durée de détention. Enfin, lors de successions et
de donations, les plus-values sont effacées même lorsque aucun droit de
succession n’est payé : à la revente, le prix d’acquisition qui entre dans
le calcul de la plus-value est supposé être le prix auquel le bien a été
transmis et non le prix d’acquisition initial. Par conséquent, un montant
important de revenus réels en euros sonnants et trébuchants échappe totalement
(ou partiellement) à l’impôt au moment de la revente. La masse de plus-values
est très importante : une grande part de l’augmentation du poids du
patrimoine dans le Pib (de 300 à 600 points) est liée à une augmentation de la
valeur du patrimoine plutôt qu’à une augmentation de son volume[2].
Une grande aversion, individuelle et sociale, au sujet de
l’imposition du capital est de devoir vendre du patrimoine pour payer l’impôt.
Cela explique d’ailleurs en partie l’impopularité des droits de succession,
ainsi qu’un ISF déplafonné sur la fameuse maison de l’agriculteur sur l’Île de Ré. L’imposition des plus-values réalisées ne pose pas ce problème
puisqu’elle arrive à un moment où les ménages ont des vrais revenus en euros.
Concernant la résidence principale ou secondaire, les ventes ne seraient
imposées que si le foyer n’utilise pas le revenu lié à la revente pour acheter
un nouveau bien, comme cela se fait dans d’autres pays[3].
Se pose enfin la question des biens qui sont transmis sur
plusieurs générations : le château, l’appartement parisien, la petite
entreprise familiale éventuellement devenue multinationale. Il y a plusieurs
approches pour les imposer. La première consiste à favoriser la détention et
transmission familiale : c’est l’approche suédoise qui depuis 2007 ne taxe
ni les successions ni le patrimoine. Le patrimoine est essentiellement taxé sur
le revenu, y compris toutes les plus-values nominales sans abattement selon
la durée de détention. Ceci réduit la concentration du patrimoine sans toucher
à la transmission. Le château familial, l’entreprise, peuvent être transmis de
génération en génération sans imposition. Seuls les aléas (familiaux,
économiques) peuvent permettre de disperser le patrimoine mais l’impôt sur le
revenu freine son accumulation.
Dans une seconde approche, les Canadiens imposent les
plus-values latentes lors des successions, hors conjoint et résidence
principale (l’imposition des plus-values latentes est aussi discutée dans la Note
du CAE mais plus comme aparté que comme élément central du débat). Dans le
système canadien, c’est le défunt (l’Estate soit la propriété du défunt)
qui paye l’impôt et non les héritiers : les actifs, hors résidence
principale, sont considérés comme vendus immédiatement avant la mort, la
plus-value est calculée et intégrée à 50% dans l’impôt sur le revenu de la
personne décédée de l’année courante[4].
Ce n’est que lorsque tous les impôts ont été payés que la propriété est transmise
officiellement aux héritiers. La législation fiscale canadienne prévoit de plus
une exemption de 900 000 dollars sur les plus-values tout au long de la
vie sur les petites entreprises familiales et les fermes. En dehors de ces cas,
pour les gros patrimoines, l’Estate est obligée de « vendre »
avant de transmettre, ce qui fait sens en termes de déconcentration du
patrimoine mais s’oppose à l’opinion publique telle qu’elle semble s’exprimer
en France.
Afin d’adapter ces dispositions au cas français, une
troisième approche est possible : la succession peut être le fait
générateur du calcul des plus-values[5],
dont l’imposition serait payée par les héritiers comme traditionnellement en France.
Toutefois, pour les résidences familiales (principales et secondaires) ainsi
que les entreprises familiales (au-delà d’un certain pourcentage des actions),
l’impôt ne serait pas dû immédiatement : les héritiers peuvent demander un
crédit fiscal sur lequel ils paieraient des intérêts annuels. La totalité des
plus-values seraient dues à la revente ou possiblement lors d’une transmission
ultérieure. Toutes les plus-values, y compris sur la résidence principale,
seraient ainsi imposées, au plus tard lors de la transmission, sans obliger les
héritiers à vendre[6].
L’imposition des plus-values lors des transmissions n’est pas
juste opportuniste (consentement plus élevé) mais aussi plus équitable que le
système actuel (les deux étant peut-être liés). Prenons l’exemple des deux
biens immobiliers : un appartement place du Panthéon, et un château
familial en Sologne, tous deux valorisés à 2 millions d’euros. La plus-value
latente réelle sur le premier est de 1 million d’euros alors qu’elle est nulle
sur le second (qui fait l’objet de frais de rénovation récurrents). Il y a de
nombreuses raisons, lors d’une transmission, de vouloir taxer le premier et pas
le second. La première raison est que le premier fait l’objet d’un revenu, la
plus-value latente, qui n’a pas été taxé. La seconde est que ce revenu ne
dépend pas du tout des propriétaires mais d’évolutions hors de leur contrôle,
notamment les effets d’agglomération métropolitaine liés à la mondialisation.
Imposer les plus-values est un moyen de faire financer par les gagnants des
changements économiques et sociaux, la compensation des perdants.
Bien entendu, remplacer les droits de succession par
l’imposition des plus-values latentes lors des donations et successions ne peut
être progressiste que si cette imposition n’est pas mitée dès le départ ou
petit à petit par des dispositifs d’exonérations. Il faut aussi que le grand
public comprenne et approuve la réforme. Un préalable nécessaire est une
réforme de l’imposition des plus-values réalisées où les abattements par année
de détention des actifs seraient remplacés par un actualisateur du prix
d’acquisition permettant d’imposer les plus-values réelles sans exonération
complète liée à la durée de détention.
Un bon impôt est un impôt consenti, non parce qu’il y a
suffisamment de niches pour accueillir tous les mécontents mais parce que le
mécanisme même de l’impôt est perçu comme suffisamment juste, efficace,
exhaustif et non confiscatoire pour asseoir à la fois un fort rendement et/ou
une forte progressivité. Aujourd’hui, si l’objectif est de réduire les
inégalités de patrimoine, ainsi que la transmission intergénérationnelle de
celui-ci, il ne faut pas négliger… l’impôt sur le revenu dont les plus-values
constituent une partie de l’assiette, et ce d’autant plus que l’imposition
équitable de tous les revenus est un objectif en soi.
Cette proposition ne prétend pas être une politique clé en
main, que le prochain président devrait mettre en place telle quelle. Les
droits de succession étant un sujet intergénérationnel, leur équité et
efficacité nécessitent une certaine stabilité des principes et des paramètres.
Cette question devrait ainsi être débattue dans la société et, dans l’idéal,
faire l’objet d’un large accord transpartisan. On ne peut que regretter le
fossé entre ce principe standard dans les préconisations économiques concernant
les enjeux intergénérationnels et ce que permettent les institutions
politiques françaises. Une raison de modifier les institutions dans le sens
d’une plus grande recherche de compromis (et entre temps de ne pas faire une
confiance aveugle dans les économistes) ?
[1] De même,
la proposition qui va suivre mériterait une évaluation pluridisciplinaire.
[2]
Soulignons par exemple que si les plus-values réelles correspondent à 1/3 de la
valeur des actifs transmis, et qui si celles-ci sont taxées à 30% (le taux
d’imposition actuel sur les revenus du patrimoine), alors les recettes fiscales
équivaudraient à 10% de la valeur des actifs transmis contre 5% dans le système
actuel.
[3] Par
soucis de consentement fiscal, la plus-value sur la résidence principale peut
être exonérée sous un certain plafond, a fortiori élevé mais dont on peut
débattre.
[4] Au
Canada, l’ensemble des plus-values est imposé à 50% du taux normal d’imposition
sur le revenu.
[5]
Les plus-values seraient alors calculées selon la formule : prix du marché
courant – prix d’acquisition revalorisé selon un indice d’inflation.
L’inflateur pourrait être légèrement plus élevé pour les biens immobiliers pour
tenir compte des coûts de maintien en état, si les propriétaires n’optent pas
pour les frais réels.
[6] Autre
avantage : la dette fiscale ne pourrait être supprimée par une loi rétroactive,
ce qui rend plus crédible le fait que les plus-values resteront imposées dans
le futur. Or cette croyance est importante à la fois d’un point de vue
économique (le contraire engendre un biais de détention), et d’un point de vue
politique, l’instabilité et l’incertitude fiscale ne pouvant que réduire le
consentement.