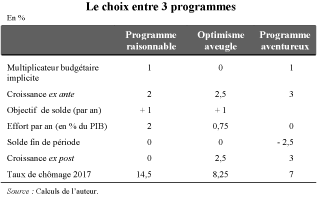AAA, AA+ : RAS ?
par Jérôme Creel
La perte du AAA de la France le vendredi 13 janvier 2012 est un événement historique. Elle pose trois questions : fallait-il renforcer l’austérité budgétaire à l’automne 2011 ? Pourquoi l’Allemagne a-t-elle été singularisée ? Que faire désormais ?
La perte du AAA pour les obligations d’Etat françaises n’est pas surprenante, loin s’en faut. La crise des dettes publiques qui secoue la zone euro depuis plus de deux ans – elle a démarré à l’automne 2009 – n’a pas pu être gérée convenablement car elle est survenue en période de récession, à un moment où tous les Etats membres européens avaient les yeux rivés sur leurs propres difficultés économiques. Sans réponse concertée, passant par une solidarité immédiate et des garanties mutuelles octroyées par les Etats membres de la zone euro sur l’ensemble des dettes publiques de la zone, avec le soutien de la Banque centrale européenne (cf. Catherine Mathieu et Henri Sterdyniak, ici), la contagion prévisible a eu lieu. Les erreurs objectives de finances publiques commises par les gouvernements grecs successifs, puis les errements des banques irlandaises ont produit une crise européenne systémique.
En mettant en œuvre, tous en même temps, des politiques d’austérité budgétaire, les gouvernements européens n’ont fait qu’amplifier les difficultés économiques : la stagnation économique, voire la récession, sont désormais au programme de la zone euro (cf. Xavier Timbeau et al., ici). La dégradation des notations souveraines dans la zone euro était donc attendue. Elle pose cependant trois questions.
- Fallait-il renforcer l’austérité ? Mathieu Plane (voir ici), dans son commentaire sur le plan d’austérité français supplémentaire de 7 milliards d’euros, annoncé en novembre 2011, pointait déjà du doigt la course perdue au AAA. Les effets sur la croissance de cette austérité étaient objectivement incompatibles avec l’objectif d’assainissement budgétaire annoncé : cet argument ne peut pas avoir été négligé par Standard & Poor’s.
- Pourquoi l’agence S&P a-t-elle singularisé l’Allemagne et la Slovaquie, seules économies de la zone euro à n’avoir pas été dégradées vendredi 13 janvier ? Si leurs liens commerciaux sont indéniables (cf. Sandrine Levasseur, 2010, ici), ce qui peut justifier de les associer, ces deux économies, et surtout l’Allemagne, trouvent leurs principaux débouchés dans la zone euro. La décélération de la croissance dans la zone euro, hors Allemagne, ne sera certainement pas sans conséquence outre-Rhin (cf. Sabine Le Bayon, ici). On voit donc mal comment la contagion de la crise pourrait s’arrêter aux frontières de l’Allemagne et de la Slovaquie. On peut même interpréter la récente souscription d’obligations publiques allemandes à 6 mois, à un taux d’intérêt nominal négatif, comme le signe d’une extrême défiance à l’égard des banques commerciales allemandes. La fragilité de cette économie, dans la zone euro, n’est pas moindre que celle de la France.
- Que faire désormais, en France par exemple ? La perte du AAA témoigne à la fois de perspectives négatives sur l’état des finances publiques et sur la croissance économique. Si l’Allemagne n’est pas dégradée, peut-être est-ce parce que sa stratégie non coopérative passée a été jugée efficace par S&P. Le principe de fixation d’une TVA sociale peut donc être envisagée comme un moyen de rattrapage de la compétitivité française par rapport à l’Allemagne, comme le souligne Jacques Le Cacheux (ici) : si les Allemands l’ont fait, pourquoi pas nous, désormais ? Cela permettrait d’augmenter les recettes fiscales, en renversant l’avantage de compétitivité au profit des entreprises résidentes françaises. Après qu’une telle mesure aura été prise, si elle l’est, l’Allemagne et la France se retrouveront sur un même pied d’égalité. Ces deux pays, et les autres Etats membres de la zone euro, pourront alors sainement envisager une politique coopérative de relance européenne. Politique industrielle (cf. Sarah Guillou et Lionel Nesta, ici), politique sociale, politique climatique et énergétique ambitieuse (cf. Eloi Laurent, ici), politique financière par l’instauration d’une taxe commune sur les transactions financières dont le produit servirait à éviter désormais que les banques privées soient renflouées par les contribuables, ce qui libérerait des marges de manœuvre pour les trois premières politiques : telles sont quelques options possibles. Leur contour reste certes à définir, mais réclamer qu’elles soient mises en œuvre d’urgence est devenue une nécessité.