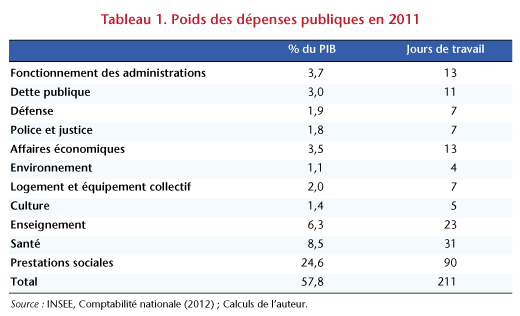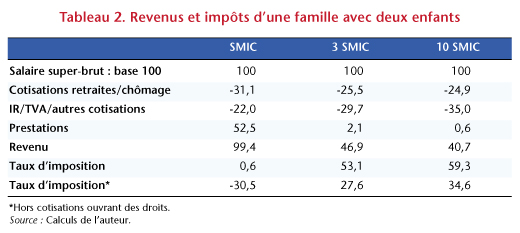Taxis vs VTC : la victoire du lobby contre l’innovation ?
par Guillaume Allègre *
L’affaire est entendue : en imposant aux voitures de tourismes avec chauffeur (VTC) un délai de 15 minutes entre la réservation et la prise en charge du client, le lobby des taxis aurait gagné une bataille contre l’innovation[1], réussissant ainsi à préserver une rente. C’est peut-être Nicolas Colin, inspecteur des finances et co-rédacteur d’un rapport sur la fiscalité de l’économie numérique, qui présente l’argument de la victoire du lobbying contre l’innovation de la façon la plus convaincante et divertissante (« Les fossoyeurs de l’innovation »).
Pour rappel, depuis quelques années, des start-up (Voitures jaunes, Uber, SnapCar, LeCab…) proposent des services de voitures avec chauffeur, réservables sur smartphone après téléchargement d’une application. Le service rendu semble apprécié par les clients de VTC : le prix est connu à l’avance, la voiture attend sans surcharge, on peut suivre la voiture commandée sur son écran, la course est prépayée. Face à ces nouveaux entrants, les taxis dénoncent une concurrence déloyale. En effet, non seulement la profession est très réglementée[2] mais ils doivent aussi payer une licence (230 000 euros à Paris, 400 000 euros à Nice en 2012) pour avoir le droit de stationner dans la rue et prendre des clients à la volée, seuls avantages qu’ils ont par rapport aux VTC depuis la déréglementation des VTC en 2009[3]. Or, à l’heure où la plupart des clients potentiels de services de taxis sont équipés de smartphone qui permettent la géolocalisation, on peut redouter que la valeur de ce droit supplémentaire (prendre les clients dans la rue qui lèvent le bras, plutôt que de se géolocaliser) s’effondre. Selon les sociétés de taxis, les VTC contournent ainsi l’esprit de la loi en pratiquant la réservation immédiate.
Il n’est pas inutile de rappeler à ce stade que le débat sur la réglementation des taxis ne date ni d’hier ni du rapport Attali pour la libération de la croissance. A Paris, les historiens font remonter les premiers services de « voitures de louage avec cocher » à 1612 (sur cette partie historique, voir « Régulation des taxis, a tale of two cities »). La première régulation date de 1657 lorsque Louis XIV accorde un monopole au Sieur de Givry. A Londres, la première réglementation date de 1635 et répond à la demande des bateliers qui dénonçaient une concurrence déloyale alors qu’ils avaient jusque-là un monopole de fait sur le transport de passagers entre la City et Westminster : le roi impose alors aux carrosses des courses de plus de trois miles (la distance entre la City et Westminster est de 2,3 miles). Depuis le milieu du XVIIème siècle, l’histoire des taxis à Paris et à Londres oscille entre réglementation et dérégulation, monopoles accordés et inventions de nouveaux services pour contourner ces monopoles : en 1664, Piquet de Sautour reçoit le monopole des calèches à un cheval ; en 1665, le Marquis de Crenan celui des « Chaises à la Crenan », véhicules légers à deux roues (Margairaz, cité par Darbéra). Disons qu’Uber et SnapCar ressemblent étrangement à ces chaises à la Crenan et autres calèches à un cheval.
Le meilleur rapport qualité/prix des VTC est-il dû à des gains de productivité liés à l’innovation ou au fait qu’ils n’ont pas à payer des licences de 230 000 euros (à Paris) ? Evidemment, on a toutes les raisons de penser qu’économiser 230 000 euros procure un net avantage économique. En revanche, les arguments en faveur de l’innovation sont assez faibles : les nouvelles technologies permettent la localisation des taxis, mais c’est également le cas des centrales radios, créées à Paris en 1964 par G7 et les compagnies de taxis n’ont pas attendu la concurrence des VTC pour utiliser les techniques de localisation en temps réel (La CNIL a été saisie de la question de la géolocalisation des employés par les sociétés de taxis dès 2004). Certaines compagnies de taxis proposent d’ailleurs le même service de commande d’un taxi en temps réel à l’aide d’une application pour smartphone. Enfin à Paris, les « innovations » dans les services de transports de passager incluent le retour de la propulsion humaine, ce qui relativise également leur caractère réellement innovant. Si les gains de productivité étaient réellement dus à l’innovation, les nouveaux entrants pourraient acheter les licences et remplacer les anciennes sociétés de taxis. Ils ne le feront pas parce que ni eux ni les centrales-radio ne veulent prendre le risque que les licences ne perdent leur valeur. Ils préfèrent que les artisans portent ce risque : il n’y a aujourd’hui que 37% de locataires ou salariés parmi les chauffeurs de taxis parisiens et on peut penser qu’une grande partie des détenteurs de ces licences les ont reçues gratuitement. D’un point de vue politique, cette structure est rationnelle : un gouvernement spoliera moins facilement un artisan-taxi qu’un actionnaire d’une société de taxi, à la fois pour des raisons de justice sociale et de pouvoir de nuisance.
Le discours sur l’innovation et la croissance sert ici de leurre pour masquer un classique conflit entre producteurs, qui veulent défendre leurs revenus, et consommateurs, qui veulent un service de taxi peu coûteux et disponible rapidement, y compris en heures de pointe. Ce conflit se double d’un non moins classique conflit entre détenteurs d’une licence ayant une valeur de rareté et nouveaux entrants, défenseurs de l’ouverture du marché. Dans ce paysage, l’alliance entre nouveaux entrants et consommateurs, qui ont aussi intérêt à l’ouverture du marché, paraît naturelle. Pour les détenteurs de licence, l’enjeu de ce conflit est d’autant plus important que le prix auquel la licence s’échange est élevé.
Ceci dit, la régulation actuelle pose problème. La limitation du nombre de licences de taxis a pour objectif de soutenir le revenu des taxis indépendants et d’éviter qu’ils travaillent trop d’heures par jour pour atteindre un revenu décent[4]. La régulation peut également se justifier pour des motifs de qualité minimale et de sécurité. C’est le Front Populaire, suite à la crise économique et à l’afflux de chômeurs dans le secteur, qui a réintroduit le contingentement de licences (le secteur était ouvert depuis 1865). Dans ces conditions, il est particulièrement absurde d’avoir permis que ces licences soient cessibles[5] et d’avoir laissé leur prix augmenter en ne délivrant pas de licences supplémentaires entre 1990 et 2002 (alors que, par exemple, dans le même temps, le nombre de passagers dans les aéroports de Paris a augmenté de 49%[6]). Permettre la cession des licences, c’est transférer l’avantage lié au contingentement des licences de taxis des chauffeurs de taxis aux propriétaires des licences, au détriment des nouveaux acquéreurs. En effet, pour le nouvel entrant dans la profession, l’avantage du contingentement est nul puisqu’il doit payer cet avantage au prix du marché. La régulation actuelle est d’autant plus aberrante que les nouvelles licences sont cédées gratuitement (sur liste d’attente) : si le préfet attribue gratuitement 1 000 nouvelles licences, c’est 230 millions d’euros au prix du marché qui seront transférés aux heureux gagnants.
Si la régulation actuelle est absurde, il serait injuste de spolier ceux qui viennent de dépenser une fortune pour acquérir une licence, par exemple en augmentant massivement le nombre de licences.
Une première solution consiste à racheter en une fois les licences cessibles au prix du marché et à attribuer de nouvelles licences non cessibles. Le coût d’une telle mesure serait colossal : il y a environ 17 500 licences à Paris, ce qui représenterait un coût total de 4 milliards d’euros.
Une autre proposition, avancée notamment par Trannoy, est censée augmenter le nombre de licences sans ruiner les acquéreurs récents. La préfecture attribuerait une licence à chaque détenteur actuel de licence, ce qui doublerait le nombre de licences en circulation ; la valeur des licences serait divisée par deux mais sans léser les propriétaires de licences qui conserveraient une et vendrait la deuxième. En première approximation, le patrimoine des chauffeurs de taxi resterait inchangé. Trannoy envisage même que les détenteurs de licence soient gagnants car le chiffre d’affaires global devrait augmenter. Cette solution a également l’avantage de ne rien coûter aux pouvoirs publics. Bref, elle ne ferait que des heureux et l’intérêt des taxis ne s’opposerait pas à celui des consommateurs. Il y a en fait une erreur de raisonnement dans la proposition de Trannoy : il suppose que la valeur de la licence est proportionnelle au chiffre d’affaires des taxis. A chiffre d’affaires global inchangé, un doublement des licences signifierait une division par deux du prix des licences. Ceci est faux : si on multiplie par dix le nombre de licences, elles ne vaudront plus rien et pas dix fois moins. La valeur de la licence est en fait proportionnelle au profit (qui provient du contingentement des taxis), ce qui fait une grande différence dans un secteur où le coût fixe est élevé et le coût marginal faible (rouler à vide ne coûte pas moins cher que rouler à plein)[7]. Bacache-Beauvallet et al. (2008) estiment par exemple à 35 000 euros le coût fixe de l’activité de taxi (salaire compris) et à 42%, l’augmentation du nombre de licences à Paris qui annulerait la valeur des licences[8]. Cette évaluation n’est pas aberrante : la valeur des licences en 1995, pendant la période de gel des attributions était beaucoup plus faible (60 000 euros[9]).
Que faire ?
Le problème ne se limite pas à la question du nombre de licences : au cours de la journée, il y a inadéquation entre offre et demande du fait d’une demande beaucoup plus importante en heures de pointe qui se conjugue, à Paris, avec un engorgement important, qui réduit la vitesse des taxis ou les bloque aux aéroports. La régulation doit également se préoccuper d’une meilleure adéquation entre offre et demande au cours de la semaine, en modulant encore plus la tarification selon l’heure et en incitant au développement du doublage de licence comme l’explique par exemple ce rapport (pdf).
Concernant les licences, la très forte augmentation de leur valeur traduit probablement une offre trop faible par rapport à la demande. L’objectif serait alors d’augmenter l’offre sans spolier les nouveaux acquéreurs. De plus, il serait préférable de sortir d’un système où l’on doit se préoccuper continuellement de la valeur patrimoniale des licences attribuées gratuitement. Une solution consiste à racheter les licences actuelles au fil de l’eau, non à leur valeur de marché mais à leur valeur d’acquisition majorée d’intérêts[10]. De nouvelles licences non cessibles seraient attribuées gratuitement. Leur nombre permettrait de maintenir le revenu net des nouveaux acquéreurs[11], en tenant compte d’un prélèvement sur le chiffre d’affaires (taxis plus VTC) qui financerait un fond de rachat des anciennes licences[12]. Ce système permet d’indemniser les acquéreurs récents, sans contribuer à l’enrichissement de ceux qui ont obtenu antérieurement une licence gratuitement ou à un prix très faible. Il permet la transition d’un système de licences cessibles à un système de licences non cessibles dans lequel le nombre de licences en circulation et la répartition du marché entre VTC et taxis dépend de la demande de services et non du pouvoir de nuisance des uns et des autres. Il est complexe mais il permet de détricoter les erreurs du passé de façon la plus équitable.
Il est toutefois peu probable qu’une telle solution soit mise en place. Par rapport au statu quo, elle fait de gros perdants dans l’immédiat : les détenteurs de licence qui espèrent réaliser une plus-value importante, notamment les chauffeurs les plus proches de la retraite. Les nouveaux acquéreurs de licence seraient probablement solidaires en espérant pour eux-mêmes une telle solidarité qui permettrait de maintenir le système actuel. Le risque pour eux est que le nombre de licences augmente au fil de l’eau et/ou que les VTC capturent une part croissante du marché malgré les contraintes qui leur sont imposées. Dans ce cas, la valeur réelle de leur licence pourrait diminuer petit à petit : les acquéreurs récents seraient perdants mais la perte ne serait actée que lorsqu’ils prendront leur retraite, dans 20 ou 30 ans. On peut toutefois penser que cette évolution ne se passera pas sans heurts.
———–
* L’auteur n’a reçu aucun financement, ni des compagnies de taxis, ni des compagnies de VTC.
[1] L’argument de l’innovation est abondamment repris par les VTC sur le mode « chandelles et ampoules électriques » : voir par exemple « #PourNePasFaireDeConcurrence ».
[2] Le chauffeur de taxi doit notamment être titulaire d’une carte professionnelle, le taximètre est obligatoire et les tarifs maximaux sont fixés par arrêté préfectoral.
[3] Avant 2009, l’activité de « grande remise », dont la spécialité est la mise à disposition de voitures haut de gamme avec chauffeur, uniquement sur commande et pour une destination définie, était soumise à une licence spéciale délivrée par le préfet, le représentant de l’entreprise devant également être titulaire d’un certificat d’aptitude à la profession d’entrepreneur de remise et de tourisme. La loi du 22 juillet 2009 a supprimé l’obligation de posséder une licence, ce qui a permis le développement des VTC.
[4] Du fait de coûts marginaux faibles et de coûts fixes élevés, le profit est négatif à l’équilibre concurrentiel en l’absence de régulation (« Valeur de licence et régulation du marché des taxis »). En pratique, cela signifie qu’en l’absence de régulation la rémunération des chauffeurs de taxi indépendants risque d’être inférieure au SMIC.
[5] Les licences peuvent officiellement être revendues depuis 1973.
[7] Prenons l’exemple extrême d’une activité où le coût marginal est nul et le coût fixe représente 2/3 du chiffre d’affaires : disons que le coût fixe est égal à 100 000 euros, le chiffre d’affaires de 150 000 euros, le profit est donc de 50 000 euros. Pour le propriétaire, la valeur de cette activité correspond aux profits futurs actualisés : elle est proportionnelle au profit. Si le chiffre d’affaires est réduit d’un tiers à 100 000 euros, le profit est annulé de même que la valeur de la propriété.
[8] Les auteurs utilisent un modèle théorique calibré. En réalité, le prix réel de la licence ne tomberait pas à zéro, notamment parce que les acteurs sur le marché pourraient anticiper la construction d’une nouvelle rente de rareté.
[9] Darbéra. A Dublin, la valeur de la licence de taxis est passée de 3 500 IEP en 1980 à 90 000 IEP en 2000, période de restriction de l’accès au marché (OCDE).
[10] Cette solution nécessite d’interdire la cession de ces licences sur le marché, ce qui était déjà le cas avant 1973.
[11] Généralement, les locataires et salariés.
[12] La valeur des licences a fortement augmenté dans les années 90 puis entre 2003 et aujourd’hui. Elle valait 60 000 € en 1995 (Darbéra), 90 000 € en 1999, 105 000 € en 2003 et 180 000 € en 2007 (voir annexe 9). Le prix de rachat des licences peut être estimé à 3 milliards d’euros (en tenant compte de l’évolution du prix de la licence de taxi entre 1993 et 2013, d’un taux d’intérêt nominal de 4% et d’un taux de rotation de 5%) : sur une période de 20 ans, il faudrait pouvoir dégager l’équivalent de 150 millions annuels (en euros 2013).