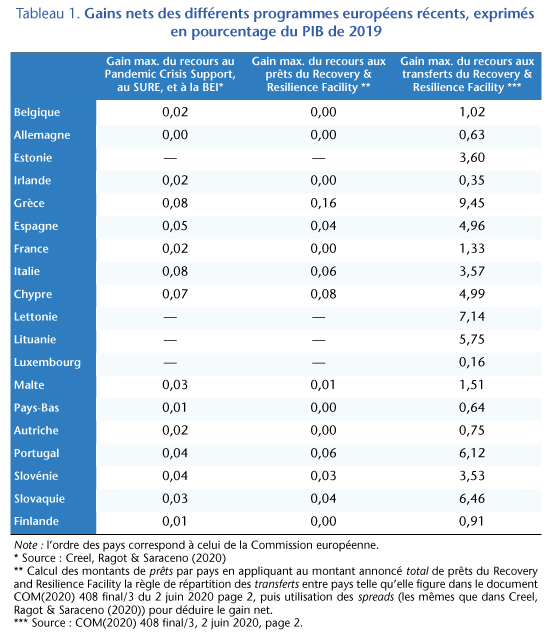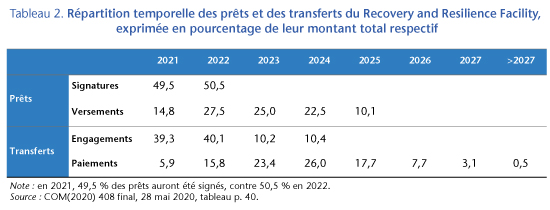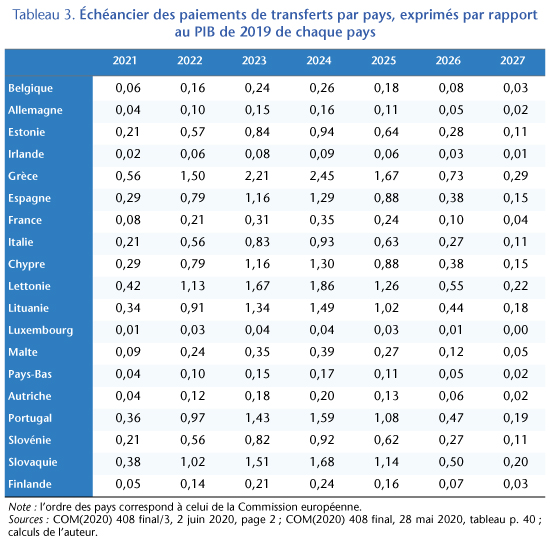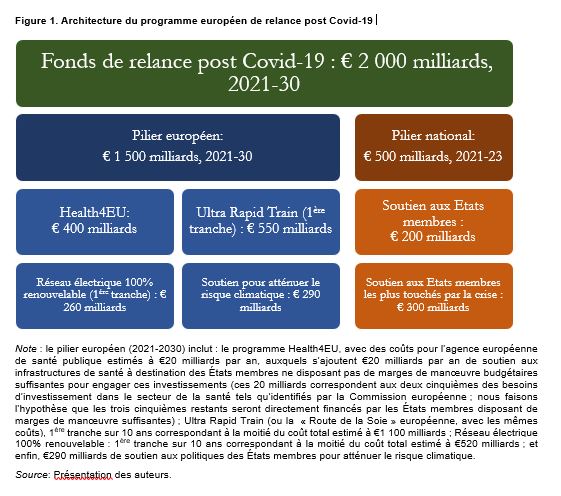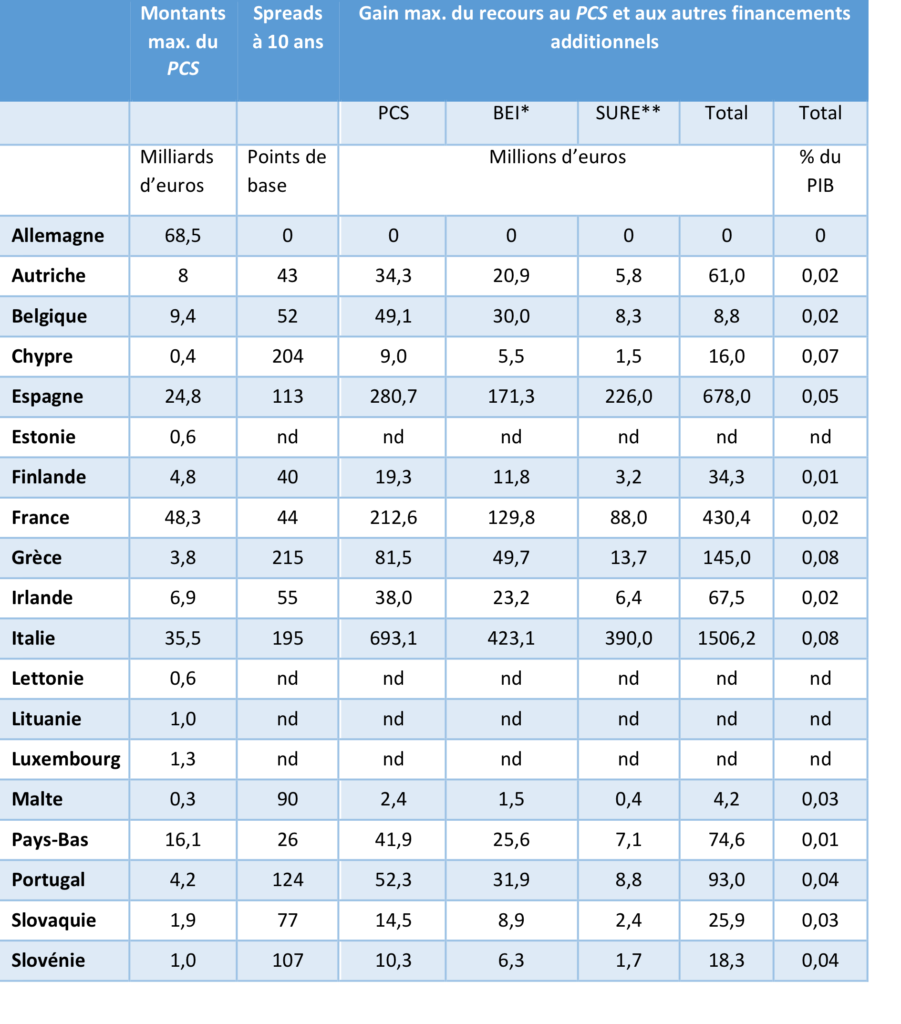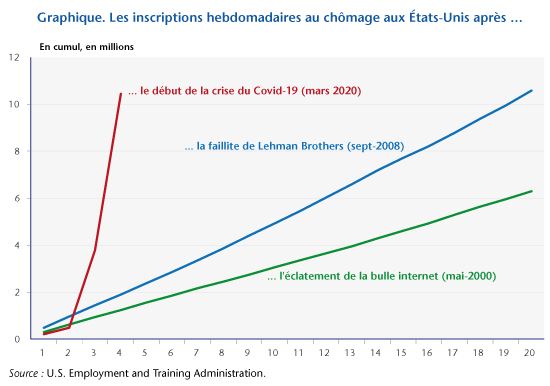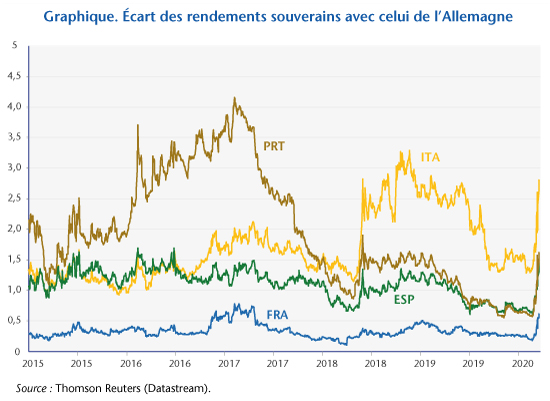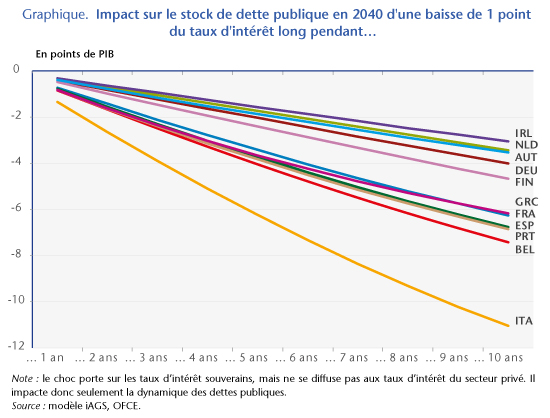par Catherine Mathieu et Henri Sterdyniak
Le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni
quittera donc l’Union européenne, 9 mois après la date du 31 mars 2019
initialement prévue, ce qui ne laisse que 11 mois pour aboutir à l’accord qui
devrait intervenir le 31 décembre prochain pour fixer les relations futures
entre l’Union européenne et le Royaume-Uni. Toutefois, cette période de
transition pourra être prolongée si les deux parties le décident conjointement,
avant le 1er juillet, et ce pour une période d’un à deux ans. Il
n’est pas totalement exclu que les négociations n’aboutissent pas d’ici la fin
de l’année ce qui pourrait conduire à un Brexit sans accord. Jusqu’au 31
décembre (et au-delà selon l’évolution des négociations), le Royaume-Uni restera
dans le marché unique et l’union douanière.
Les deux parties doivent en février
définir leurs lignes de négociations. Les négociations seront délicates. Le
Royaume-Uni doit choisir entre trois positions. Le soft Brexit supposerait que le Royaume-Uni se donne comme objectif
premier de maintenir ses liens avec l’UE27 ; le Royaume-Uni maintiendrait
les règlements qu’il appliquait en tant que membre de l’UE et les ferait évoluer
comme ceux de l’UE. Dans ces conditions, le commerce de marchandises et de
services entre le Royaume-Uni et l’UE27 ne connaitrait pas de barrières.
Cependant, le Royaume-Uni n’aurait gagné aucune des libertés souhaitées par les
partisans du Brexit en termes d’autonomie de sa réglementation ; il
devrait s’aligner sur des règlements sur lesquels il n’aurait pas son mot à
dire. Le Brexit n’aurait apporté qu’une certaine autonomie politique et le droit
de limiter l’immigration des européens.
Dans un scénario de hard Brexit, le Royaume-Uni
s’exonérerait totalement des règles européennes ; il pourrait entreprendre
un choc de libéralisation en matière de droit du travail, de réglementation des
produits ; il pourrait viser à devenir un paradis fiscal et réglementaire.
Dans ces conditions, l’Union européenne mettrait des barrières à l’entrée des
produits britanniques en commençant par la mise en place des droits de
douane selon les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), puis
progressivement des barrières non tarifaires (du fait de divergences des normes
et de règlementations) ; les échanges de services seraient limités (en
particulier, en matière financière). Le Royaume-Uni chercherait à compenser par
des accords avec les États-Unis et d’autres pays hors Union européenne (en
particulier, ceux du Commonwealth). Cependant, ce choc libéral ne
correspondrait pas aux attentes des électeurs des milieux populaires qui ont
voté pour le Brexit ; le Royaume-Uni resterait lié par les accords
internationaux (ceux de l’Organisation internationale du Travail (OIT), les accords
de Paris, les accords de Bâle III et de l’OMC) ; les accords commerciaux
extra-européens supposeront des concessions sans doute difficiles pour le
Royaume-Uni et ne pourront pas compenser entièrement la perte de l’accès
au marché européen.
Le scénario intermédiaire, de
compromis est sans doute le meilleur pour l’UE27 et le Royaume-Uni pris dans
leur ensemble. Il s’agit de faire des concessions réciproques afin de maintenir
des liens étroits entre l’UE27 et le Royaume-Uni, d’abord parce que le Royaume-Uni
est un débouché important pour l’UE27 (en 2018, les exportations de l’UE27 vers
le Royaume-Uni représentent 2,6% de leur PIB , avec un excédent commercial de
50 milliards d’euros, 0,35% du PIB ) ; ensuite, parce qu’avoir un paradis
fiscal et réglementaire à la porte de l’UE est dangereux (en obligeant soit à
s’aligner, soit à prendre des mesures de rétorsions). Il faut d’une certaine
manière que l’évolution future des règlements européens soit négociée avec le
Royaume-Uni, mais l’UE ne peut pas perdre son autonomie de décision et ne peut
accorder plus au Royaume-Uni qu’aux pays de l’Association européenne de
libre-échange (AELE : Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse).
La déclaration politique révisée signée
le 17 octobre 2019 par l’UE27 et le Royaume-Uni donne les grandes lignes des
futures relations entre le Royaume-Uni et l’UE27. Elle correspond à l’objectif
d’une relation forte, spécifique et équilibrée, le Royaume-Uni prenant un
certain nombre d’engagements réduisant le risque d’une stratégie fiscale et
réglementaire.
Ainsi, l’article 2 stipule que les
deux parties souhaitent maintenir des normes élevées en matière de droits du
travail et de protection des consommateurs et de l’environnement.
L’article 4 stipule d’une part que
l’intégrité du marché unique et les quatre libertés seront préservées, d’autre part
que le Royaume-Uni pourra mener une politique commerciale autonome et mettre
fin à la libre circulation des personnes entre le Royaume-Uni et l’UE27.
L’article 11 stipule que les deux parties
chercheront à coopérer et à agir en concertation, que le Royaume-Uni pourra
participer aux programmes de l’UE en matière de culture, d’éducation, de
science, d’innovation, etc. dans des conditions à négocier.
L’article 17 annonce la mise en place
d’un « partenariat économique ambitieux, large et équilibré », comportant un
accord de libre-échange. Mais l’article 20 reconnait que les deux zones
formeront des espaces économiques distincts, ce qui rendra nécessaires des
vérifications douanières. L’article 21 exprime la volonté de créer une zone de
libre-échange pour les marchandises, à travers une coopération approfondie en
matière douanière et réglementaire et des dispositions qui mettront tous les
participants sur un pied d’égalité pour une concurrence ouverte et loyale. Selon
l’article 22, les droits de douane seront évités et la règle d’origine sera
appliquée de « manière moderne et appropriée ». Une coopération en matière de normes techniques
et sanitaires facilitera l’entrée des produits britanniques dans le marché
unique, dans le respect de son intégrité.
L’article 27 annonce qu’en termes de services
et d’investissement, les parties devraient conclure des accords
ambitieux, complets et équilibrés, en respectant le droit de chaque partie à
réglementer. L’autonomie réglementaire nationale sera préservée, mais elle
devrait être transparente et compatible, dans la mesure du possible. Des
accords de coopération et de reconnaissance mutuelle seront signés sur les
services, notamment les télécommunications, les transports, les services aux
entreprises et le commerce sur Internet. La liberté de circulation des capitaux
et des paiements sera garantie. En matière financière, l’article 36 précise
l’objectif que des accords d’équivalence soient négociés avant la fin de juin
2020 ; une coopération sera établie dans le domaine de la réglementation et de
la surveillance. Les droits de propriété intellectuelle seront protégés,
notamment en ce qui concerne les indications géographiques. Des accords seront
signés sur le transport aérien, maritime et terrestre et l’énergie. Les deux
parties s’engagent à coopérer dans la lutte contre le changement climatique,
sur le développement durable, la stabilité financière et le protectionnisme.
Les possibilités de voyage pour des raisons touristiques, scientifiques et
commerciales ne seront pas affectées. Un accord sur la pêche devra être signé
avant le 1er juillet 2020.
Des dispositions devraient couvrir
l’aide publique, le maintien de normes de hauts niveaux, le droit au travail, la
protection sociale, l’environnement, le changement climatique et la fiscalité,
afin d’assurer une concurrence ouverte et équitable entre des acteurs placés
sur un pied d’égalité.
Le texte prévoit des organes de
coordination aux niveaux technique, ministériel et parlementaire. L’accord sera
géré par un comité mixte, chargé de résoudre les conflits qui pourraient
survenir. Un processus d’arbitrage peut être mis en place. Il devra se référer
à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’il s’agit d’une
interprétation du droit de l’Union, mais uniquement dans ce cas.
D’une part, le texte prévoit un
partenariat étroit et spécial, comme l’a demandé le Royaume-Uni ; d’autre part,
le Royaume-Uni s’engage à ne pas trop s’écarter des règles européennes ; enfin,
il reste des questions problématiques à négocier, comme les droits de pêche ou
l’autonomie de la politique commerciale britannique.
La
position du Royaume-Uni
Boris Johnson se donne comme priorité
une sortie effective du Royaume-Uni le 31 décembre 2020. Il espère aboutir à un
« Accord de libre-échange de première classe » avec « Zéro
Tarif, Zéro Quota ». Il engage des négociations en même temps avec
d’autres pays, en particulier les États-Unis, le Japon, le Canada… Par
ailleurs, il lance un ambitieux programme de sortie de l’austérité budgétaire
avec un programme pluriannuel de remise à niveau du système de santé
britannique, de l’aide à la dépendance, de l’éducation, des infrastructures en
particulier en Ecosse et au nord de l’Angleterre. Il propose de poursuivre la
hausse du salaire minimum (une hausse de 6 % vient d’être décidée pour
avril). Sa politique d’immigration visera à attirer au Royaume-Uni les
compétences nécessaires. Il maintient l’ambition britannique en matière de
lutte contre le changement climatique.
Boris Johnson et Sajid Javid, le chancelier de l’Échiquier, ont indiqué clairement qu’ils ne
souhaitaient pas de prolongation de la période de transition, que le
Royaume-Uni ne serait pas suiveur, qu’il aura sa propre politique commerciale
et ses propres réglementations.
Cependant, les accords avec les pays
tiers n’aboutiront pas facilement. Ceux-ci demanderont des concessions du
Royaume-Uni. Les États-Unis veulent pouvoir exporter des produits agricoles et
prendre pied dans les services publics (santé, éducation). Donald Trump a déjà menacé
le Royaume-Uni de sanctions s’il taxait les GAFA.
La
position de l’UE
L’UE 27 a désigné Michel Barnier comme le responsable de la
négociation avec le Royaume-Uni quant aux relations futures avec l’UE. La
Commission européenne adoptera des directives de négociations complètes et
préliminaires le 3 février. Ces directives seront soumises à l’accord d’un Conseil des
affaires générales, dont la prochaine réunion se tiendra le 25 février. L’UE
souhaiterait que la période de transition soit prolongée pour permettre
d’aboutir à un accord complet. L’intention est de négocier un accord de
partenariat global unique, avec la possibilité de le compléter ultérieurement.
La possibilité d’une sortie sans accord n’est pas écartée.
Un mandat de négociation sera donc donné à Michel Barnier. Le
risque est grand de reproduire la même stratégie que dans la première phase de
négociation de la sortie du Royaume-Uni de l’UE. Dans une interview accordée le
26 janvier 2020 au Journal du Dimanche[1],
Michel Barnier réaffirme que « nous défendrons notre identité et nos
valeurs ; « nous ne prendrons pas le risque de fragiliser le marché
unique ». Il rappelle que c’est le Royaume-Uni a demandé le divorce ;
que l’UE est en position de force puisque le commerce entre l’UE et le Royaume-Uni
est beaucoup plus important pour le Royaume-Uni que pour l’UE ; qu’un pays
à l’extérieur du marché unique ne peut avoir les mêmes avantages qu’un pays
membre. Ce discours ne peut que rendre plus tendues les négociations. Michel
Barnier souligne déjà que la demande du Royaume-Uni d’une libre entrée des
marchandises britanniques dans le marché unique suppose, d’une façon ou d’une
autre, que l’UE ait un droit de regard sur les réglementations britanniques : « zéro tarif, zéro quota, zéro dumping ».
Douze textes publiés par la Commission européenne les 14 et 20
janvier lors de séminaires de travail précisent déjà les objectifs de l’UE. L’UE
prétend empêcher le Royaume-Uni de bénéficier d’un avantage concurrentiel
déloyal en réduisant les réglementations en matière de concurrence, de droits
du travail, d’aides d’État, de fiscalité. Elle veut à la fois un accord sur ces
points, des mécanismes de règlement des différends et la possibilité d’agir de
façon autonome si les engagements ne sont pas respectés. Le Royaume-Uni doit
s’engager à ne pas abaisser ses normes de droit du travail et de protection
sociale pour des motifs de compétitivité et d’attractivité. Il doit lutter
contre les pratiques d’optimisation fiscale. L’UE insiste sur le fait que les
deux zones seront des économies distinctes, ce qui implique la fin de la libre
circulation, la nécessité de contrôles douaniers, la fin de la reconnaissance
automatique mutuelle des réglementations (en particulier en matière de services
financiers), le refus de la négociation des régulations (le pays importateur
doit se plier aux règles de l’UE).
La question de la pêche fait partie des questions prioritaires
pour plusieurs pays de l’UE27 (dont la France). L’UE27 souhaite conserver les droits d’accès
de ses pêcheurs dans les eaux britanniques et maintenir une gestion commune des
ressources halieutiques. La tenue en
parallèle de négociations sur la pêche et sur les services financiers (où les
Britanniques sont demandeurs) d’ici le 1er juillet suggère qu’un
compromis sera cherché sur ces deux secteurs.
Notons que la position de l’UE serait plus forte si elle s’appliquait
aussi aux pays membres, en luttant contre la concurrence fiscale de l’Irlande,
la tolérance de l’optimisation fiscale des Pays-Bas et la concurrence sociale
de certains nouveaux pays membres.
La
situation économique du Royaume-Uni
Le Brexit (qui n’a pas encore eu lieu)
n’a jusqu’à présent pas eu de conséquences catastrophiques pour l’économie
britannique. La croissance a été de 1,15 % (en glissement sur un an second
semestre 2019), proche de celle de la zone euro (1,2 %). Le taux d’inflation (en
glissement annuel en 2019) s’est stabilisé à 1,3% (1 % en zone euro). Fin 2019
le taux de chômage a baissé à 3,7% (contre 7,5% pour la zone euro). Avec la
victoire de Boris Johnson, la livre s’est stabilisée aux alentours de 1,18
euros, ce qui est au-dessus de sa valeur moyenne depuis le référendum. Le taux
directeur de la Banque d’Angleterre se situe à 0,75%, le taux à 10 ans à 0,55%
ce qui est modérément expansionniste, compte-tenu d’une croissance en valeur de
l’ordre de 2,5%. Le solde public était déficitaire de 2,2% du PIB en 2018 ;
le gouvernement britannique pourrait renoncer à l’objectif d’un solde équilibré
à moyen terme et même d’un solde inférieur à 2% du PIB, pour privilégier une
relance des dépenses publiques ; toutefois la marge est limitée. Par contre, le Royaume-Uni a toujours un
déficit extérieur de l’ordre de 4,5% du PIB.
Selon les prévisions de janvier 2020 du
Fonds monétaire international (FMI), la croissance britannique serait un peu
plus forte en 2020 et 2021 (1,4 % puis 1,5%) que celle de la zone euro (1,3 % puis
1,4 %). Sans attacher trop d’importance à des différences minimes de
pourcentage, on constate cependant que les scénarios d’effondrement sont
écartés, et donc implicitement de hard Brexit[2],
et que de nombreux observateurs font confiance à Boris Johnson, comptent sur
son pragmatisme et son dynamisme dans les négociations avec l’UE, et sont aussi
confiants dans l’activisme de son programme de relance
Beaucoup dépendra des négociations qui
vont s’engager à partir de février. Il est probable (et souhaitable) qu’un
compromis soit trouvé, autorisant, mais limitant, une certaine prise de
distance du Royaume-Uni par rapport aux normes de l’UE, distance qui sera
limitée par les accords internationaux et le réalisme de Boris Johnson. L’article
« Brexit:
What economic impacts does the literature anticipate? », présente
une revue de littérature des évaluations des impacts du Brexit. Le champ des
possibles est grand. Selon le NIESR[3],
le projet d’accord de libre-échange de Boris Johnson aurait un impact de -3,5
points à long terme sur l’économie britannique, ce qui est un chiffre moyen des
estimations, dans le cas d’une sortie avec accord de libre-échange. Une double
incertitude demeure, à la fois sur l’impact macroéconomique de la sortie, de
l’autre sur la capacité de trouver un accord entre un pays qui veut retrouver
son autonomie et une zone qui conditionne l’accord à la soumission à ses règles.
[1] voir :
« Nous ne
nous laisserons pas impressionner ».
[2] Dans la prévision
d’octobre 2019 de l’OFCE, l’impact d’une sortie sans accord le 31 octobre
2019 sur le PIB britannique était estimé à -2,8 % à l’horizon 2021 et -4,5 % à
l’horizon 2033, sur la base d’une simulation
réalisée avec le modèle NiGEM.
[3] Hantzsche,
A., et G. Young. (2019). The Economic Impact of Prime Minister Johnson’s New
Brexit Deal. National Institute Economic Review, 250, F34-F37.