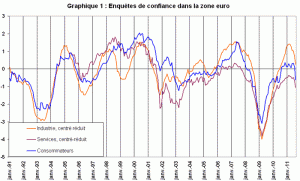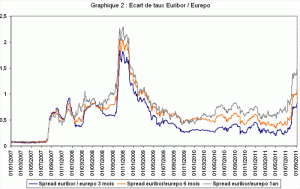Le double mandat, la Fed et la BCE
par Jérôme Creel et Francesco Saraceno
La Réserve fédérale américaine a lancé depuis le 21 septembre 2011 l’opération Twist de réallocation de son bilan pour réduire les taux d’intérêt de long terme. Cet activisme américain contraste une nouvelle fois avec la prudence affichée par la Banque centrale européenne. Le 7 septembre 2011, un banquier central américain déclarait qu’un taux de chômage de 9% aux Etats-Unis était aussi grave que le serait un taux d’inflation de 5%. Il en concluait que la politique monétaire américaine devait lutter en priorité contre le chômage. Nous pensons que ceci devrait être encore plus vrai pour l’économie de la zone euro et nous amener à réfléchir au mandat de la BCE.
La Réserve fédérale américaine a lancé depuis le 21 septembre 2011 l’opération Twist d’échange d’obligations publiques à court terme contre des obligations publiques à long terme pour un montant de 400 milliards de dollars. Cette stratégie de réallocation du bilan de la Fed vise à réduire les taux d’intérêt de long terme. Cette décision est conforme, dans son esprit, aux récents propos du Président de la Fed de Chicago.
Le discours de Charles Evans, le 7 septembre dernier, est en effet digne de notre attention, pour au moins deux raisons. La première est qu’il signale qu’aujourd’hui, en dépit de l’enlisement des Etats-Unis dans la crise, avec la persistance du chômage et la menace d’une nouvelle phase de récession, l’attention est encore excessivement portée sur l’inflation et les déficits publics plutôt que sur toute forme d’action qui permettrait de contrecarrer la crise en menant une politique économique proportionnelle à son ampleur. Charles Evans explique, en utilisant une fonction-objectif de la Fed et une loi d’Okun, qu’un taux de chômage de 9% de la population active aux Etats-Unis est tout aussi inquiétant qu’un taux d’inflation de 5% : l’écart de 3 points à chacune des deux cibles – un taux de chômage « naturel » de 6 % (qu’il qualifie d’hypothèse conservatrice, le taux de chômage devrait descendre en deçà si les Etats-Unis récupéraient les 8 points de croissance perdus pendant la crise) ou un taux d’inflation de 2% (là aussi, une hypothèse conservatrice) – est tout à fait comparable dans un pays, les Etats-Unis, qui n’impose pas de hiérarchie entre les deux objectifs d’inflation et de croissance (plus précisément d’inflation et du nombre d’emplois maximum, voir ici). Charles Evans poursuit en rappelant que le taux de chômage aux Etats-Unis a effectivement atteint un écart de 3 points à sa cible, mais pas l’inflation… Et d’affirmer : « So, if 5% inflation would have our hair on fire, so should 9% unemployment ». Ceci porte Evans à considérer que l’objectif d’inflation, légitime à moyen terme, n’est pas prioritaire ; il convient donc d’accentuer le caractère expansionniste de la politique monétaire par des moyens conventionnels ou pas, même au prix d’une flambée des prix à court terme (qui reste peu vraisemblable dans une économie en crise).
La deuxième raison qui nous pousse à nous intéresser à ce discours est le rapprochement, ou plutôt le grand écart, avec les politiques européennes. En effet, en lisant ce discours et en observant les actions de la Fed, le contraste avec le discours et les actions de la BCE est saisissant. Les difficultés de la BCE à mener une politique appropriée à l’état de la zone euro découlent d’une approche par trop orthodoxe de la politique monétaire, n’en déplaise à certains membres démissionnaires de la BCE, qui trouve sa justification fondamentale dans le Traité sur l’Union Européenne, où la priorité est donnée à l’inflation plutôt qu’à la croissance (les articles 119 par. 2 et 127 par. 1). Ceci porte la BCE à négliger l’objectif de croissance, à le minimiser ou, quand les circonstances le requièrent inévitablement (en phase de récession ou de croissance molle) à le poursuivre de façon non transparente, donc inefficace. Nous en voulons pour preuve la nouvelle initiative conjointe entre, notamment, la Réserve fédérale et la BCE en faveur de la liquidité bancaire en dollars, sans modification du taux d’intérêt directeur. Les atermoiements de la politique monétaire européenne entre 2007 et 2008, au chevet des banques privées, certes, mais n’impulsant pas, à cause de la hausse des prix des matières premières sur laquelle la BCE n’a aucune prise, une politique monétaire active pour soutenir une activité qui se détériorait, ne devraient pourtant pas se reproduire dans les circonstances actuelles. L’inflation sur les prix à la consommation dans la zone euro en juillet 2011 est proche de la cible de moyen terme que s’est imposée la BCE (2,5%), et cette inflation est tirée à la hausse par les prix des matières premières (énergie, café, thé, cacao), par leur répercussion sur les prix de certains services (transport), et par des produits servant d’assiette à des taxes que les gouvernements ont coutume d’augmenter pour tenter de rétablir un semblant d’équilibre de leurs finances publiques (tabac). In fine, le taux d’inflation hors énergie et produits alimentaires transformés s’établissait en juillet 2011 à 1,5%. Le taux de chômage dans la zone euro est, pour sa part, de l’ordre de 10% de la population active. Pour paraphraser Charles Evans, on peut affirmer qu’une inflation de 5% ferait certainement se dresser les cheveux sur la tête des banquiers centraux européens, et nous en sommes loin, fort heureusement, mais tel devrait être aussi le cas lorsque le taux de chômage atteint 10% de la population active !
Le grand écart entre la volonté expansionniste d’un responsable de la Fed et la politique prudente de la BCE, dans des circonstances économiques comparables (les écarts des taux d’inflation et de chômage à leurs cibles respectives sont peu ou prou les mêmes), trouve un parallèle lui aussi saisissant dans les discours et les actions de politique budgétaire de part et d’autre de l’Atlantique. Alors que les débats européens portent quasi inéluctablement vers l’imposition de contraintes additionnelles sur les politiques budgétaires des pays de la zone euro (adoption de « règles d’or » en Allemagne, en Espagne, litanie de plans d’austérité budgétaire, le dernier en date en Italie), la nécessité de pouvoir compter dans la zone euro sur un instrument fort de politique économique repose exclusivement sur la BCE. Tel n’est d’ailleurs pas forcément le cas aux Etats-Unis où le gouvernement fédéral propose un nouveau plan de relance de l’économie à court terme, assorti d’un redressement des finances publiques à un horizon de 10 ans. Le discours de Charles Evans devrait être celui de Jean-Claude Trichet, mais nous en sommes loin. A camper sur le caractère impeccable de l’action passée de la BCE (voir la critique toute en nuances de Paul Krugman), le Président de la BCE, lorsqu’il s’exprime, ne semble pas prendre la mesure de sa responsabilité sur les performances futures de la politique qu’il mène aujourd’hui. S’il ne parvient pas à aller de l’avant pour soutenir l’activité, dans une phase d’inflation basse, il faudra revoir la gouvernance de l’euro. Deux choix cruciaux pour l’avenir sont possibles. L’euro pourrait disparaître, ce qui n’est pas sans poser de graves difficultés (voir le billet de Jean Pisani-Ferry à propos de la Grèce, dont les conclusions peuvent être élargies à tous les pays de la zone euro, l’Allemagne compris) et doit donc être fermement écarté. Le statut du système européen des banques centrales de la zone euro pourrait être modifié pour donner égale dignité aux objectifs de croissance économique et d’inflation, sur le modèle de la Fed. Les performances de celle-ci autorisent à minimiser les craintes d’une explosion inflationniste.