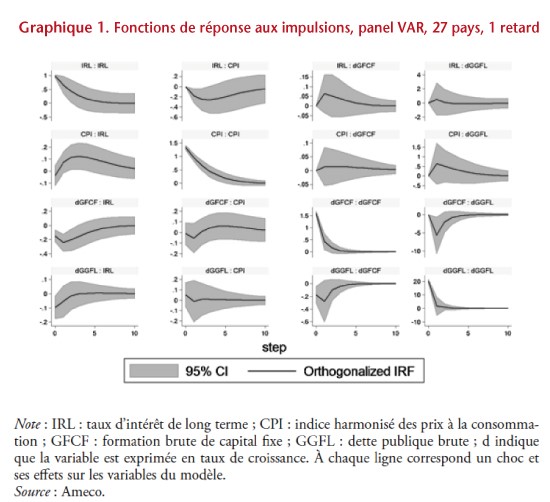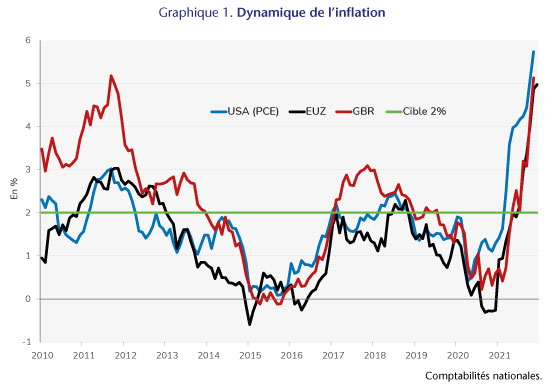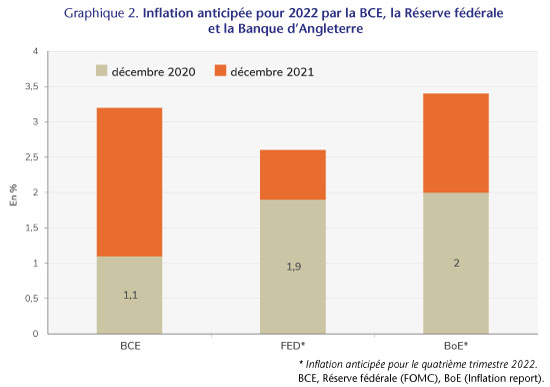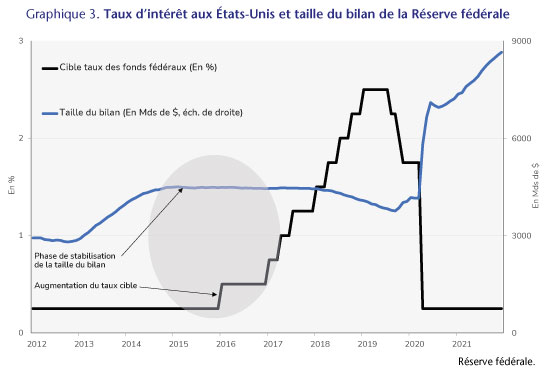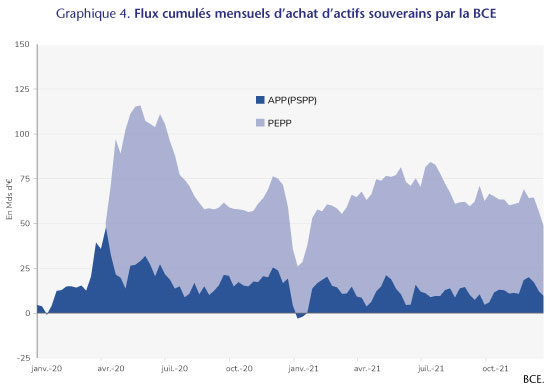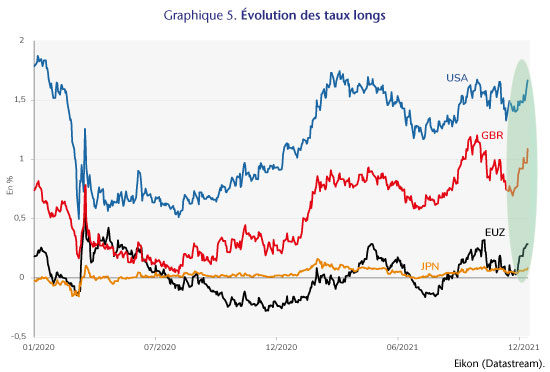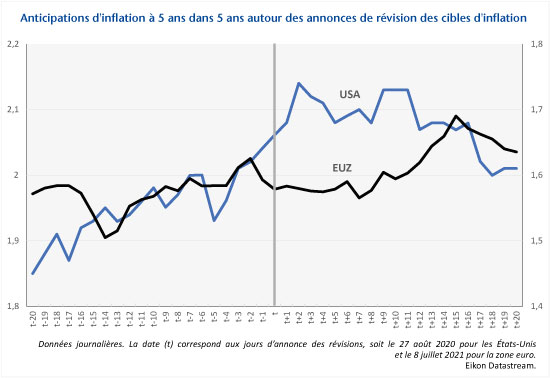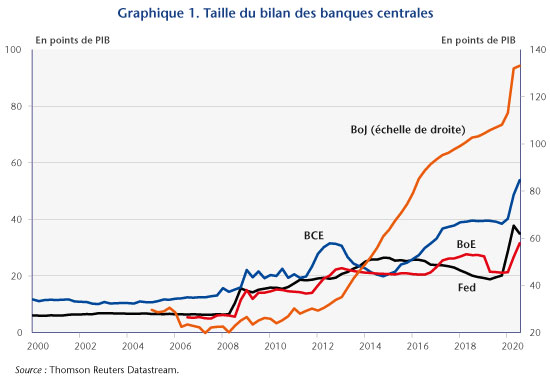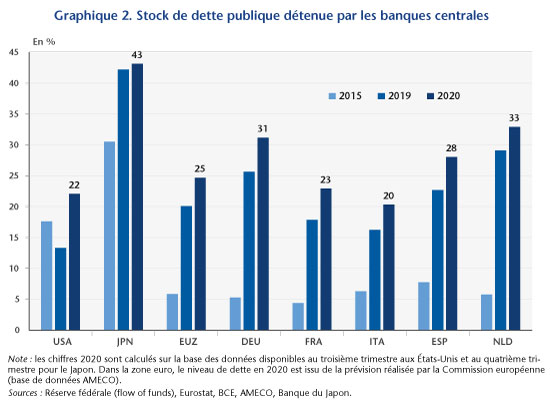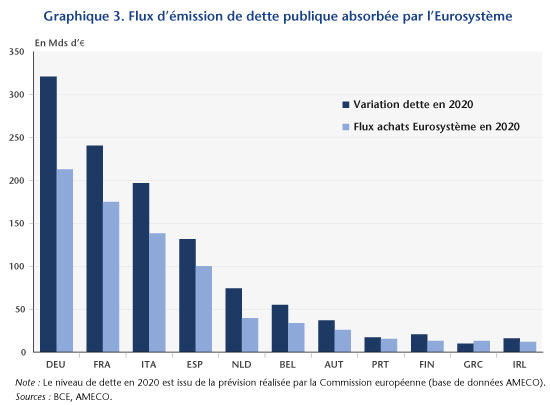Henri Sterdyniak
Le 9 novembre 2020, dans la collection Policy Brief de l’OFCE, Christophe Blot et Paul Hubert ont publié un document intitulé : « De la monétisation à l’annulation de la dette publique, quels enjeux pour les Banques centrales ? ». Ils comparent les effets de l’assouplissement quantitatif (Quantitative Easing, QE) et de la monétisation des dettes publiques et concluent : « La monétisation serait probablement plus efficace que le QE pour la stabilisation de la croissance nominale ». Nous nous proposons ici de revenir sur cette conclusion, en développant trois points : le concept de monétisation n’a pas grand sens, dans une économie financière moderne où la masse monétaire est endogène ; la comparaison faite par les auteurs est faussée puisque, sous le nom de QE, ils analysent l’impact d’achats de titres publics par la Banque centrale, à politique budgétaire donnée, tandis que sous le nom de monétisation, ils incluent à la fois l’effet d’une politique budgétaire plus expansionniste et celui de l’achat par la Banque centrale de titres publics perpétuels à coupon zéro ; enfin, et surtout, ces titres perpétuels à coupon zéro auraient une valeur nulle, de sorte que ce que les auteurs nomment monétisation est équivalent à l’annulation des dettes publiques détenues par la Banque centrale, une opération comptable fictive, qu’ils critiquent à juste titre.
Faut-il rappeler la conjoncture
actuelle ? En 2020, les administrations françaises vont pouvoir émettre,
sans difficultés, pour environ 400 milliards d’euros de titres à un taux moyen
légèrement négatif ; elles vont garantir plus de 120 milliards de prêts
aux entreprises ; la dette publique va atteindre 120 % du PIB, sans aucune
tension sur les taux d’intérêt. En faire plus par une prétendue monétisation
n’est pas une question qui se pose réellement.
Définir
la monétisation
Faisons un
détour par rapport au texte sous-revue. Traditionnellement, on écrit qu’il y a
monétisation de la dette publique, si celle-ci est détenue sous forme
monétaire, soit à l’actif de la Banque centrale (en contrepartie de M0, définition
stricte de la monétisation), soit à l’actif du système bancaire (en
contrepartie de M3, définition large de la monétisation)[1].
Quelle est la signification concrète de la monétisation dans une économie
financière où la monnaie est endogène[2],
où la définition de la masse monétaire est floue, où la Banque centrale fixe le
taux de refinancement des banques et garantit le placement de la dette publique[3] ?
Supposons
donc que l’État fasse une politique expansionniste ; par exemple, qu’il verse
10 milliards aux ménages. La Banque centrale ne va pas imprimer 10 milliards de
billets supplémentaires, que les ménages ne voudraient pas détenir. Le Trésor
va créditer les comptes bancaires des ménages de 10 milliards, ce qui veut dire
que les banques auront 10 milliards de dépôts supplémentaires et donc que leur
refinancement à la Banque centrale pourra diminuer de 10 milliards (ou que leurs
dépôts auprès de la Banque centrale pourront augmenter de 10 milliards). Le
lendemain, le Trésor va émettre pour 10 milliards de titres. Ces titres seront
obligatoirement achetés par les Spécialistes en Valeur du Trésor (SVT), dont
c’est le rôle, d’autant plus qu’ils ont la garantie de pouvoir se refinancer
auprès de la Banque centrale. Les ménages choisiront de placer ces dix
milliards dans les divers placements disponibles ; par exemple, 1 milliard
de billets supplémentaires, 1 milliards de dépôts à vue, 2 milliards de dépôts
à terme, 2 milliards d’OPCVM monétaires, 2 milliards d’OPCVM obligataires, 2
d’assurances. Les SVT pourront donc placer 6 milliards de titres dans des OPCVM
ou des sociétés d’assurances ; les banques détiendront 4 milliards de
titres et recevront 3 milliards de dépôts supplémentaires ; elles pourront
diminuer de 1 milliard leurs réserves à la Banque centrale. La dette publique aura augmenté de 10
milliards, la masse monétaire au sens M0 aura
augmenté de 1 milliard, la masse monétaire au sens M1 de 3 milliards ;
au sens M3 de 6
milliards[4].
Le financement monétaire de la dette publique sera resté stable (si on
considère l’actif de la Banque centrale) ; il aura augmenté de 6 milliards
(si on considère la monnaie au sens M3). Il y a monétisation au sens large, mais pas au sens strict.
Que
signifierait un financement monétaire, au sens d’un financement par la Banque centrale ?
En mettant en œuvre un QE, celle-ci achèterait aux banques pour 10 milliards
d’obligations publiques sur le marché secondaire. Cela ne changerait rien a priori aux choix de placement des
ménages. Simplement, les réserves des banques augmenteraient de 10 milliards ou
leurs refinancements diminueraient de 10 milliards. La dette publique aura
toujours augmenté de 10 milliards, la masse monétaire M3 de 6
milliards. On peut dire que le financement monétaire de la dette publique a
augmenté de 10 milliards (si on considère l’actif de la Banque centrale, il y a
bien monétisation au sens strict) ou de 6 milliards (si on considère la monnaie
au sens M3).
L’impact
macroéconomique de la distribution de ces 10 milliards sera a priori le même, avec ou sans QE : il
dépendra de l’usage que les ménages feront ultérieurement de ces 10 milliards. La
Banque centrale fixe le taux d’intérêt du refinancement en fonction de l’inflation
et de l’activité ; ce taux n’augmentera que si la politique budgétaire
(ici, à travers l’emploi de ces 10 milliards) est inflationniste ou
expansionniste. Il n’y a guère de raison qu’un type de financement soit plus
inflationniste (ou plus expansionniste) qu’un autre. L’important, c’est la
dépense publique, pas la hausse de la masse monétaire. D’ailleurs, plus les
ménages épargnent, plus la masse monétaire (au sens M3) augmente,
plus l’effet expansionniste, donc inflationniste de la politique budgétaire est
faible.
Le QE, ou la
monétisation ainsi définie, ne réduit pas la dette publique ; il ne réduit
pas a priori le montant des intérêts
que l’État devra verser. Avec ce financement monétaire, la Banque centrale doit
verser des intérêts sur les réserves des banques ; l’État doit donc
continuer à payer des intérêts sur sa dette détenue par la Banque centrale[5].
Il y a,
cependant, quelques différences. Les réserves des banques seront plus élevées,
ce qui peut inciter les banques à développer leurs crédits ; c’est favorable si
effectivement la politique monétaire veut être expansionniste ; c’est dangereux
si le crédit s’emballe : le montant des titres publics détenus par la
Banque centrale ne doit pas fragiliser son contrôle de la distribution du
crédit.
L’ensemble « Banque
centrale + État » sera endetté en net auprès des banques, donc au taux du
refinancement des banques ou au taux de rémunérations des dépôts des banques à
la Banque centrale, et non plus à des taux monétaires ou obligataires. C’est en
fait pratiquement équivalent si les taux obligataires reflètent bien les taux
monétaires futurs, si le taux de rémunération des dépôts des banques est proche
du taux auquel l’État s’endette à court terme (comme le 16 novembre 2020, où le
taux des dépôts des banques à la Banque centrale est de -0,5%, tandis que l’État
émet des bons à 1 ans à -0,65%). Notons que l’on ne peut comparer le taux de
refinancement et un taux obligataire sans tenir compte de la différence de
durée des titres : une obligation à 20 ans à taux 0,3% pet sembler plus
coûteuse qu’un titre à 6 mois à -0,5% ; mais elle protège contre la
remontée des taux d’intérêt. Par ailleurs, si les taux d’intérêt sont nuls à l’instant
T, la Banque Centrale doit payer à leur prix de marché (supérieur à leur valeur
facial) des titres émis il y a 5 ans au taux 3% par exemple, de sorte que ces
titres lui rapportent bien 0% : Il n’a a pas de gain pour l’ensemble
« Banque centrale + État » à racheter d’anciennes obligations.
La Banque
centrale acquiert des taux longs en échange de dépôts à court terme. Elle
assume donc le risque de remontée des taux d’intérêt. En sens inverse, la
baisse de l’offre de titres longs peut provoquer une baisse des taux longs,
mais l’effet est sans doute faible (il n’y guère d’études empiriques qui
trouvent un lien entre le niveau des taux longs et celui de la dette publique).
Cette baisse pourrait développer la demande de crédit.
Par ailleurs,
l’achat de titres par la Banque centrale rappelle que les pays qui ont conservé
leur souveraineté monétaire (une dette publique libellée en leur monnaie,
garantie par leur banque centrale) ne peuvent pas être en situation d’être
obligés de faire défaut. Il évite donc les tensions sur les marchés financiers,
ce qui peut contribuer à faire baisser les taux d’intérêt de long terme. L’effet
est sans doute négligeable pour les pays où la garantie des dettes publiques
par la Banque centrale ne pose pas problème (États-Unis, Royaume-Uni,
Japon) ; il peut jouer pour les pays fragiles de la zone euro.
La Banque
centrale, garante de la monnaie, a en fait trois tâches : veiller à
l’équilibre macroéconomique en ciblant, en priorité, le niveau d’inflation, en
second lieu le niveau d’activité ; contrôler le système bancaire ;
assurer le financement des déficits publics et garantir la dette publique. Dans
ce dernier rôle, si elle ne peut financer une partie importante de la dette
publique, elle doit intervenir quand ce financement pose problème. La
monétisation (au sens strict) peut éviter que certains États aient des
difficultés ponctuelles à se financer, doivent payer des taux d’intérêt trop
élevés lors de certaines émissions.
Une définition spécifique, une proposition irréaliste
Les auteurs
introduisent une définition originale de la monétisation (page 2). Celle-ci
doit se traduire par « i) une économie d’intérêts payés par le gouvernement, ii) une création
de monnaie supplémentaire iii) de façon permanente et iv) pouvant
se traduire par un changement implicite de l’objectif des banques centrales ou
de leur cible d’inflation ». Mais nous venons de voir que la
monétisation, même au sens strict, ne réduit pas directement les intérêts payés
par l’ensemble « Banque centrale +État », même si elle peut le faire
indirectement en diminuant les taux d’intérêt sur les titres de long terme ;
qu’elle n’augmente pas directement la masse monétaire (mais, augmenter la
masse monétaire est-il un objectif ?). Par ailleurs, aucune opération
financière n’est permanente par nature. Déterminer si la Banque centrale
européenne (BCE) a changé d’objectif depuis 2008 ou si elle a seulement changé
de mode opératoire pour s’adapter à une nouvelle situation n’est guère possible.
De sorte que les auteurs n’ont aucun mal à montrer que le QE n’est pas une
monétisation selon leur définition, mais cette définition originale est-elle
pertinente ?
Page 11, les
auteurs proposent donc une vraie
monétisation : « Le gouvernement, en contrepartie d’un ensemble de
mesures budgétaires, émettrait une obligation perpétuelle à coupon zéro,
achetée par les banques commerciales. La dette n’aurait aucune obligation de
remboursement ou de paiement d’intérêt. La banque centrale achèterait ensuite
la dette aux banques commerciales, qui serait conservée dans le bilan. Ainsi,
à la différence du QE, la mesure est associée à une politique budgétaire qui
se traduit par des transferts monétaires directs en faveur de certains agents.
La dette émise n’est pas exigible et a pour contrepartie une création de
monnaie directement utilisable par les agents non financiers ». Trois
remarques s’imposent :
- La comparaison est faussée puisque les auteurs analysent le QE en
supposant que la politique budgétaire est inchangée tandis que, pour la
monétisation, ils analysent l’impact à la fois d’une politique budgétaire plus
expansionniste et de son financement par la Banque centrale. C’est un artefact,
que d’écrire, page 14 : « Puisque la monétisation s’accompagnerait
d’un transfert fiscal aux ménages ou aux entreprises, il en résulterait un
effet plus direct sur les dépenses, ce qui différencie cette stratégie de celle
du QE qui stimule la demande par son effet sur les prix d’actifs au risque
d’alimenter une bulle financière ». C’est oublier que les titres que la
Banque centrale achète par le QE ont eux-mêmes financé des dépenses publiques
qui, elles, ont un effet direct sur la demande de biens et services et sur la
masse monétaire.
- Les auteurs imaginent que le Trésor émettrait une obligation
perpétuelle à coupon zéro, que les banques achèteraient, mais la valeur de
marché d’une telle obligation (la somme actualisée des intérêts et du
remboursement) serait nulle. Peut-on imaginer que les banques commerciales,
puis la Banque centrale, accepteraient d’acheter pour 1 milliard (par exemple)
des obligations qui auraient certes une valeur faciale de 1 milliard, mais une
valeur de marché nulle ? Que la Banque centrale inscrirait dans son bilan
1 milliard pour une obligation de valeur nulle[6] ,
ce qui serait contraire aux principes de la comptabilité ?
- Le bilan de la Banque
centrale serait déséquilibré puisque la contrepartie de la détention de ces
obligations serait un endettement auprès des banques commerciales. Certes, cela
n’a guère d’importance aujourd’hui quand les taux d’intérêt sont nuls ou
négatifs, mais quand les taux d’intérêt augmenteront, la Banque centrale devra
payer des intérêts sur les dépôts des banques commerciales (ou perdra les
intérêts que paient les banques sur leur refinancement), ce qui diminuera son
profit et donc les dividendes qu’elle versera à l’État. Au final, l’État
supportera toujours la charge de son endettement. Il est donc erroné d’écrire,
comme les auteurs, page 14 : « Le titre obligataire serait non seulement
non remboursable mais ne porterait pas intérêt. Il réduirait certes les revenus
des banques centrales mais sa contrepartie serait également non rémunérée, ce
qui aurait donc peu d’incidence sur la solvabilité́ des banques centrales ».
En temps normal, les dépôts des banques
auprès de la Banque centrale sont rémunérés et le refinancement des banques leur
coûte, par définition, le taux du refinancement.
- La Banque centrale aurait donc un bilan déficitaire. Cette dette
devrait être répartie entre les actionnaires de la Banque centrales, donc les États
membres dans le cas de la BCE, de sorte que leurs dettes publiques ne
diminueraient pas.
Les auteurs écrivent,
page 11 : « La monétisation permet de mener une politique budgétaire
expansionniste sans accroitre la dette exigible ». Mais la dette publique
n’est pas exigible quand la Banque centrale et les banques commerciales
s’engagent à toujours la financer. A chaque période, l’État est assuré de
pouvoir refinancer la dette arrivée à échéance. Il n’est jamais obligé de la
rembourser effectivement. En sens inverse, les dépôts des banques commerciales
auprès de la Banque centrale pourraient se réduire si les banques se décident à
augmenter fortement leurs crédits.
Les auteurs
évoquent le risque d’inflation, heureusement pour le réfuter. Mais faut-il
encore en 2020, citer la théorie quantitative de la monnaie, même pour s’en
écarter ? Cette théorie n’a aucun
sens quand la masse monétaire est endogène, quand les agents peuvent arbitrer
entre la monnaie et des actifs non monétaires, quand la masse monétaire
contient en fait des actifs d’épargne, et pire de l’épargne contrainte. Le
risque inflationniste pourrait provenir d’un excès de demande provoqué par une
politique budgétaire trop expansionniste dans une situation de demande privée
dynamique par rapport aux capacités de production. Il n’y a aucun lien direct entre
l’inflation et la masse monétaire (d’ailleurs, laquelle : M0, M1, M2, M3 ?). Un
gonflement de la masse monétaire provoqué par la hausse, volontaire ou non, de
l’épargne des ménages n’est pas inflationniste. De plus, comme nous l’avons
montré dans la première partie, la monétisation de la dette publique ne fait
pas augmenter la masse monétaire. Il est erroné d’écrire comme les auteurs,
page 14 : « La monétisation vise à créer de la monnaie utilisable par
les agents non financiers ». C’est le déficit public (et, par ailleurs, le
financement des entreprises et des ménages) qui crée des actifs financiers, et
parmi ces actifs de la monnaie.
Les auteurs
accordent une trop grande importance au fait que les Banques centrales monétisent la dette publique, alors que
ce qui importe, c’est l’engagement des banques d’absorber tous les titres que
l’État voudra émettre et celui de la Banque centrale d’accepter ces titres pour
refinancer les banques. Ces engagements ne doivent pas être remis en cause sous
peine d’interdire au gouvernement de pratiquer la politique budgétaire de son
choix. Il ne nous semble pas pertinent d’écrire, comme les auteurs, page 15,
que les Banques centrales pourraient avoir « la possibilité de refuser de monétiser
une fraction trop importante de la dette, imposant des contraintes aux
gouvernements ». La Banque centrale doit garantir aux banques qu’elles
pourront toujours se refinancer auprès d’elle (sauf à provoquer une crise grave
comme en Grèce en 2015).
Certes, comme
l’écrivent les auteurs, la coordination des politiques budgétaires et
monétaires est nécessaire (mais, elle ne doit pas avoir comme objectif « de
monétiser les dépenses publiques ») : le gouvernement et la Banque
centrale doivent s’accorder sur le niveau objectif du couple production/inflation[7] ;
ils doivent s’accorder sur la manière d’atteindre ce niveau (taux d’intérêt
faible et excédent public ou déficit public et taux d’intérêt élevé), sauf dans
les périodes, comme en 2020, où des taux d’intérêt à leur minimum n’évitent pas
la nécessité de déficits public élevés.
Annuler les dettes publiques détenues par la BCE ?
Par contre, nous rejoignons les auteurs sur la critique de la
proposition de l’annulation des dettes publiques détenues par la Banque
centrale[8].
Cette proposition, ne modifiant les revenus et le patrimoine d’aucun agent
extérieur à l’ensemble « État-Banque centrale », n’aurait aucun
impact macroéconomique. Et la dette ainsi créée de la Banque centrale devrait
être répartie entre ses actionnaires. Le point étrange est que les auteurs ne
voient pas que cette proposition est totalement équivalente à leur proposition
de monétisation de la dette publique par émission de titres sans valeur que la
Banque centrale devrait absorber. Ainsi, écrivent-ils, pages 16 et 17, à propos
cette prétendue annulation : «
Les comptes publics ne sont donc pas affectés…Par ailleurs se pose la
question du bilan de la banque centrale, qui doit enregistrer une perte en
capital, et potentiellement des fonds propres négatifs en cas d’annulation de
dette… Ainsi, ce que le gouvernement « gagne » aujourd’hui en capital, il le
perd par des moindres revenus futurs », sans voir qu’annuler une partie de
la dette publique ou transformer des titres publics en « obligations sans
coupon, ni remboursement » est totalement équivalent.
La BCE a acheté environ 480 milliards d’euros de la dette publique
française durant ces dernières années. Le gouvernement français perdrait tout
crédit auprès d’elle, de ses partenaires ou des marchés financiers s’il lui
demandait, maintenant, d’annuler cette dette ou d’acheter à leur valeur faciale
des titres sans valeur. Ce n’est heureusement pas nécessaire quand la France
peut s’endetter, autant que besoin, à des taux nuls ou négatifs.
[1] Voir, par exemple, Catherine Mathieu et Henri
Sterdyniak (2019) : « On public debts in the Euro Area », Brussels Economic Review, 58.
[2] Le concept de monnaie endogène a été
introduit par Jacques Le Bourva (1962) :
« Création de monnaie et multiplicateur de crédit », Revue
Économique, 13(1). Il est implicite
dans tous les modèles où la Banque centrale fixe le taux du refinancement selon
ses objectifs macroéconomiques et refinance
sans limite les banques à ce taux.
[3]
La comparaison entre financement monétaire et obligataire d’un déficit public a
donné lieu à de nombreux travaux dans les années 1970. Voir, par exemple,
Blinder et Solow (1973) : « Does fiscal policy
matter ? », JPE,2(4). L’article
de Jérôme Creel et Henri Sterdyniak, (1999) : « Pour en finir avec la
masse monétaire », Revue économique,
50-3, reprend la problématique dans un modèle à monnaie endogène et montre que
la distinction n’a plus de sens.
[4]
Pour alléger le raisonnement, nous supposons que les ménages n’utiliseront ces
10 milliards que dans une période ultérieure. Pour un raisonnement identique
intégrant un bouclage macroéconomique, voir : Henri Sterdyniak
(2020) : “Public debts in times of Coronavirus”, EPOG Policy brief, n°11.
[5] Les auteurs écrivent cependant,
page 6 : « Le QE modifie bien la charge d’intérêts payée par le
gouvernement dans la mesure où les intérêts payés sur la dette publique à la
banque centrale reviennent au gouvernement, qui sont le plus souvent les
actionnaires des banques centrales. Celles-ci reversent donc une part de leurs
profits au gouvernement. Ainsi, du point de vue du bilan consolidé de l’État
(gouvernement et banque centrale), le gouvernement verse d’une main ce qu’il
reprend de l’autre ». Ils oublient qu’en achetant de la dette publique, la
Banque centrale voit diminuer le refinancement des banques (ou augmenter leurs
réserves) de sorte que ni elle, ni l’État ne font, au premier ordre, d’économie
d’intérêts. L’Etat verse moins d’intérêts aux banques, mais la Banque centrale
perd la rémunération du refinancement bancaire ou doit rémunérer les dépôts des
banques.
[6] Notons
que cela n’a rien à voir, au premier ordre, avec les spécificités de l’euro. Ni
la Réserve fédérale des États-Unis ni la Banque d’Angleterre n’accepteraient
une telle opération.
[7] Voir,
par exemple, Fabrice Capoen, Henri Sterdyniak et Pierre Villa (1994) : « Indépendances
des banques centrales, politiques monétaire et budgétaire, une approche
stratégique », Revue de l’OFCE,
50-1.
[8] Comme
proposé, par exemple, par Laurence Scialom (2020) : « Des annulations de
dette par la BCE : lançons le débat », Note de Terra Nova, avril. Voir notre note : Henri Sterdyniak (2020) :
“Public debts in times of Coronavirus”, EPOG Policy brief, n°11.