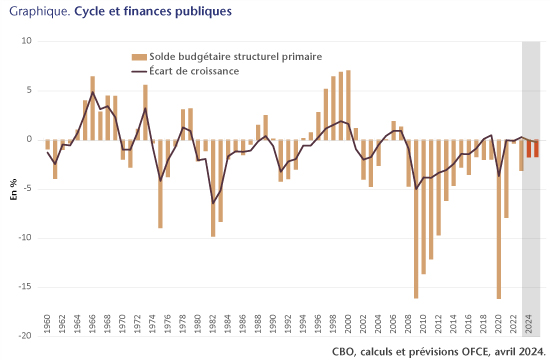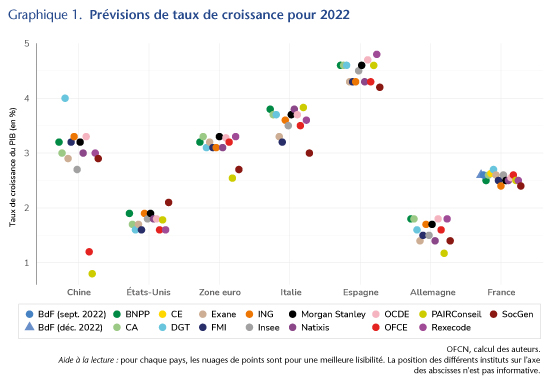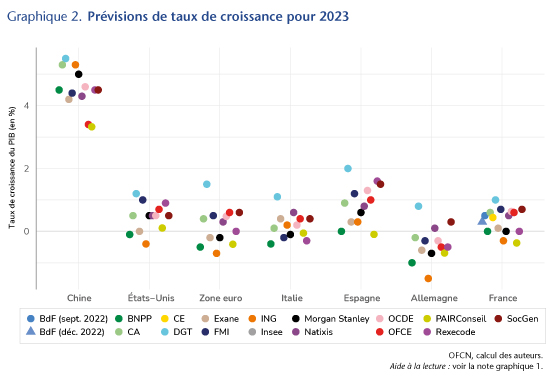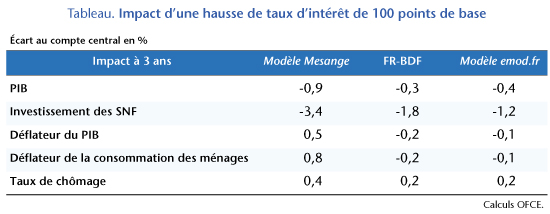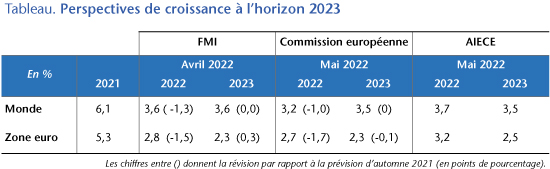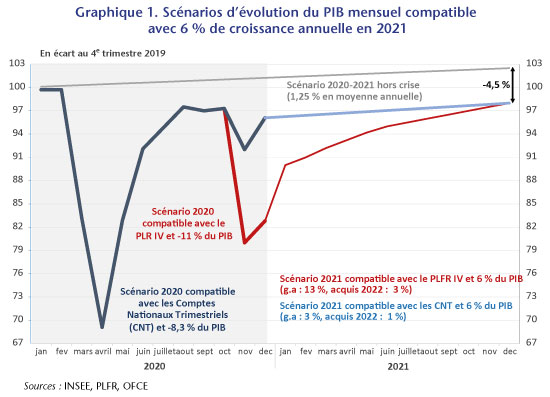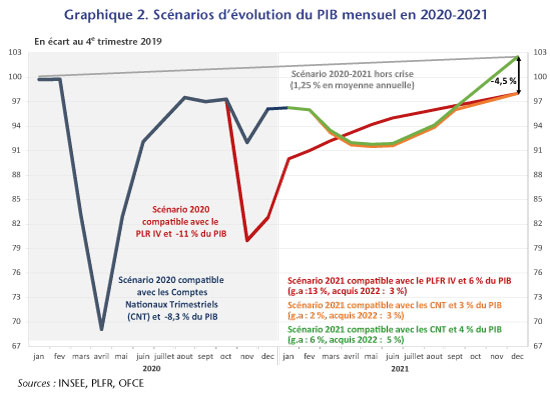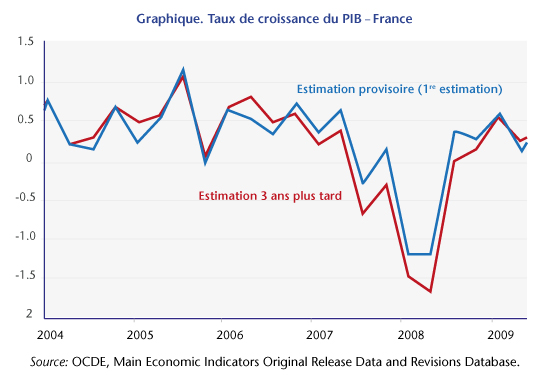Par Xavier Ragot, Président de l’OFCE
Les élections présidentielles
sont toujours un moment d’accélération du débat économique en France. C’est le moment
des diagnostics, des bilans et de tous les projets. Des institutions comme
l’OFCE se posent de manière régulière la question de l’évaluation des
programmes économiques des candidats. À la différence des élections de 2017,
l’OFCE a choisi de ne pas évaluer les programmes mais seulement certaines
mesures qui seront discutées dans le débat politique. En revanche, l’OFCE va
apporter des éclairages sur des questions importantes pour le débat de
politique économique comme la question environnementale, les inégalités ou
encore les enjeux européens, l’état du tissu productif, entre autres.
La première contribution portera
sur la dette publique et les évolutions des dépenses et prélèvements publics,
début octobre. Ce choix ne vise ni à dramatiser la question de la dette
publique ni à minimiser son importance mais à reconnaître que la période que
nous avons vécue, avec la crise Covid, a conduit à des politiques inédites en
France et dans le monde, qui ont changé l’état des comptes publics. Que ce
soient des projets de hausse (ou baisses) de dépenses, d’impôts ou de dettes
publiques, les équilibres comptables de base devront être vérifiés et des choix
devront être assumés, quels qu’ils soient.
L’importance de l’enjeu a conduit
l’OFCE à développer un nouvel outil, un simulateur de la trajectoire de la
dette publique, de la croissance, du chômage et de l’inflation, qui permettra à
chacun de simuler les effets macroéconomiques d’un choix de cible de dette
publique. Cet outil permettra de montrer ce qu’est le budget de l’État et les
effets de choix économiques sur la croissance, l’inflation, l’emploi et la
dette.
Pour
comprendre cette décision de fournir un cadre général et des contributions
spécifiques plutôt que d’évaluer des programmes, il faut mettre en perspective la
question de l’évaluation des programmes. Avant de parler de la situation
française, décentrons le débat pour regarder ce qui se fait dans les autres
pays. Le pays dans lequel l’évaluation économique des programmes des candidats
est la plus développée est les Pays-Bas. Le CPB (Centraal Plan Bureau), qui est
un organisme indépendant pour l’analyse économique, évalue le programme des
candidats depuis 1986 de manière systématique. Dans ce pays, le CPB joue un
rôle singulier. Le CPB a été créé en 1945 et son premier directeur était Jan Tinbergen.
Ce dernier est l’un des principaux fondateurs des modèles macroéconomiques de
prévision et d’évaluation. Cet économiste avait une vision très claire de la
répartition des rôles entre économie et politique : aux hommes et femmes politiques d’affirmer les
préférences sociales et aux économistes de contribuer aux moyens les plus
efficaces de les atteindre. Cette expérience d’évaluation systématique a permis
aux économistes néerlandais d’affiner leur vision des avantages et
inconvénients de l’évaluation des programmes économiques des candidats et
d’avoir une approche nuancée de leur contribution[1].
Heurs et malheurs de l’évaluation
économique
Commençons par les avantages
d’une évaluation des programmes en résumant les leçons hollandaises. Tout
d’abord, et bien entendu, l’évaluation économique ne consiste pas à donner un
critère unique (que ce soit chômage, croissance, inégalités, écologie) ni à
déterminer le meilleur programme. Elle consiste à faire une évaluation
multicritères et proposer des évaluations sur chacun d’eux, avec une méthode
commune pour les différents programmes.
De ce fait, le gain premier de
l’évaluation des programmes est de révéler les priorités contenues dans chaque
programme qui peuvent parfois différer des discours politiques. Un parti peut
préférer la réduction de la dette (et possiblement des moyens budgétaires à
long terme) à la croissance de court terme, d’autres la réduction des émissions
de CO2 à l’équilibre des comptes sociaux, etc. Dans les deux cas il s’agit d’un
rapport différent au temps et aux risques. L’évaluation comparative permet donc
de révéler des préférences sociales entre lesquelles les électeurs peuvent
choisir suivant leur propre préférence politique.
Quelle différence d’une
évaluation de think tanks qui identifient le meilleur programme et donc le
meilleur candidat ! Cet autre exercice est bien sûr utile pour le débat
politique, mais il est différent. Le think tank affirme et défend des
préférences sociales. Son rôle n’est pas tant d’évaluer que de plaider une
cause ou une vision du monde. L’OFCE est un centre de recherche. Son rôle est
d’éclairer le débat public autour des questions économiques que l’on juge
importantes.
Le deuxième intérêt de
l’évaluation des programmes, selon le CPB, est d’éclairer le lecteur sur
l’évolution de la situation économique si un programme est mis en œuvre. Il
s’agit donc de contribuer à la prévision : quelle serait la dynamique du
chômage, de l’inflation, des inégalités, etc. Dans une période de forte
incertitude (sanitaire au premier chef), identifier les futurs possibles est
une contribution utile, tant les discours catastrophistes peuvent inquiéter (et
assurer une forte visibilité politique).
Le troisième intérêt de
l’évaluation économique peut sembler anecdotique mais il s’avère important.
L’évaluation des programmes ne consiste pas seulement à faire de l’analyse
économique sur les documents publics. Il consiste à aller voir les équipes de
campagne pour préciser les mesures, les dispositifs et les causalités
supposées. Ce travail d’évaluation, dont le premier est l’évaluation des effets
au premier ordre sur le budget public, permet aux candidats de préciser les
dispositifs et les implications des propositions. Le travail d’évaluation
fournit ainsi un service aux équipes de campagne en leur permettant d’interagir
avec des équipes d’économistes. Il n’a pas échappé aux lecteurs que le degré de
précision des programmes est hétérogène. Une faible précision peut être un
choix politique assumé mais aussi, parfois, le résultat d’équipes de campagne
peu spécialisées sur certains sujets économiques.
Face à de tels arguments, il
pourrait sembler que l’évaluation des programmes par un centre de recherche en
économie comme l’OFCE est d’une utilité évidente pour le débat public. En fait,
il n’en est rien pour ces élections de 2022 : les inconvénients de
l’évaluation sont les miroirs des avantages discutés plus haut.
L’évaluation des programmes et
des mesures peut donner l’illusion de la certitude alors que ces évaluations ex ante sont fondées sur des modèles pas
toujours adaptés aux mesures évaluées. Les résultats de l’évaluation de chaque
mesure sont donc empreints d’incertitudes qui se cumulent dans l’évaluation des
programmes. Cela n’est pas un argument pour ne pas évaluer des programmes, mais
il faut reconnaître qu’une grande pédagogie est nécessaire dans la présentation
des limites des résultats.
Ensuite, les déclarations des
partis, candidats ou candidates ne sont pas toujours évaluables car trop floues.
Ces derniers jouent avec ce flou pour affirmer des valeurs sans s’engager sur
des montants ou des réformes. Prenons par exemple le débat actuel sur la hausse
des salaires nécessaires après la crise Covid. Différentes mesures sont
possibles qu’il faut alors financer. Les économies peuvent être chiffrées, mais
l’effet économique dépend d’un ensemble précis de contreparties financières qui
peuvent permettre d’apprécier l’effet sur le chômage, la croissance et les
inégalités. Enfin, la difficulté d’évaluer les programmes peut pénaliser les
programmes qui se prêtent à l’exercice face à des programmes
inévaluables ! Ces inconvénients avaient été identifiés par l’OFCE lors
des élections 2007 (voir Fitoussi et Timbeau, 2017 et la description des débats
par Lemoine, 2007).
Le dispositif de l’OFCE en 2017
Les évaluations peuvent être utiles
lorsque les programmes sont évaluables et lorsque les précautions de
présentation sont utilisées. De ce fait, l’OFCE en 2017 s’est livré à un
exercice d’évaluation plutôt qualitative des programmes. Le résultat public est
un tableau multicritères qualitatif (OFCE, 2017).
Ce travail prospectif avait été
rendu possible par une situation singulière de la campagne de 2017, qui a été
l’organisation des primaires pour les candidats de droite et du parti
socialiste. Ensuite, le candidat de la France Insoumise avait fourni des
éléments économiques quantitatifs alors que la candidate du Front National
proposait la sortie de la zone euro, qui est une politique économique inévaluable
mais dont on peut discuter les implications économiques (Blot et al., 2017). Le rôle du débat
économique était important en 2017 : le président François Hollande avait
transformé un moment économique en symbole politique, « l’inversion de la
courbe du chômage », le débat européen était vif autour du thème de
« l’austérité ».
L’OFCE a donc fourni en 2017 un
tableau qualitatif comparatif de différents programmes. L’intérêt de l’exercice
était le choix des critères d’évaluation : ils doivent être assez nombreux
pour permettre l’analyse fine au sein d’un espace politique complexe mais
limités pour que les comparaisons soient compréhensibles. Nous avions choisi
quatre thèmes : finances publiques, ménages, entreprises et environnement,
avec dix sous-thèmes.
La situation en 2022
La situation en cette fin d’année
2021 est bien différente. Premièrement, sur le plan économique les séquelles
économiques de la crise Covid sont encore en cours d’évaluation. Quelle sera la
dynamique du chômage après la fin des mesures de soutien de l’économie ?
Comment la croissance sera-t-elle affectée à moyen terme par le recours accru
au télétravail ? Ces discussions ont lieu dans un environnement sanitaire
encore incertain et conditionneront l’orientation des mesures de politique
économique.
Deuxièmement, la gestion de la
crise de la Covid a été bien différente en France, en Europe et dans le monde de
la gestion de la crise des subprime
de 2010 à 2011. Les États ont pris à leur charge, sous la forme d’une dette
publique accrue, une grande partie des pertes de revenus des agents. Cela permet une reprise forte de l’activité
après crise, avec un État certes plus endetté. Cette gestion est presque
consensuelle parmi les économistes et les acteurs politiques. Il n’y a pas, du
moins à ce stade, de contestation politique de la gestion économique de la
crise Covid. Les débats des grandes options de politique économique sont bien moindres
qu’en 2017.
Troisièmement, des positions
économiques radicales, comme la sortie de la France de la zone euro, ne sont
plus proposées par des partis susceptibles d’aller au second tour des élections.
D’autres formations politiques pourront porter un projet de Frexit, mais il y a
peu de chance que ce projet soit central dans le débat politique français.
Cette inflexion du débat économique sur l’Europe est le signe d’un changement
d’appréciation de la politique européenne. Cette dernière devient moins
clivante. La mise en place dans la crise d’un plan de relance européen
ambitieux, d’une capacité d’endettement commune, de projets d’une fiscalité
carbone aux frontières de l’Union européenne pour éviter le dumping
environnemental, tous ces éléments récents font que la critique de l’Union européenne
(sur le plan économique) porte moins.
De ce fait, le débat économique
en 2022 paraît moins porteur d’enjeux qu’en 2017. Certes, des politiques
économiques seront en débat, comme l’évolution de la fiscalité et des
inégalités, de l’investissement public, de la réforme des retraites, de
l’évolution de la dette publique, les hausses de salaires et du SMIC, le
salaire des enseignants entre autres. Ces éléments donneront probablement lieu
à des propositions évaluables, ce que l’OFCE fera, mais à ce stade, il est peu
probable que les programmes donneront des éléments précis sur tous ces sujets, permettant
une évaluation du programme et donc une prévision de la situation économique si
le ou la candidate était élue.
À ce stade au moins, les partis
politiques cherchent à départager des personnalités porteuses de projets plutôt
que que de programmes clairs. Le Président de la République présentera
probablement tardivement des éléments de programme économique, ce qui est
fréquent pour un second mandat. Le moment n’est pas propice à l’évaluation des
programmes et les inconvénients domineront très probablement les avantages.
Les élections présidentielles doivent
cependant être le moment d’identifier les enjeux importants du débat de
politique économique des prochaines années, voire de la prochaine décennie, en
laissant la place au diagnostic, aux options pertinentes, à la discussion de
différentes mesures possibles.
De ce fait, l’OFCE a choisi de contribuer
en proposant des analyses sur une série de thèmes, à la fois importants pour le
débat économique et au sein de l’observatoire (sans ordre) : dette
publique, vieillissement, conjoncture, marché du travail, protection sociale,
environnement, construction européenne, fiscalité, tissu productif, logement,
genre.
Ces thèmes ne sont pas exhaustifs. L’éducation, thème essentiel, ne sera
qu’indirectement traité. Enfin, le débat économique est une composante à la
fois partielle et essentielle dans le débat politique. Il faut espérer que ces contributions permettront
d’éviter les faux débats économiques pour se concentrer sur les vrais enjeux
politiques.
Références
- Fitoussi Jean-Paul et Timbeau Xavier, 2007,
« Pourquoi nous ne chiffrerons pas les programmes présidentiels : manifeste
contre une déontologie en rase campagne », Blog OFCE, 23 février.
- Lemoine Benjamin, 2008, « Chiffrer les programmes
politiques lors de la campagne présidentielle 2007 : Heurs et malheurs
d’un instrument », Revue française
de science politique , Vol. 58, n° 3, juin, pp. 403-431.
- OFCE, 2017,
« Quelles propositions économiques des candidats
à l’élection présidentielle ? », OFCE
Policy Brief, n° 16, M. Plane et X. Ragot, coordinateurs, 25 pages.
- Christophe Blot,
Jérôme Creel, Bruno Ducoudré, Paul Hubert, Xavier Ragot, Raul Sampognaro,
Francesco Saraceno, et Xavier Timbeau, 2017, « Sortir de l’euro
», Blog OFCE, 23 avril.
[1] Pour une présentation
détaillée de l’environnent institutionnel aux Pays-Bas, et de la méthode du CPB
pour évaluer les programmes, voir Graafland et Ross (2003).