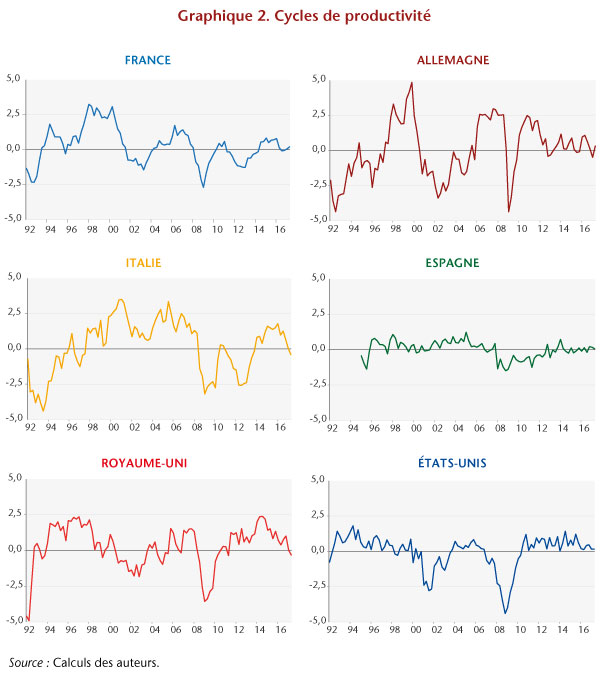Covid-19 et entreprises : comment éviter le pire ?
par Mathieu Plane
Selon
notre dernière évaluation, le PIB chuterait de 32 % sur les huit semaines
de confinement. Pour la seule activité marchande hors services immobiliers
(constitués principalement des loyers), la perte de valeur ajoutée serait de 44
%. Les dispositifs mis en place pour préserver l’emploi et le tissu productif
(chômage partiel, indemnisation garde d’enfants, fonds de solidarité) ont
permis d’absorber une partie du choc sur les entreprises. Les reports de
paiement d’impôts et de cotisations sociales et les prêts garantis par l’État
leur ont permis d’avoir accès à la trésorerie pour se financer à court terme et
faire face aux pertes enregistrées.
Malgré ces dispositifs et sous
l’hypothèse d’une dette fiscale qui ne serait pas annulée à grande échelle, la
perte de revenu d’exploitation des entreprises se chiffre à 42 milliards
d’euros en huit semaines, avec des effets sectoriels très forts.
À l’instar du chômage partiel pour la masse salariale, l’État doit prendre en charge le coût pour les entreprises du non usage du capital productif
Si le dispositif de chômage
partiel a permis de socialiser une part importante des salaires du secteur
privé (Ducoudré
et Madec, 2020) et de préserver en
grande partie de l’emploi et des revenus des ménages, les pertes accumulées des
entreprises s’expliquent par la chute des recettes et l’accumulation de coûts fixes non pris en
charge par l’État, dont ceux liés à la non utilisation du capital
productif. Ce sont les coûts des locaux et bâtiments non utilisés, des usines
et machines de production à l’arrêt, des avions au sol, des camions immobilisés
et de l’ensemble des équipements (technologiques, logistiques, …) des
entreprises qui ne sont pas utilisés.
Ainsi les secteurs les plus
intenses en capital, comme l’industrie ou les services de transports, vont consacrer
chaque mois une part importante de leur revenu à financer ce capital pour son
utilisation, son entretien ou son renouvellement. Or si le chômage partiel absorbe
les coûts liés à la masse salariale, aucun dispositif ne prend directement en
charge les coûts liés au non usage du capital productif. Les secteurs intenses
en capital sont des secteurs à haute valeur ajoutée, intenses en technologie et
R&D et qui fournissent une grande part des exportations et participent
largement à la compétitivité de notre économie. Or, de nombreuses entreprises frappées
par le choc économique lié au Covid-19 risquent de se trouver rapidement en
faillite face au non usage de ce capital et des coûts qu’elles doivent
supporter.
Cela a pour effet premier une
contraction drastique de l’investissement, supérieure
à 50 % dans notre dernière évaluation pour les huit semaines de confinement.
C’est donc au prix d’une réduction massive de leur investissement que les
entreprises essayent de limiter les besoins de financement et éviter la
faillite immédiate. Un tel scénario n’est pas tenable car il sacrifie l’avenir
au profit d’une survie incertaine. De plus, réduire massivement
l’investissement ne suffit pas à couvrir l’ensemble des pertes de revenu
des entreprises : la contraction de l’investissement représente une baisse de
25 milliards, permettant de faire passer le besoin de financement des
entreprises de 42 milliards à 17 milliards d’euros pour huit semaines de
confinement, ce qui reste extrêmement élevé malgré la réduction considérable de
l’investissement.
Pour éviter les faillites en
cascade des entreprises de ces secteurs, l’État a mis en place des
facilités de trésorerie indispensable à la survie des entreprises et a prévu un
plan de recapitalisation de 20 milliards pour les entreprises les plus en
difficulté[1].
Si l’accès à la trésorerie de ces entreprises est un impératif, il ne fait que
repousser le problème : ces entreprises vont devoir absorber les pertes
passées et faire face à une dette bancaire et fiscale de plus en plus élevée.
Si l’on ajoute des perspectives
durablement dégradées par un rebond limité et progressif, les pertes des
entreprises vont inévitablement s’accumuler, augmentant les risques de
faillite. L’État
pourrait recapitaliser les entreprises qui lui semblent nécessaire de sauver, mais
cette politique pourrait être dépassée par le nombre potentiel de faillites.
Des mesures préventives sont nécessaires pour éviter qu’un grand nombre
d’entreprises (ETI et PME) passent sous le radar des pouvoirs publics et
mettent la clé sous la porte.
À l’instar de la mesure du
chômage partiel pour le travail, il nous semble donc indispensable de mettre en
place une mesure d’aide de crise, « Invest-Covid », pour le capital
productif prenant en charge les coûts de ces immobilisations, non utilisées ou
faiblement utilisées (encadré
2 du Policy Brief n°66, 20 avril 2020, X. Timbeau). Cette mesure d’urgence nous
semble juste car elle cible toutes les entreprises dont la production s’est
réduite à la suite du choc économique et ce à la hauteur de leur stock de
capital inutilisé. Le calcul de l’aide se fait entreprise par entreprise, sur
la base de la dépréciation des immobilisations au bilan de l’entreprise au
prorata du choc sur l’activité, calculé à partir de la variation du chiffre
d’affaires. Par ailleurs, pour les
locaux et bâtiments que les entreprises utilisent mais dont elles ne sont pas
propriétaires, l’aide ne doit pas être affectée au bailleur qui continue à
percevoir son loyer[2] mais au
locataire qui continue à payer son loyer sur la base de sa perte d’activité.
Pour chaque entreprise et pour chaque
trimestre, le calcul du montant pour l’aide « Invest-Covid » est la
suivante :
Invest-Covid (en €) = Dépréciation des immobilisations du trimestre
(en €) * Perte de CA (en glissement annuel pour le trimestre, en %)
La question du périmètre de
l’aide peut se poser. Elle doit couvrir à minima la dépréciation des
immobilisations corporelles non utilisées mais elle pourrait s’étendre à
l’ensemble des immobilisations, y compris celles incorporelles, comme la
R&D ou les logiciels et les bases de données. Cette mesure d’aide viendrait
renforcer les fonds propres de l’entreprise de façon à diminuer le risque
d’insolvabilité.
Quelques exemples concrets
Pour mieux comprendre le
fonctionnement du dispositif « Invest-Covid », prenons l’exemple du
groupe Air France–KLM. La
seule dépréciation de ses immobilisations aéronautiques lui a coûté 319
millions d’euros pour le premier trimestre 2020. Sur cette base, en supposant
une baisse du chiffre d’affaire de 80 % au deuxième trimestre 2020, Air France–KLM
recevrait 255 millions (319*0,8) pour le deuxième trimestre pour couvrir 80 %
des coûts de la non utilisation de sa flotte aérienne. Si l’on étend cette aide
à l’ensemble de la dépréciation des actifs du groupe, qui représente 743
millions d’euros pour un trimestre, le groupe recevrait, sur la base d’une
perte d’activité de 80 % sur le trimestre, une aide de près de 600 millions
pour le trimestre.
Pour donner des ordres de
grandeur, pour le groupe Michelin, la dépréciation
des seuls équipements industriels représente environ 250 millions par trimestre
sur l’année 2019. Pour Renault, la
dépréciation des outillages spécifiques, matériels et autres ouillages
représentent plus de 400 millions par trimestre. Et pour la SNCF, c’est
près de 600
millions par trimestre pour la dépréciation des matériels de transport, les
installations techniques, électriques, de télécommunications et de
signalisation, outillage et autres immobilisations (auxquels s’ajoutent 270
millions de dépréciation de voies, terrassements, ouvrages d’art et passages à
niveaux sans même intégrer les terrains et constructions). Dans tous les cas
d’entreprise, le calcul de l’aide se fait bien sûr en fonction du montant de la
dépréciation au prorata de la perte d’activité.
Pour ces grands groupes
industriels mais aussi pour de nombreuses ETI, PME et sous-traitants, le coût
de la dépréciation de ces immobilisations représente une part importante de
leur valeur ajoutée. En ciblant les aides sur la base du non usage des
immobilisations pendant la crise du Covid, ce dispositif proportionnel au choc
subi sur le capital de l’entreprise couvrirait l’ensemble des entreprises de la
sphère marchande. Il aurait l’avantage d’être juste, rapide à mettre en place
et éviterait des plans d’aides au cas par cas qui ne permettent pas de traiter
l’ensemble des entreprises du tissu productif. Il permettrait certainement
aussi d’éviter en partie des plans de recapitalisation à venir de l’État
si cette aide prenait la forme de renforcement des fonds propres. Il est
important aussi de noter que ce dispositif ne se substitue pas aux prêts
garantis par l’État, indispensables à la trésorerie des entreprises en
temps de crise, mais qui vont donner lieu à un remboursement futur avec
l’épineuse question du traitement de cette dette en sortie de crise. Le
dispositif « Invest-Covid » est donc une aide qui prend la forme
d’une injection directe pour renforcer les fonds propres des entreprises, qui
n’est pas assimilable à un prêt. Par ailleurs, cette aide ciblée peut être
complémentaire et s’intégrer aux plans sectoriels annoncés récemment, que ce
soit dans l’automobile, le tourisme ou l’aérien.
Une aide pour les entreprises allant de 5,5 à 17,2 milliards pour huit semaines de confinement selon le périmètre des immobilisations retenues
Pour l’ensemble de l’économie
française, nous pouvons identifier ces actifs fixes à partir des comptes de
branches de l’Insee. Cela correspond au capital fixe net des branches qui est
décliné par type d’actif : constructions (logements, bâtiments
résidentiels et autres ouvrages de génie civil), machines et équipements (matériels
de transports, équipements TIC, autres) et les droits de propriété
intellectuels (R&D, logiciels et bases de données et œuvres récréatives,
littéraires ou artistiques originales). Il y a également les systèmes d’armes
et les ressources biologiques cultivées mais ce sont des montants relativement
faibles et identifiés uniquement pour les branches « Défense » et
« Agriculture ».
Le stock d’actifs fixes
correspond à l’accumulation nette de capital par les branches, c’est-à-dire la
somme des investissements nette de la dépréciation de capital. Ce capital
représente 7 848 milliards d’euros en 2018 (334 % du PIB) mais la seule
composante « logements résidentiels » représente 4 630
milliards, soit 59 % du capital net total. Si l’on exclut aussi les services
non marchands (1 022 milliards), le capital net productif des entreprises représente
2 196 milliards, soit 93 % du PIB (et 120 % de la VA marchande hors
services immobiliers).
Le coût budgétaire du dispositif
« Invest-Covid » pour les huit semaines de confinement serait de 17,2
milliards[3]
(graphique 1), ce qui représente 1 % de la valeur ajoutée du secteur marchand
hors Covid : 28 % seraient affectés
à la non utilisation des bâtiments non résidentiels et ouvrages de génie civil,
dont 10 % pour compenser les entreprises locataires, 13 % aux matériels de
transports, 3 % aux équipements TIC, 17 % aux machines et équipements, 18 % à
la R&D et 21 % pour les logiciels et bases de données.
Si on limite le dispositif uniquement aux immobilisations de construction (y compris la compensation des loyers) et aux machines et équipements et l’on exclut les immobilisations dites incorporelles au sens de la comptabilité d’entreprise, le coût budgétaire du dispositif serait de l’ordre de 10 milliards d’euros pour huit semaines de confinement. Si l’on restreint l’aide uniquement aux matériels de transport, équipements TIC et autres machines et équipements, le coût budgétaire du dispositif « Invest-Covid » serait d’environ 5,5 milliards pour huit semaines de confinement.
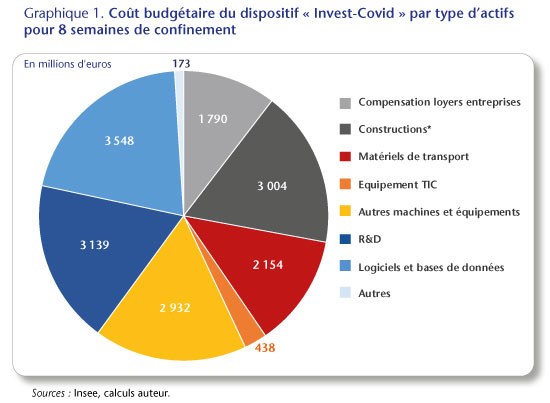
L’industrie qui représente 17 %
de la VA marchande recevrait 5,6 milliards pour les huit semaines de
confinement (tableau 1), soit 36 % de l’enveloppe globale du dispositif. Ce
montant représente 2 points de la valeur ajoutée annuelle (hors Covid) de
l’industrie. Or, ce secteur intense en capital, durement frappé par le choc
économique, concentre 74 % des exportations.
Dans le détail, les branches qui
recevraient le plus d’aides pour les huit semaines de confinement dans le cadre
de ce dispositif sont les matériels de transport (5 % de leur VA annuelle), les
biens d’équipement (2,9 % de leur VA annuelle), les services de transport (1,9
% de leur VA annuelle) et les autres branches industrielles (1,7 % de leur VA
annuelle) (graphique 2). Ces quatre branches, qui représentent seulement 17 %
de la VA marchande, concentrent plus de 50 % de la R&D française et
contribuent à hauteur de 68 % aux exportations nationales. Avec ce dispositif,
elles recevraient 41 % de l’enveloppe globale.
D’autres secteurs sinistrés par
la crise, bien que moins intenses en capital, bénéficieraient également du
dispositif. C’est le cas par exemple des secteurs du Commerce et de
l’Hôtellerie-Restauration qui bénéficieraient à travers ce dispositif d’une
aide de près de 1,5 milliard pour compenser le non usage des immobilisations
pour les huit semaines de confinement, dont environ 600 millions pour les seuls
locaux et bâtiments. Par ailleurs, ce montant n’inclut pas le fait que les
entreprises de ces deux branches qui ne sont pas propriétaires de leurs locaux
recevront une part significative du 1,8 milliard pour compenser leurs loyers.
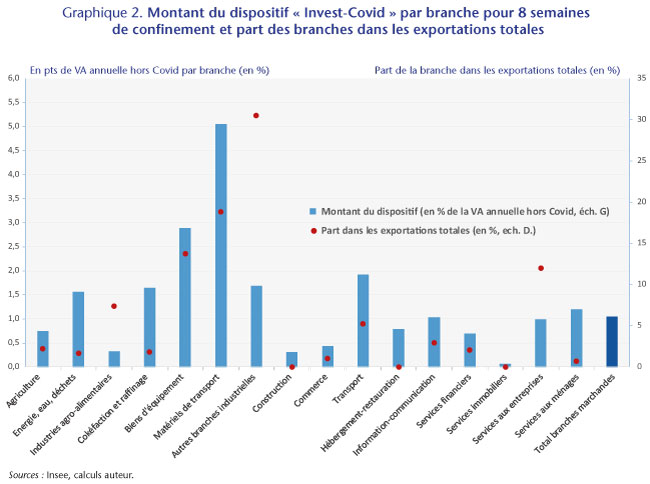
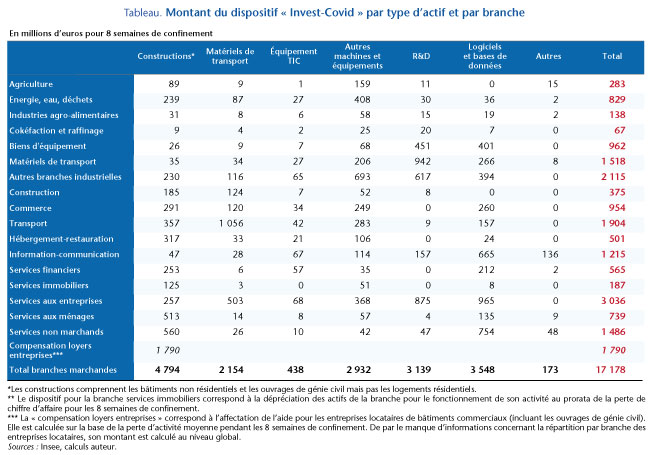
Pour conclure
En rétablissant la rentabilité
des entreprises les plus capitalistiques et les plus touchées par la crise, ce
dispositif d’aide d’urgence pourrait éviter des faillites qui pourraient
compromettre la compétitivité et l’activité de la France à moyen-long terme.
L’alternative qui se baserait sur le fait de délimiter le périmètre
d’intervention publique sur les potentiels besoins du monde d’après risquerait
de conduire à faire des choix définitifs et irréversibles alors que le futur
est plus que jamais incertain. Cela pourrait conduire à faire des erreurs
profondes sur les besoins productifs à venir et à sacrifier des entreprises
nécessaires à la production du monde de demain ou capables de se transformer
face aux besoins émergents.
Les pertes technologiques et de
savoir-faire peuvent avoir un caractère irréversible pour notre économie, la
disparition de certaines entreprises intégrées dans les chaînes de valeur
ajoutée domestiques peuvent avoir de fortes répercussions sur l’ensemble des filières
productives. Par ailleurs, il ne faut pas écarter le risque de disparition
d’entreprises qui peuvent être considérées comme stratégiques, écologiques ou à
contenu social important alors même que la question des relocalisations
d’activité va être de plus en plus prégnante en sortie de crise. Or préserver
la base industrielle existante en l’adaptant aux exigences du futur semble
primordial si nous souhaitons étoffer et relocaliser certaines filières
productives. Cela veut dire également que les entreprises doivent en
contrepartie de cette solidarité nationale s’engager dans une voie écologique,
économique et socialement responsable, sinon cet engagement autour des forces
productives ne pourra pas fonctionner.
Si nous ne nous armons pas de ce
type d’aide d’urgence, alors le pire pour l’économie française est à venir.
[1] Dans le cadre de la Loi de finances du 25
avril 2020 rectificative pour 2020, il est voté une ouverture de crédits pour
le renforcement des participations financières de l’État dans les entreprises
stratégiques en difficulté. 20 milliards d’euros alimenteront
progressivement le compte d’affectation spéciale « Participations
financières de l’État », en fonction du volume des opérations financières
nécessaires.
[2] Le
propriétaire continue à percevoir son loyer sauf si un accord est trouvé entre
le bailleur et le locataire ou si l’entreprise qui loue les locaux cesse son
activité.
[3] Sur la
base du taux de dépréciation moyen par type d’actif, que nous avons supposé ne
pas être modifié par le choc économique lié au Covid-19, nous avons simulé le
coût par branche de cette mesure budgétaire pour les huit semaines de
confinement sur la base du choc sectoriel que nous avons estimé.
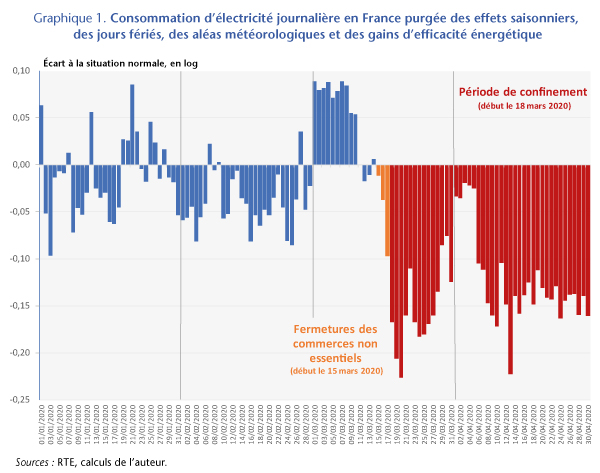
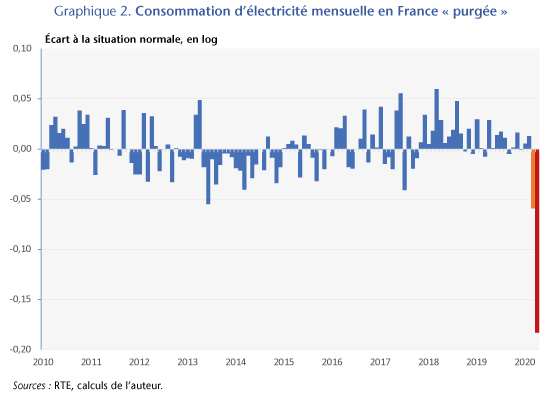
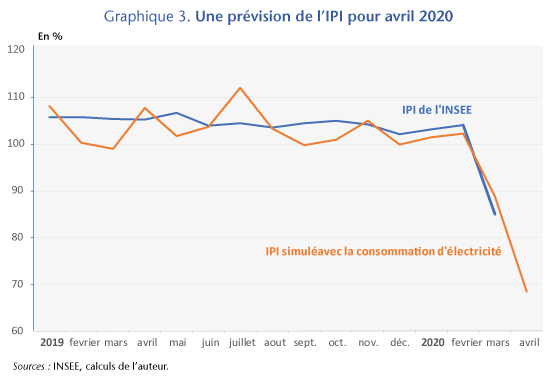
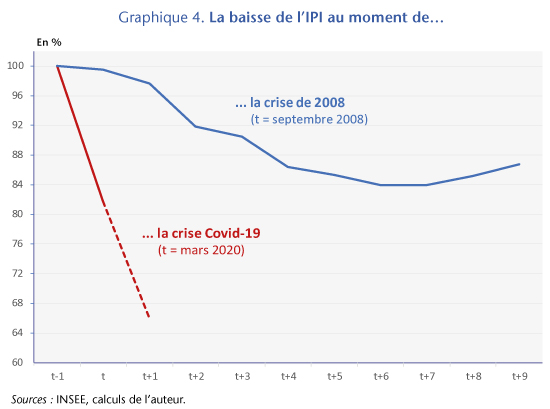
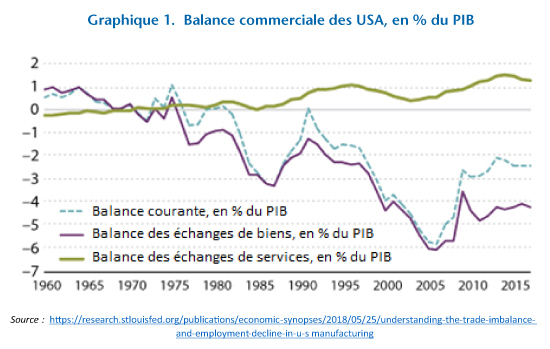
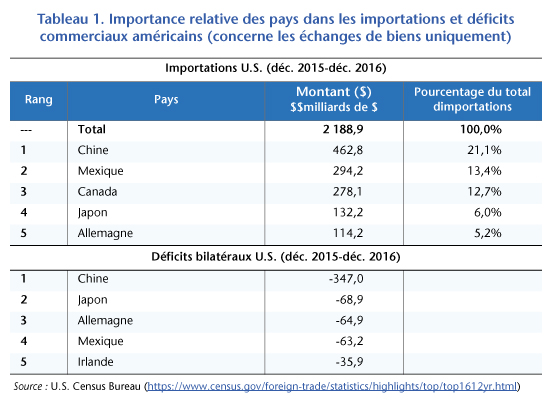
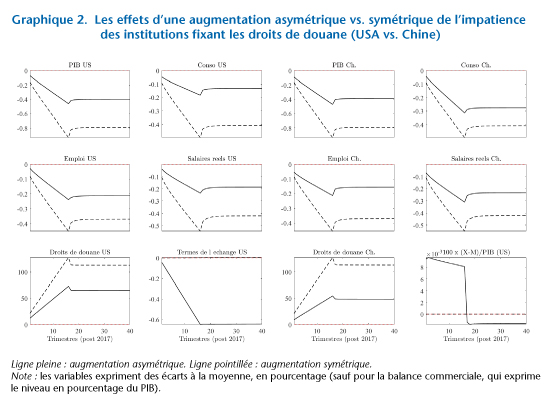
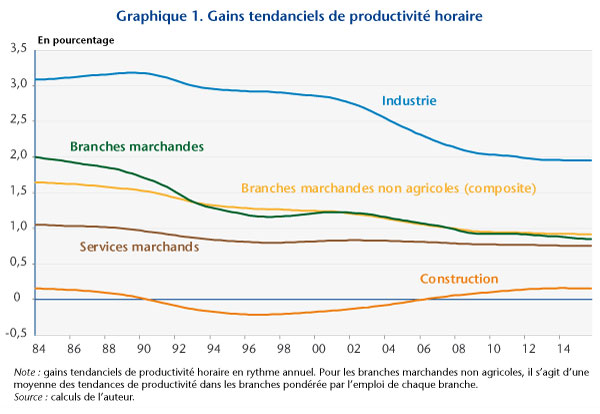
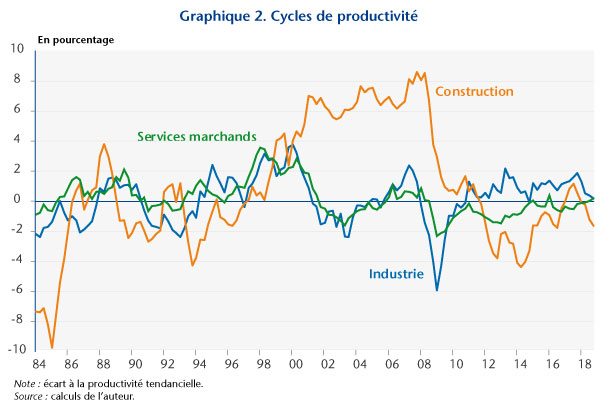
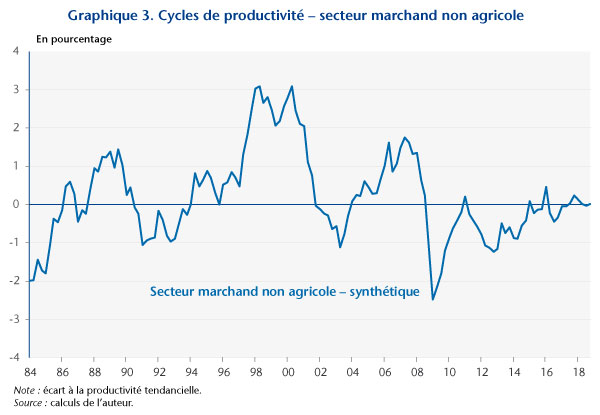
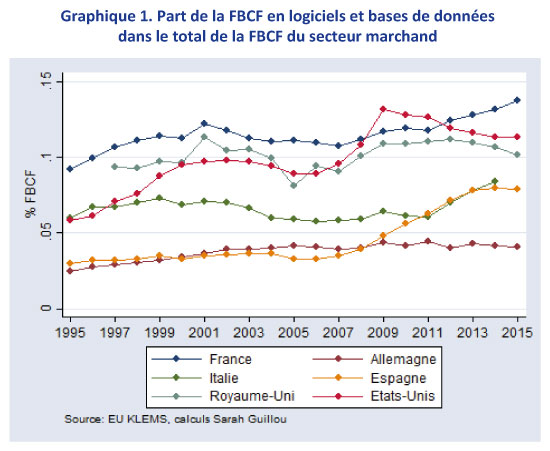 En taux d’investissement, c’est-à-dire quand on rapporte la dépense d’investissement à la valeur ajoutée de l’économie marchande, le dynamisme de l’économie française en matière de logiciels et bases de données est confirmé : la France distance nettement ses partenaires.
En taux d’investissement, c’est-à-dire quand on rapporte la dépense d’investissement à la valeur ajoutée de l’économie marchande, le dynamisme de l’économie française en matière de logiciels et bases de données est confirmé : la France distance nettement ses partenaires.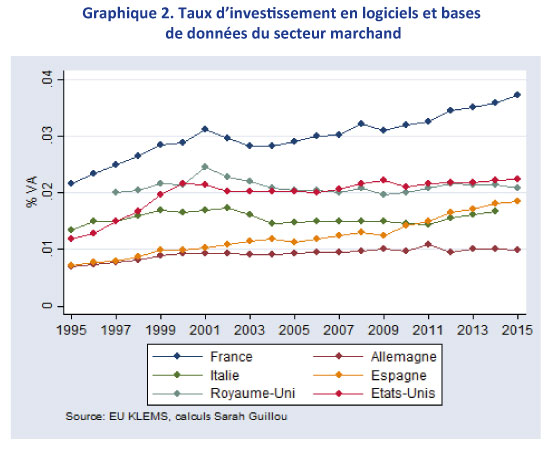
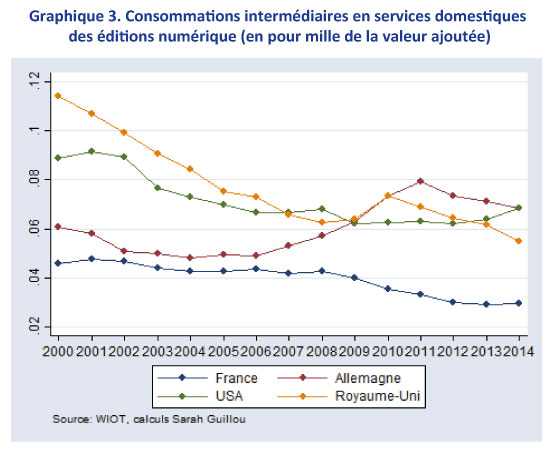
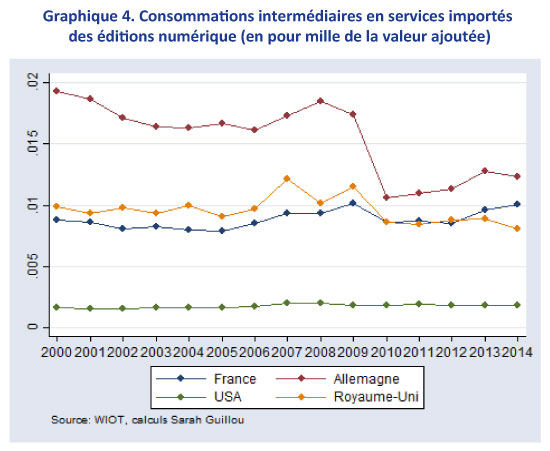
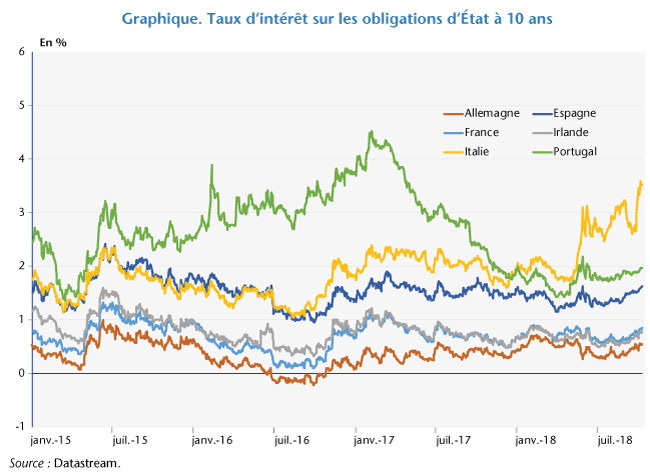
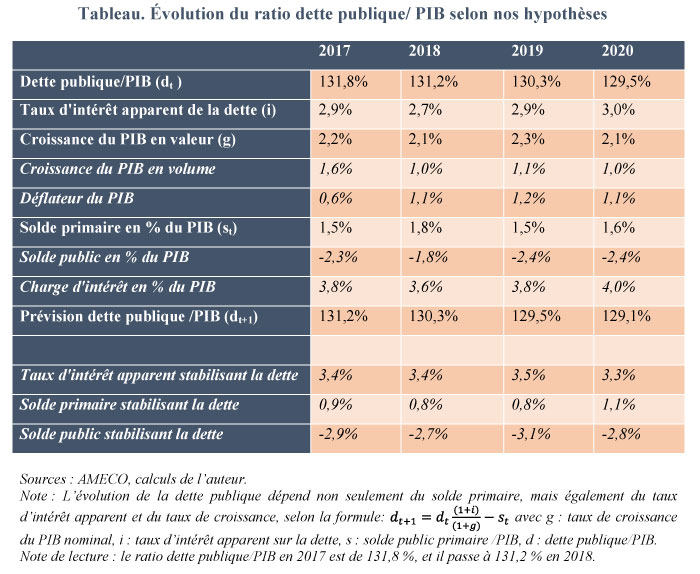
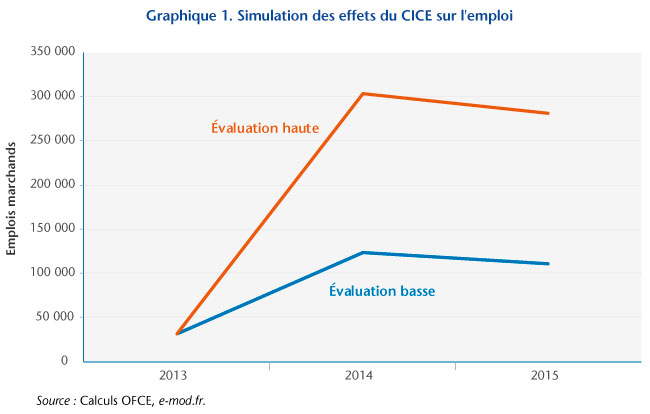
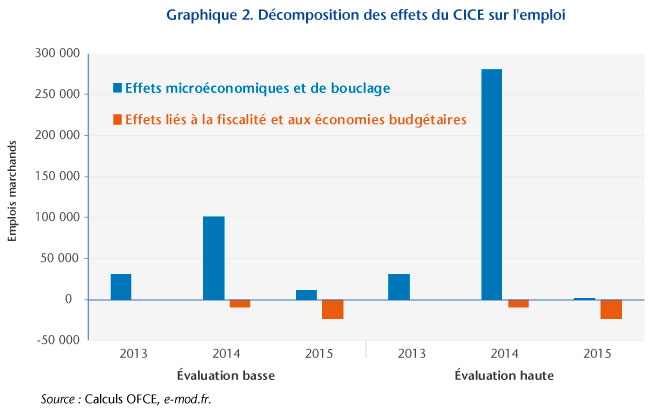
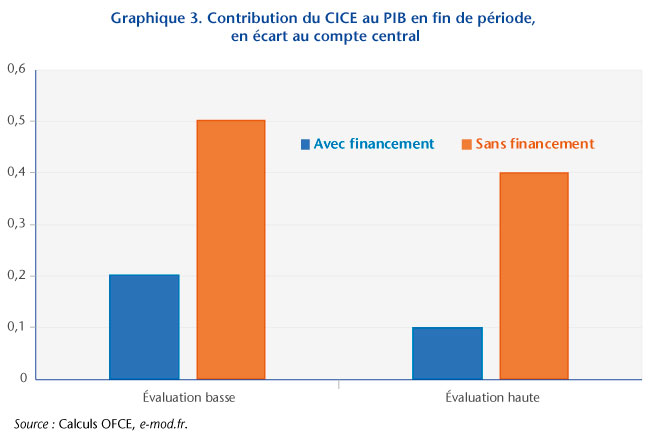
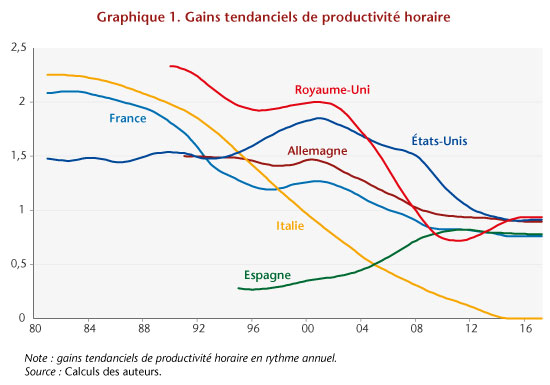 Le taux de croissance de la productivité tendancielle présente pour cinq pays (France, Allemagne, Italie, États-Unis et Royaume-Uni) une lente baisse depuis les années 1990. La tendance de productivité, estimée à 1,5% aux États-Unis dans les années 1980, augmente au cours des années 1990 avec la vague de nouvelles technologies, puis diminue progressivement pour atteindre 0,9% en fin de période. Pour la France, l’Italie et l’Allemagne le rattrapage s’interrompt au cours des années 1990 (au cours des années 2000 pour l’Espagne) bien que le ralentissement des gains de productivité tendanciels s’interrompe brièvement entre le milieu des années 1990 et le début des années 2000. Excepté l’Italie, dont les gains tendanciels de productivité estimés sont nuls en fin de période, les taux de croissance tendanciels convergent vers un intervalle compris entre 0,8% et 1% de gains annuels de productivité tendancielle.
Le taux de croissance de la productivité tendancielle présente pour cinq pays (France, Allemagne, Italie, États-Unis et Royaume-Uni) une lente baisse depuis les années 1990. La tendance de productivité, estimée à 1,5% aux États-Unis dans les années 1980, augmente au cours des années 1990 avec la vague de nouvelles technologies, puis diminue progressivement pour atteindre 0,9% en fin de période. Pour la France, l’Italie et l’Allemagne le rattrapage s’interrompt au cours des années 1990 (au cours des années 2000 pour l’Espagne) bien que le ralentissement des gains de productivité tendanciels s’interrompe brièvement entre le milieu des années 1990 et le début des années 2000. Excepté l’Italie, dont les gains tendanciels de productivité estimés sont nuls en fin de période, les taux de croissance tendanciels convergent vers un intervalle compris entre 0,8% et 1% de gains annuels de productivité tendancielle.