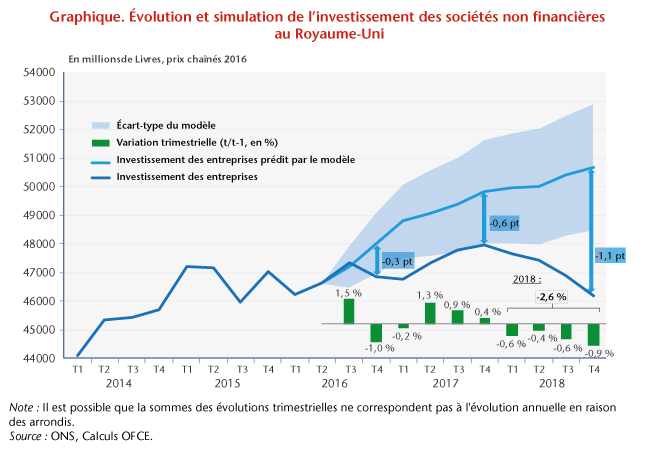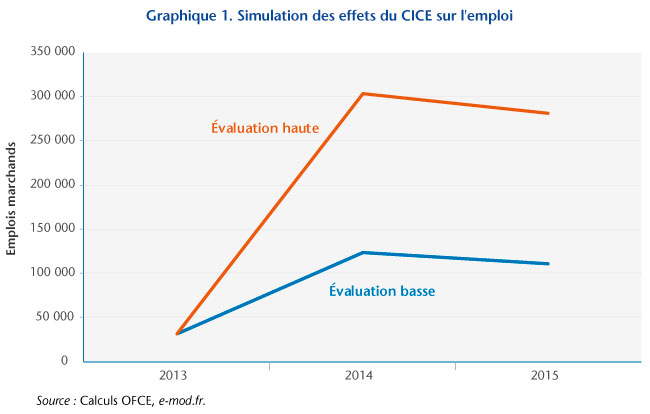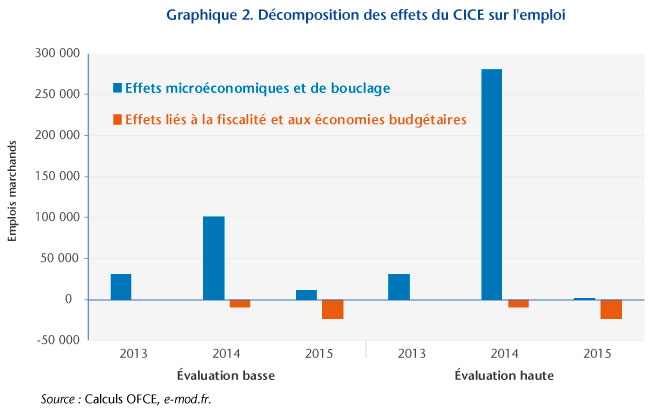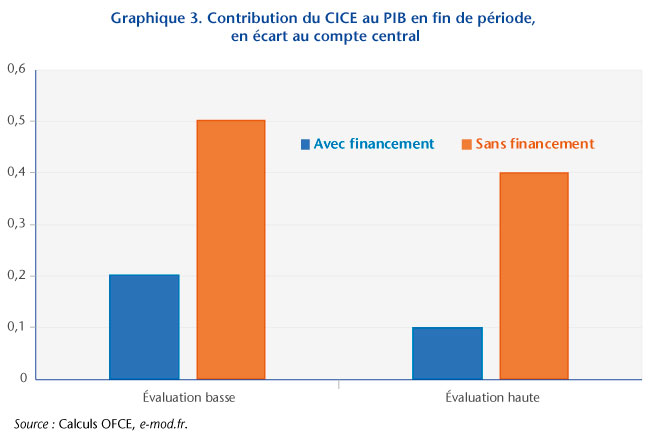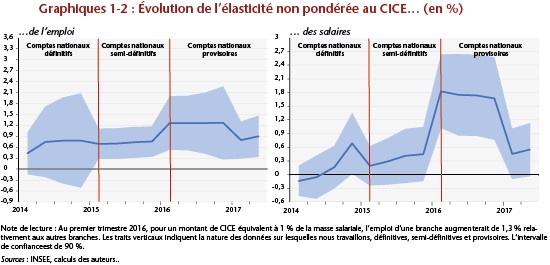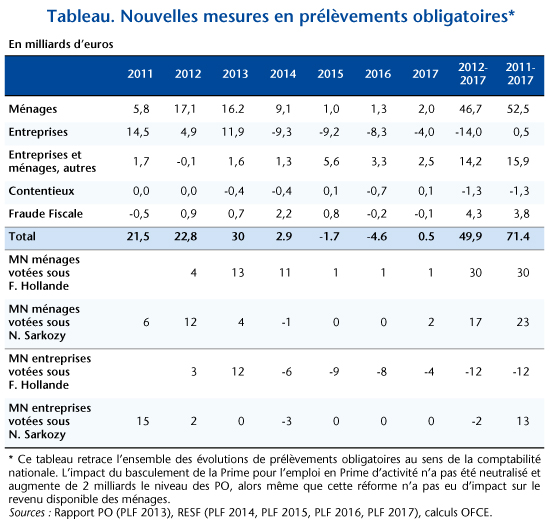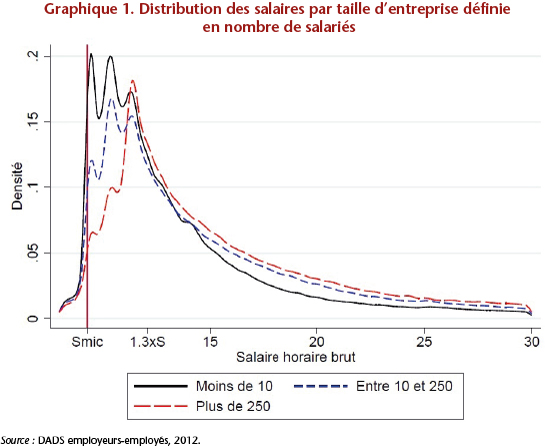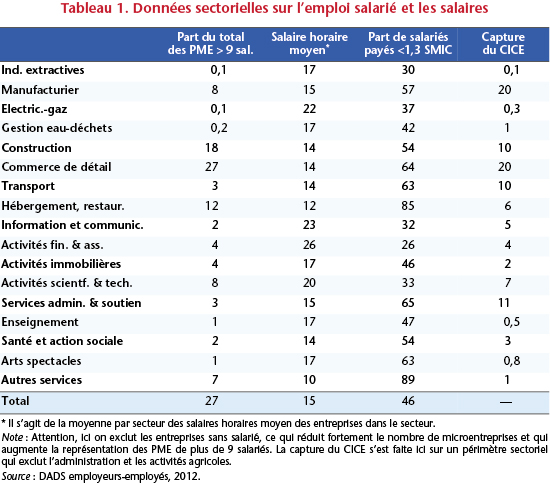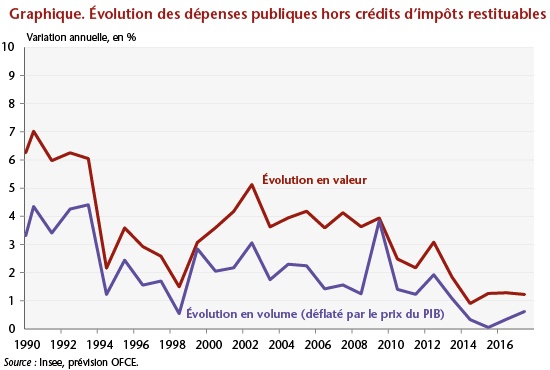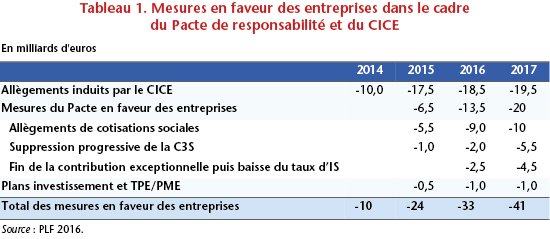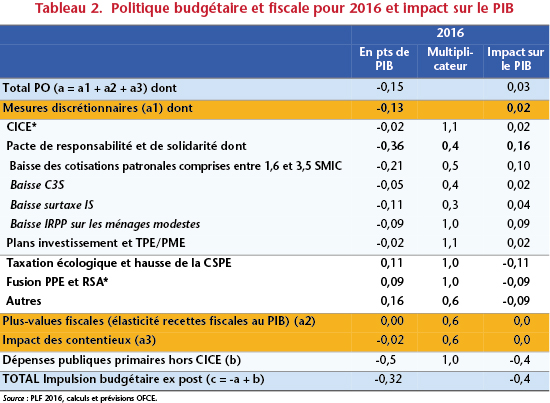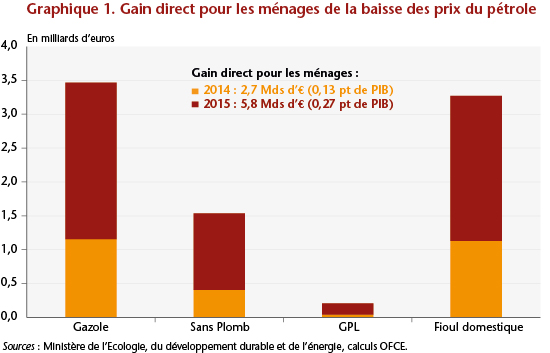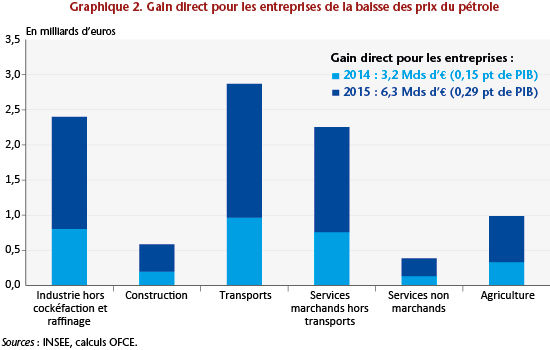par Jean-Luc Gaffard et Maurizio Iacopetta
Le gouvernement, fort de la loi visant à reconquérir l’économie réelle, dite loi Florange, qui institue la possibilité de votes doubles pour les actionnaires patients (conservant leurs actions au moins deux ans), vient de prendre deux décisions significatives en augmentant temporairement sa participation au capital de Renault et d’Air France afin d’éviter qu’en assemblée générale cette possibilité de votes doubles soit rejetée par la majorité qualifiée retenue dans la loi. L’objectif affiché par le Ministre de l’Economie dans une tribune du journal Le Monde est d’aider à « retrouver l’esprit industriel du capitalisme » en privilégiant les engagements à long terme de manière à promouvoir des investissements porteurs d’une croissance solide.
Cette initiative conduit à reprendre la discussion sur les conditions de gouvernance des sociétés par actions (‘corporations’) (Pollin, 2004, 2006), à examiner les dérives dont elle a pu être l’objet et les remèdes qui ont pu et pourraient dans l’avenir y être apportés, impliquant de savoir ce que peut en attendre le gouvernement.
Les sociétés par actions sont indéniablement au cœur du processus d’investissement, en raison de leur capacité à drainer une épargne abondante et de leur pouvoir de choisir dans quelle direction orienter cette épargne. Elles obéissent à des modes de gouvernance variés, répondant à différents contextes institutionnels, auxquels sont associées des différences significatives de productivité et de croissance (Bloom et Van Reenen, 2010 ; De Nicolo’, Laeven, et Ueda, 2008 ; La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer and Vishny, 2000). Aussi la question se pose-t-elle de l’adoption du mode de gouvernance le mieux à même de favoriser l’activité entrepreneuriale et l’innovation, bref de soutenir in fine la croissance (OECD 2012).
Il est manifeste, en effet, que les grandes entreprises ne souffrent pas d’un manque de financement à long terme. Le développement des marchés d’actions et d’obligations depuis les années 1980 leur a permis de réduire leur dépendance au financement bancaire et à la cyclicité de l’accès à ce financement. De sorte que les problèmes d’investissement reflètent surtout de larges défaillances dans la gouvernance des entreprises, grandes, moyennes ou petites, comme d’ailleurs dans celle des institutions financières (Giovannini et alii, 2015)
Classiquement, l’accent est mis sur les voies et moyens de contrôle des choix des managers par les actionnaires, autrement dit sur les conditions dans lesquelles les détenteurs de capitaux obtiennent le retour sur investissement que justifie leur position particulière de créancier résiduel (Shleifer et Vishny, 1997). Mais c’est oublier que d’autres acteurs de l’entreprise (créanciers, salariés, fournisseurs, voire clients) supportent des risques et que la performance à long terme de cette entreprise dépend des conditions dans lesquelles l’engagement des actionnaires commande celui des autres parties prenantes (‘stakeholders’) (Mayer, 2013). Il n’est pas certain, à cet égard, que la répartition des droits de vote entre différentes classes d’actions soit déterminante.
Contrôle et engagement
La question centrale concerne la façon dont la nature de la propriété du capital affecte les choix managériaux. Ainsi, les buts et valeurs des entreprises familiales reflètent-ils les intérêts et les humeurs de la famille propriétaire qui peuvent devenir contraires à l’efficacité productive, notamment quand se développe un capitalisme d’héritiers, quand ce ne sont plus les fondateurs qui sont à la direction des entreprises mais leurs héritiers ou plus subrepticement une caste qui s’auto-reproduit (Philippon 2007). S’il existe une relation positive entre la richesse des millionnaires self-made-men rapportée au PIB et à la croissance, la relation devient négative quand ce qui est rapporté au PIB est la richesse des héritiers millionnaires (Morck, Stangeland et Yeung 2000). Face à cette dérive possible, l’existence d’un actionnariat dispersé apparaît comme étant bénéfique en permettant que se substitue à des intérêts particuliers ce qui peut s’apparenter à un intérêt collectif.
Cette vision de la société par actions se heurte, toutefois, à l’objection formulée par Berle et Means (1932) qui voient dans la séparation entre la propriété et le contrôle une source d’inefficacité. Celle-ci crée des problèmes d’agence signifiant que les managers sont susceptibles d’agir dans leur intérêt propre plutôt que dans celui des actionnaires, comme peuvent le faire des familles ou les castes propriétaires. De facto, le Q de Tobin (le rapport de la valeur de marché au coût de remplacement du capital) augmente, puis diminue avant d’augmenter de nouveau à mesure que la puissance des managers s’accroît (Morck et alii, 1988). Il devient possible que les actionnaires soient moins incités à souscrire de nouvelles actions ou à conserver celles qu’ils détiennent avec pour conséquence une baisse du prix de ces actions et un moindre accès des entreprises au financement externe. Les dispositions qui permettent de protéger les grands groupes peuvent avoir pour conséquence d’entraver l’entrée de nouvelles entreprises et d’introduire de graves distorsions dans les décisions d’investissement des entreprises installées (Iacopetta, Minetti et Peretto, 2015).
La résolution de ces problèmes exige de créer les dispositifs institutionnels pour que les actionnaires puissent devenir actifs dans le management des entreprises.
Ces dispositifs ont consisté à améliorer la qualité des audits, de la gestion des risques et de la communication entre la société et ses actionnaires. Elles ont conduit à davantage de transparence dans la politique de rémunération des dirigeants et à lier cette rémunération aux performances. Ce faisant, elles ont permis le développement de marchés pour le contrôle des sociétés (‘markets for corporate control’) et celui de l’activisme des actionnaires, en fait d’une catégorie particulière d’actionnaires que sont les fonds de placement parmi lesquels les fonds de pension, dont les modes de gestion (la délégation des décisions d’investissement à des gestionnaires de fonds) privilégient les performances immédiates de leurs portefeuilles.
A la lumière de la crise financière, ces dispositifs semblent pour le moins questionnables (Giovannini et alii, 2015). Les institutions financières pourtant assujetties aux ‘meilleures’ règles de gouvernance, celles qui assurent le pouvoir de contrôle des actionnaires, ont été un lieu de conflit entre des actionnaires qui ont tiré parti des bonnes performances et les créanciers (puis les contribuables) qui ont dû assumer les pertes. Ce qui est avéré pour les institutions financières l’est également pour les entreprises industrielles qui sont devenues un lieu de conflit entre les actionnaires et les autres parties prenantes (créanciers, salariés, fournisseurs ou clients).
Le vrai problème est que les dispositifs censés résoudre les problèmes d’agence ont, certes, permis de renforcer le contrôle exercé par les actionnaires sur le management des entreprises, mais ont aussi fait reculer le degré d’engagement de ces mêmes actionnaires (Mayer, 2013).
Nonobstant leurs intérêts particuliers, les familles propriétaires peuvent garantir une stabilité et une durée d’engagement vis-à-vis des autres parties prenantes que ne garantissent pas des actionnaires dispersés. Il en est de même des managers bénéficiant d’une délégation d’autorité et ayant acquis suffisamment d’indépendance vis-à-vis des actionnaires pour être ouverts, certes à leur intérêt propre mais aussi aux intérêts des salariés (et des sous-traitants). Après tout, la constitution d’empires industriels est loin d’être une mauvaise chose dès lors qu’ils sont économiquement viables et ne contreviennent pas aux règles de la concurrence. Or cet avantage prêté aux managers est contrarié par le développement des marchés pour le contrôle des sociétés et par celui de l’activisme des actionnaires dont la conséquence est de juger de l’efficacité du management à l’aune des performances courantes. Il y a bel et bien un arbitrage à effectuer entre les exigences de contrôle et d’engagement. Le problème n’est peut-être pas tant d’aligner l’intérêt des managers avec ceux des actionnaires que de rendre les actionnaires responsables de ce qu’il advient à long terme des entreprises dans lesquelles ils investissent.
La mesure de l’engagement
Le degré d’engagement des financiers, prêteurs ou actionnaires, est décisif dans la mesure où il détermine celui des autres parties prenantes dans l’entreprise. Il est reflété dans l’attitude choisie en réponse aux fluctuations de performance et plus exactement dans le degré de tolérance à de mauvais résultats de l’entreprise. Une faible tolérance est le signe d’un faible degré d’engagement et c’est généralement la marque des prises de contrôle hostiles comme de l’activisme des fonds de pension.
Encore faut-il s’entendre sur la signification de mauvais résultats. Ils peuvent être la conséquence d’un mauvais management auquel cas le pouvoir des investisseurs de fournir des moyens de financement conditionnellement à la capacité du management de faire les changements qu’ils exigent n’est pas nécessairement le signal d’un moindre degré d’engagement. Il peut même prévenir les crises financières qui procéderaient de sérieux problèmes d’agence. Du moins si la régularité des performances constitue la norme. Or ce n’est précisément pas le cas quand les activités industrielles concernées ont une dimension cyclique. Les entreprises peuvent y pallier en compensant les résultats de plusieurs activités entre elles pourvu que leurs cycles soient différents. Or l’attitude des fonds de placement consiste à privilégier la diversification de leur portefeuille sur la valorisation de la diversification de leurs activités par les entreprises elles-mêmes, incitant ces dernières à se recentrer sur ce qui est parfois qualifié de leur cœur de métier. Les démantèlements qui s’ensuivent ont été l’un des facteurs de désindustrialisation en France dont témoignent, notamment, les cas d’Alstom, Alcatel ou encore Thomson (Beffa, 2012).
La régularité des performances ne prévaut pas davantage quand les entreprises font le choix d’innover en introduisant de nouveaux produits ou nouvelles techniques de production et en explorant de nouveaux marchés. Dans cette dernière hypothèse, il arrive qu’un surcroît de coûts précède l’augmentation des recettes, en d’autres termes qu’il existe des coûts irrévocables, c’est-à-dire dont la récupération est subordonnée à la réussite du choix d’innover (‘sunk costs’). Toute forme de gouvernance, qui aurait pour effet de privilégier les résultats immédiats et d’éliminer toute tolérance vis-à-vis de performances temporairement faibles ne peut alors que pénaliser l’innovation en pénalisant des investissements longs. Or c’est bien ce à quoi conduisent la possibilité de prises de contrôle hostiles et l’activisme des fonds de placement.
Les prescriptions institutionnelles
Le débat se trouve ainsi ouvert sur les tenants et aboutissants du conflit entre différentes catégories d’actionnaires établies en rapport avec le volume de titres détenu et la durée de cette détention (Bolton et Samama, 2012). De nombreuses entreprises ont adopté des mécanismes qui rémunèrent financièrement la loyauté des actionnaires ou qui leur accordent des droits de vote supplémentaires en récompense de cette loyauté. Des Etats (France, Italie notamment) ont légiféré dans ce sens. Il reste difficile d’en apprécier les conséquences. Théoriquement, le principe ‘une action – un vote’ ne l’emporte pas sur l’existence de plusieurs classes d’action impliquant des droits de vote différents. Il réduit, certes, les problèmes d’agence impliquant les détenteurs de blocs d’action, mais il réduit aussi les effets bénéfiques de la stabilité que ces blocs procurent (Burkart et Lee, 2008). Les études empiriques aboutissent, d’ailleurs, à des conclusions opposées les unes aux autres, ne faisant que signaler la complexité du problème (Adams et Ferreira, 2008).
Reste, cependant, que de nombreuses études empiriques confirment que les entreprises qui bénéficient d’une structure de propriété pérenne et obéissent à des indicateurs de performance qui ne se réfèrent pas uniquement au capital financier, ont de meilleurs résultats à long terme (Clark et alii, 2014). L’existence de blocs d’actionnaires stables ou de restrictions sur les droits de vote pourrait être des mécanismes susceptibles de garantir cette pérennité et de renforcer le degré d’engagement des apporteurs de capitaux justifiant que les autres parties prenantes – salariés, fournisseurs et clients – s’engagent à leur tour.
La difficulté avec les mécanismes de restriction des droits de vote est qu’ils ne permettent pas aux actionnaires d’indiquer la longueur de temps pendant laquelle ils veulent garder leurs actions et de signaler leur degré d’engagement (Mayer 2013). De fait, ceux qui entendent ne conserver leurs actions que peu de temps (éventuellement des millisecondes en cas d’échanges de haute fréquence) ont la même influence sur les décisions des managers que ceux qui entendent garder leurs actions pendant plusieurs années. Les premiers supportent les conséquences de leurs votes très peu de temps contrairement aux seconds, mais les uns et les autres ont la même influence sur décisions courantes qui peuvent affecter la performance de l’entreprise pour longtemps. Au fond, la mise en place de différentes classes d’actions ne se substitue pas forcément à la constitution d’un bloc stable d’actionnaires permettant de faire face à des prises de contrôle hostiles motivées par la recherche de plus-values à court terme.
Les choses peuvent être différentes quand la loyauté passée est récompensée financièrement par une augmentation des dividendes versés car, dans ce cas, la vente des actions fait perdre l’avantage financier acquis. Une incitation existe donc à conserver plus longtemps encore ces actions. Il reste que le versement de dividendes n’est jamais équivalent à la rétention de profits. Les fonds issus de nouvelles émissions sont sous le contrôle des actionnaires, alors que les profits non distribués restent sous le contrôle des managers. Plus les dividendes sont élevés et plus les entreprises sont dépendantes de leur capacité à recourir au marché d’actions. La question reste posée d’une trop grande dépendance vis-à-vis de l’éventuelle impatience des actionnaires les conduisant à peser en faveur d’investissements courts.
Dès lors un mécanisme pertinent possible pourrait être de fixer des droits de vote non pas en fonction de la durée passée de détention des actions, mais en fonction de la durée future à laquelle les actionnaires se sont engagés (Mayer, 2013). Suivant cette proposition, les actionnaires devraient pouvoir enregistrer la période pour laquelle ils entendent conserver leurs actions et être rémunérés sous la forme de votes fixés en rapport avec la longueur du temps restant à courir avant qu’ils ne soient en mesure de disposer de leurs actions. Ici « la loyauté et le double droit de vote des actions rémunèrent les actionnaires pour la période passée de leur détention et, par suite, échouent à les rendre davantage responsables des conséquences futures de leurs choix. Vraiment, dans la mesure où les actionnaires qui ont gardé longtemps leurs actions sont plus à même de les vendre, ils rémunèrent potentiellement une absence d’engagement » (Mayer, 2013, pp. 208-9). Convenons, toutefois, que cet arrangement institutionnel est difficile à mettre en œuvre concrètement, ne serait-ce qu’en termes de crédibilité et qu’il reste préférable d’explorer d’autres formes de gouvernance faisant place aux autres parties prenantes dans les processus de décision.
Sur les attentes du gouvernement
Au regard de l’analyse qui vient d’être développée, la question se pose de ce que le gouvernement peut attendre de sa décision d’imposer des droits de vote double. La réponse est que ce pourrait être principalement de diminuer, fut-ce de manière limitée, la dette publique sans perte d’influence dans les entreprises dont il détient des actions. L’intention de renouer avec un capitalisme industriel grâce à cette mesure, pour louable qu’elle soit, resterait sans véritable portée. D’autant que rien ne permet de penser que l’Etat se comporterait, dans le futur, différemment de n’importe quel autre actionnaire en dépit d’un droit de vote double, pouvant imposer ou contribuer à imposer des décisions managériales qui ne sont pas nécessairement dans l’intérêt à long terme des entreprises concernées et de leurs autres parties prenantes.
Aussi sans vouloir négliger ce que peut apporter l’existence de plusieurs classes d’action dans la détermination des choix stratégiques des entreprises notamment en introduisant possiblement une protection contre les OPA hostiles, il apparaît plus fondamental de réviser le modèle d’entreprise dans son ensemble.
Le degré d’engagement des apporteurs de capitaux commande celui des autres parties prenantes. Un financement intermédié est la première source de moyens financiers pour des propriétaires qui souhaitent garder le contrôle de leur entreprise. Il permet aux entreprises d’innover et de croître sans devoir recourir à une dispersion de la propriété. Encore est-il nécessaire que ce financement existe, autrement dit que les banques s’engagent pour une durée longue avec ces entreprises. Or elles sont elles-mêmes particulièrement affectées par des problèmes de gouvernance entraînant un conflit entre les deux principaux investisseurs que sont les actionnaires et les créanciers (Giovannini et alii, 2015). Si avancées institutionnelles il doit y avoir, elles devraient donc concerner le système financier et reposer sur un retour de l’intermédiation (Pollin 2006). Si intervention il doit y avoir sur les conditions de gouvernance des entreprises elles-mêmes, elles devraient s’inspirer des propositions de Mayer (2013) : peut-être, sous réserve de faisabilité, celle d’instituer des droits de vote au prorata du temps de détention futur, mais surtout celle d’instituer des conseils d’administration (‘boards of trustees’) qui fixent de grandes orientations en étant les gardiens de valeurs communes aux différentes parties prenantes (actionnaires, créanciers, salariés, voire fournisseurs ou clients) au lieu d’être seulement les représentants des actionnaires. Ces valeurs communes ne font rien d’autre que traduire la reconnaissance des complémentarités stratégiques, existant entre tous ces acteurs, qui sont à l’origine de la création de valeur.
Références
Adams, R. and and D. Ferreira (2008), “One Share-One Vote: The Empirical Evidence”,
Review of Finance 12, 51-91.
Beffa J-L (2012): La France doit choisir, Paris: Le Seuil.
Berle A. and G.C. Means (1932) : The Modern Corporation and Private Property, New York : Harcourt, Brace & World, Inc.
Bloom, N. and J. Van Reenen (2010) ‘Why Do Management Practices Differ across Firms and Countries?’ Journal of Economic Perspectives 24, 203-24.
Bolton, P. and F. Samama (2012), “L-Shares: Rewarding Long-Term Investors”,
ECGI Working Paper, No. 342/2013.
Burkart M. and S. Lee. (2008), ‘One Share-One Vote: The Theory’,
Review of Finance 12, 1-49.
Clark, G., A. Feiner and M. Viehs (2014), ‘From the Stockholder to the Stakeholder’,
Smith School of Enterprise and the Environment, Working Paper.
De Nicolò, G., L. Laeven and K. Ueda (2008) ‘Corporate Governance Quality: Trends and Real Effects’, Journal of Financial Intermediation 17, 198-228.
Giovannini A., Mayer C., Micossi S., Di Noia C., Onado M., Pagano M., et A. Polo (2015): Restarting European Long-Term Investment Finance. A green paper discussion document, CEPR Press. http://reltif.cepr.org/restarting-european-long-term-investment-finance
Iacopetta, M., R. Minetti and P. F. Peretto (2014) ‘Financial Markets, Industry Dynamics, and Growth’, Duke University Working Paper Series (ERID), 172
La Porta, R., F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer and R. Vishny (2000) ‘Investor Protection and Corporate Governance’, Journal of Financial Economics 58, 3-27.
Mayer C. (2013) : Firm Commitment, Oxford : Oxford University Press
Morck, R., A. Shleifer and R. Vishny (1988) : ‘Management Ownership and Market Valuation: An empirical analysis’, Journal of Financial Economics 20 : 293-315.
Morck R., Stangeland D. and B. Yeung (2000) : ‘Inherited Wealth, Corporate Control, and Economic Growth, in R. Morck ed. Concntrated Corporate Ownership, Chicago : University of Chicago Press.
OECD (2012) Corporate Governance, Value Creation and Growth. The Bridge between Finance and Enterprise, OECD, Paris. http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/50242938.pdf ).
Philippon T. (2007) : Le capitalisme d’héritiers : la crise du travail en France, Paris : Le Seuil.
Pollin J-P (2004) : ‘A propos de quelques ouvrages sur la gouvernance des entreprises’, Revue Economique 55 (2) : 333-346.
Pollin J-P (2006) : Essais sur la Gouvernance HAL Archives ouvertes https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00081933
Shleifer A. and R. Vishny (1997) : ‘A Survey on Corporate Finance’, Journal of Finance 52 (2) : 737-783.