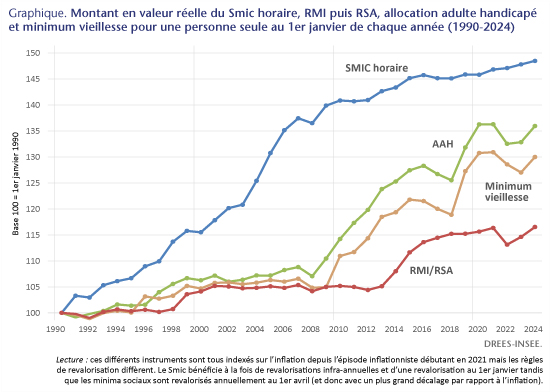par Bruno Ducoudré, Eric Heyer et Pierre Madec
En 2021, malgré le
rebond de l’activité attendu et la mise en œuvre de mesures exceptionnelles
pour l’emploi …
Le quatrième trimestre 2020 a été marqué par un recul de l’activité
économique moins marqué qu’attendu (-1,4% par rapport au troisième trimestre
2020). En conséquence l’ajustement de l’emploi a été largement atténué par
rapport aux destructions d’emplois attendues : 400 000 emplois ont
été détruits entre le quatrième trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2020. Dans
son dernier exercice de prévision, l’OFCE anticipe une croissance du PIB de 5%
en 2021 en moyenne annuelle[1].
Une partie de ce rebond s’explique par la prise en compte des effets du plan de
relance et notamment des mesures pour l’emploi (contrats aidés, insertion par
l’activité, prime à l’embauche d’un jeune de moins de 25 ans, mesures pour
l’alternance, Garantie Jeune, service civique, formations). Hors activité
partielle, ces mesures auraient contribué à la sauvegarde ou à la création de
75 000 emplois en 2020 et près de 70 000 emplois en 2021[2]
pour un coût de 6,7 milliards d’euros. L’activité partielle a permis la
préservation de 1,4 million d’emplois ETP en 2020 pour un coût budgétaire de
26,5 milliards d’euros. En 2021, 950 000 emplois ETP seraient encore
préservés en moyenne sur l’année pour un coût de 13,4 milliards d’euros, dans
l’hypothèse d’une baisse des taux de prise en charge à partir du troisième
trimestre 2021.
… nous anticipons une
hausse significative du chômage…
Malgré ce rebond et la prise en compte des mesures exceptionnelles
engagées par le gouvernement, l’emploi est attendu en baisse en 2021 par
plusieurs instituts de conjoncture (UNEDIC, Rexecode) ou stable (Banque France). L’OFCE prévoit une progression de
l’emploi en 2021 (+95 000 emplois en moyenne annuelle), mais une
progression plus rapide de la population active du fait du retour sur le marché
du travail de personnes découragées ou empêchées de chercher un emploi pendant
la crise sanitaire. Cela se traduirait par une hausse du chômage dont le taux
pourrait atteindre 8,7% fin 2021.
… qui induira une
hausse de la pauvreté globale…
Cette hausse du chômage va faire monter la pauvreté. Dans une étude menée en 2010 pour l’ONPES, l’OFCE indiquait qu’une hausse de 100 chômeurs pendant une crise
économique conduirait à une augmentation d’environ 43 pauvres au seuil de
pauvreté à 60% et d’environ 22 ménages
allocataires du RSA-socle 5 ans plus tard.
… notamment chez les
jeunes
La crise sanitaire et économique débutée en 2020 touche plus
particulièrement certains groupes, et notamment les jeunes. Le fait que les
jeunes soient plus touchés par le chômage n’est pas une surprise : ils
sont plus souvent en intérim et CDD et dans les crises, ces contrats ne sont
souvent pas renouvelés. Ils peuvent aussi être victimes du manque d’embauches.
La part de jeunes dans le halo du chômage a aussi légèrement augmenté sur 1 an
(de 4,5 à 4,7%).
Une typologie des
jeunes en difficulté
La situation des 18-24 ans (on compte 5,2 millions de personnes âgées
de 18 à 24 ans[3])
est particulièrement préoccupante à plusieurs titres :
- Soit parce qu’ils éprouvent des difficultés à s’insérer dans l’emploi
à la sortie des études ;
- Soit parce qu’ils sont exposés aux destructions d’emplois, et n’ont
pas forcément de revenus de remplacement (étudiants qui travaillent pour
financer leurs études, jeunes actifs qui perdent leur emploi).
Il est possible alors de distinguer 3 catégories de jeunes en
difficulté :
Catégorie 1 : cohorte de jeunes qui
arrivent sur le marché du travail au moment d’une crise économique
(750 000 jeunes chaque année)
Des travaux récents menés à l’OFCE rappellent que les premières années de
vie active sont un moment clé pour la carrière professionnelle, d’autant plus
en période de récession. Démarrer sa carrière dans un contexte économique très
dégradé peut induire des stigmates persistants et impacter durablement les
trajectoires professionnelles des jeunes sortant du système éducatif. Bien
entendu, une distinction doit être faite entre jeunes diplômés et non diplômés.
Pour la première catégorie, cela se traduit par un accès à l’emploi en CDI plus
tardif et moins fréquent tandis que pour la seconde, cela implique une très
nette dégradation de leur insertion sur le marché du travail.
Catégorie 2 : Jeunes actifs, ayant
terminé leurs études, qui ont perdu leur emploi et sans revenu de remplacement
(de 50 000[4] à 435 000[5])
Les jeunes actifs en emploi
(930 000) sont particulièrement exposés au choc entraîné par la crise sanitaire :
210 000 sont en CDD ou en contrats saisonniers. Parmi ces contrats
« précaires », 90 000 jeunes (30%) sont employés dans l’un des
secteurs les plus touchés par la crise (hébergement, restauration, culture,
transport, habillement, …). Parmi les « CDI », ce sont plus de
225 000 jeunes qui travaillent dans l’un des secteurs les plus touchés
soit près de 40% des 18-24 ans en contrat à durée indéterminée. Enfin, sur le
million d’actifs (en emploi ou non) âgé de 18-24 ans, près de 300 000
jeunes étaient en cours d’étude un an auparavant.
En 2020, l’ajustement de l’emploi salarié s’est concentré sur l’emploi
temporaire (CDD et intérim). Les 15-24 ans sont largement surreprésentés dans
l’emploi temporaire : s’ils comptaient pour 12% de l’emploi salarié en
2018 (hors fonctionnaires et assimilés), 40% des emplois temporaires étaient
occupés par des salariés appartenant à cette tranche d’âge (54% dans le
commerce, 45% dans l’hébergement-restauration).
En 2021, l’ajustement de l’emploi ne serait plus concentré sur les
contrats courts mais aussi sur des contrats à durée indéterminée. Or, d’après
les mouvements de main-d’œuvre au troisième trimestre 2020, ce sont les
salariés de moins de 30 ans qui sont les plus concernés par les licenciements
économiques du fait d’une moindre ancienneté.
Catégorie 3 : Jeunes actifs,
étudiants, en contrat court non renouvelé et sans revenu de remplacement (250 000)
;
Selon l’enquête ENRJ, menée par la DREES en 2014, ce sont 250 000
jeunes qui cumulent études et emploi à temps partiel ou à temps plein. Or, aujourd’hui
la protection sociale couvre très mal la catégorie des 18-24 ans. Ainsi, plus
de 8 jeunes sur 10 au chômage ne perçoivent aucune allocation chômage. Le fait
que les moins de 25 ans ne puissent pas accéder aux minima sociaux fait peser
un risque lourd de très forte précarisation sur cette population du fait de la
crise économique.
Face à cette diversité
de situation, nous proposons six mesures d’urgence
Parmi les six mesures, trois sont non ciblées et trois sont ciblées
sur les jeunes
Trois mesures non ciblées sur les jeunes
- Reporter la baisse du taux de prise en
charge de l’activité partielle par l’État et l’Unedic à la fin de la crise sanitaire
permettrait de préserver un maximum d’emplois en 2021. Au cours de l’années
2020, à l’instar d’un grand nombre de pays européens, la France a utilisé
l’activité partielle comme principal instrument de sauvegarde de l’emploi face
à la pandémie de la Covid-19. En préservant le capital humain dans les
entreprises ainsi que le revenu des salariés et en socialisant son coût, ce
dispositif était parfaitement adapté à la situation rencontrée l’année dernière
et favorisera une reprise de l’activité une fois les mesures prophylactiques
levées. Or il est prévu une baisse des taux de prise en charge de l’activité
partielle à compter du 1er juillet 2021 (dès le 1er mai
pour les secteurs non protégés). Nous estimons à 13,5 milliards d’euros le
montant nécessaire à la prise en charge de l’indemnisation de l’activité
partielle par l’État et l’Unedic en 2021 si le dispositif est maintenu dans ses
contours actuels et à prévision d’emploi inchangée. Mais baisser le taux de
prise en charge alors que les mesures prophylactiques ne sont pas toutes levées
pourrait se traduire par des destructions d’emplois en 2021. Certes, si ce
dispositif est parfaitement adapté à une période courte en temps de crise, son
maintien pendant une période longue et dans tous les secteurs y compris dans
ceux qui connaissent une nette amélioration de leur conjoncture pourrait
engendrer des effets plus négatifs (effet d’aubaine, mauvaise réallocation de
la main-d’œuvre…). En outre, si le dispositif d’aide à la formation du Fonds
national de l’emploi – FNE-Formation – a été renforcé afin d’accompagner
les entreprises en activité partielle, le maintien pendant une période longue
de l’activité partielle peut entraîner une déqualification d’une partie de la
main-d’œuvre ou ralentir le parcours des salariés désireux de se reconvertir.
Si le maintien dans l’emploi est assuré par l’activité partielle, ce statut
peut enrayer l’accès à une formation qualifiante ou la mise en place de mesures
d’accompagnement par rapport au statut de demandeur d’emploi. Autoriser l’accès
des salariés en activité partielle à l’accompagnement proposé par Pole Emploi
pour les demandeurs d’emploi de catégorie D ou E permettrait de répondre en
partie à cette potentielle demande d’accompagnement.
- Mettre en place un moratoire sur la
réforme de l’Assurance chômage tant que la situation sur le marché du travail n’est pas revenue à son
niveau qui prévalait avant la crise (taux de chômage à 7% ou difficultés de
recrutement à leur niveau de 2019).
- Prévoir une enveloppe de contrats aidés
additionnels pour les personnes de plus de 25 ans ayant perdu leur emploi en
2020. L’idée que,
durant cette crise économique, l’État puisse devenir « Employeur en
dernier ressort » permettrait d’éviter toute augmentation du chômage qui
laisserait des traces durables dans l’économie. Sur la base de notre dernière
prévision, cela correspond à la création de 500 000 emplois aidés fin 2021
à déployer dans le secteur du CARE notamment (soutien scolaire, portage de repas
à domicile pour les personnes âgées, logistique de la gestion de l’épidémie,
…). Ces 500 000 contrats aidés à temps plein pris en charge à 50% par l’État
(soit un coût annuel par contrat de 9 328 euros) représenteraient un coût
annuel de 4,7 milliards d’euros.
Le coût total de ces 3 mesures s’élèverait à près de 18,5 milliards
d’euros annuel (0,8% du PIB).
Trois mesures ciblées pour les jeunes
- Pour les jeunes
appartenant à la catégorie 1, nous proposons de renforcer le plan « 1
jeune 1 solution ». Le plan actuel offre 1,3 million de « solutions » ciblées
sur les jeunes de moins de 26 ans, pour un afflux cumulé de 1,5 million de
jeunes sur 2020-2021. Pour faire face à cet afflux arrivant sur le marché du
travail ou tombant dans l’inactivité en 2021, nous proposons une augmentation
de 200 000 du volume de contrats aidés PEC ciblés sur les moins de 26 ans, pour
un coût de 2,5 milliards d’euros annuels. Un premier pas a déjà été fait en
augmentant les entrées prévues dans le dispositif de la Garantie Jeunes en 2021
et en repoussant la fin des aides à l’embauche de jeunes de moins de 26 ans,
mais cela ne garantit pas une solution aux 1,5 million de jeunes arrivant sur
le marché du travail en 2020 et 2021. Ce plan pourra ainsi faire davantage de
place aux emplois aidés pour « les jeunes décrocheurs » : en
France, environ 140 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire
sans formation ni qualification et viennent alourdir le nombre de
« décrocheurs sans emploi ne suivant ni études ni formation ». Cette
catégorie, désignée par l’acronyme NEET, représente près de 2 millions de
jeunes dont la moitié serait sans aucun diplôme: si l’on veut réellement le
combattre, il est urgent de mettre en place une stratégie dans laquelle les
emplois aidés ont un rôle important à court terme : ce dispositif des
emplois aidés doit être ciblé sur les personnes les plus en difficulté (NEET),
ce qui permettra de réduire les effets d’aubaine, de diminuer les effets
d’enfermement dans ce type de contrat et d’augmenter les gains d’employabilité.
Par ailleurs, ces contrats doivent être d’une durée longue (au moins
2 ans), dans le secteur non marchand, être associés à un volet de
formation important, ciblés sur un métier d’avenir et peu éloignés des emplois
auxquels le bénéficiaire est susceptible de postuler ultérieurement. En effet, une étude de
terrain menée en 2017 a mis en avant l’intérêt des chefs d’entreprises du secteur privé
pour des jeunes ayant effectué une formation certifiante dans un contrat aidé
dans le secteur non marchand.
- Pour les jeunes
appartenant à la catégorie 2, nous proposons de leur verser une aide temporaire allant jusqu’à 560
euros par mois (435 000 jeunes au maximum). Cette aide interviendrait
en complément des revenus que certains pourraient toucher via les plans
d’accompagnement vers l’emploi. Elle nous paraît nécessaire au minimum tant que
la situation sur le marché du travail n’est pas revenue à son niveau qui
prévalait avant la crise. Le coût maximum de cette mesure s’élèverait ainsi à
240 millions d’euros par mois au maximum.
- Pour les jeunes
appartenant à la catégorie 3, nous proposons de leur verser une aide temporaire allant jusqu’à 560
euros par mois (250 000 jeunes). Cette aide interviendrait en
complément des prestations d’allocation chômage dont ils pourraient bénéficier.
Le coût estimé approche 140 millions d’euros par versement au maximum. Ce
versement devrait intervenir mensuellement tant que la situation sur le marché
du travail n’est pas revenue à son niveau qui prévalait avant la crise.
Le coût total de ces 3 mesures s’élèverait au maximum à 7 milliards
d’euros annuel (0,3% du PIB).
[1] Cf OFCE Policy Brief n°89 : « Perspectives
économiques 2021-2022 : résumé des prévisions du 14 avril 2021 », Eric
Heyer, Xavier Timbeau, Christophe Blot, Céline Antonin, Magali Dauvin, Bruno
Ducoudré, Amel Falah, Sabine Le Bayon, Catherine Mathieu Christine Rifflart,
Raul Sampognaro, Mathieu Plane, Pierre Madec, Hervé Péléraux, 14 avril 2021.
[2] Hors effet de l’extension de la prime à l’embauche
d’un jeune au-delà du 31 janvier 2021.
[3] Parmi eux, 1,6 million vivent dans un ménage qui n’est
pas celui leurs parents. Parmi eux, 350 000 sont étudiants, 140 000 sont
chômeurs, dont 84 000 ne perçoivent pas d’allocation chômage, 160 000 sont
inactifs, et 930 000 sont en emploi au sens du BIT.
[4] Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie
A, B ou C et âgés de moins de 25 ans a augmenté de 50 000 entre le quatrième
trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2020.
[5] Les 435 000 se
décomposent en : 210 000 en CDD ou en contrat saisonniers (8% de
moins d’1 mois, 15% entre 1 et 3 mois, 25% entre 3 et 6 mois et 30% entre 6
mois et 1 ans) ; 225 000 jeunes en CDI qui travaillent dans l’un des
secteurs les plus touchés soit près de 40% des 18-24 ans en contrat à durée
indéterminé.