
(Illustration par Dall-E – Bing Open AI)
par Guillaume Allègre
La question de la conditionnalité de l’assistance aux pauvres valides est très ancienne. Elle était récurrente dès les lois anglaises dites « Poor Laws » (lois sur les indigents) en place entre le XVIe et le XXe siècle. La solution qui s’est imposée à partir des années 1830 est celle des Workhouses (maisons de travail) et de la règle dite de « less eligibility » : pour recevoir un revenu, les indigents en capacité doivent obligatoirement travailler dans des maisons de travail. Le travail consistait typiquement à démonter de vieilles cordes ou à broyer des os pour faire de l’engrais. Les conditions de vie dans ces workhouses ne pouvaient être meilleures, selon la loi, que celles prévalant pour les travailleurs en dehors de ces maisons afin d’inciter à prendre un emploi en dehors de celles-ci. Avec le recul, les conséquences sont faciles à deviner, d’autant plus que la fin du XIXe siècle est une époque de grande paupérisation des travailleurs dont le niveau de vie est souvent à peine au-dessus du niveau de subsistance. Dans ces conditions, maintenir coûte que coûte un écart entre assistance et travail marchand, en abaissant les conditions de vie des assistés, et non en augmentant celles des travailleurs, mène à des conditions indignes pour les « assistés ». Outre les conditions indignes pour les « travailleurs assistés », ce système pose aussi un problème d’efficacité dans le sens où le labeur peut faire concurrence au travail marchand.
Ce système de travail contre assistance a été abandonné dans les pays développés – en Angleterre, les workhouses ont été fermées en 1930 – pour des systèmes de revenus minima garantis, soit des allocations en espèces à destination des personnes valides d’âge actif. En France, le RMI fut instauré en 1989, remplacé par le RSA en juin 2009. Tous les pays de l’Union européenne ont aujourd’hui un revenu minimum garanti qui prend la forme d’une allocation dégressive selon les revenus du foyer, inférieure au seuil de pauvreté fixé à 60% du niveau de vie médian, et conditionnée à des efforts d’insertion sociale et professionnelle (de l’allocataire et selon les pays possiblement de son ou sa conjointe). Ces principes sont ainsi aujourd’hui adoptés de façon quasi-universelle dans les pays suffisamment riches. Cependant, le niveau du revenu varie fortement selon les pays et les compositions familiales (entre 15 à 60% du niveau de vie médian – OCDE), et les conditionnalités sont également hétérogènes entre pays (Commission européenne). Depuis une vingtaine d’années, la tendance va dans le sens d’un durcissement de la conditionnalité (récemment, Universal Credit au Royaume-Uni, RSA en France…). Ce durcissement peut concerner l’obligation de participer à des rendez-vous avec un conseiller, des formations ou des ateliers, de remplir des agendas d’activité, d’aller à des entretiens d’embauche, d’accepter des offres d’emploi jugées convenables. Ces obligations sont assorties de sanctions plus ou moins importantes.
Suivant cette tendance, le gouvernement entend proposer une loi traduisant la volonté d’Emmanuel Macron, formulée durant la campagne présidentielle et rappelée depuis, d’une obligation pour les allocataires du RSA « de consacrer 15 à 20 heures par semaine pour une activité permettant d’aller vers l’insertion professionnelle, soit de formation en insertion, soit d’emploi et d’être mieux accompagné ». Selon le Ministre du Travail et la Première ministre, l’obligation en termes de durée d’activité ne serait pas inclue dans la loi mais dans les contrats d’engagement réciproque signés par les allocataires. Dans la lignée du rapport Guilluy, les deux ministres insistent sur la création de nouvelles sanctions graduelles et ainsi sur l’importance de ces sanctions pour faire respecter les devoirs des allocataires.
Il existe plusieurs justifications possibles à la conditionnalité et à la logique de sanctions, et il est important de ne pas les confondre.
Une première justification souligne que la conditionnalité bénéficie aux assistés eux-mêmes car elle augmente leur probabilité de trouver un emploi. C’est une justification paternaliste dans la mesure où il s’agit de faire le bien des assistés contre eux-mêmes. Autrement, pourquoi les obliger à des activités d’insertion s’ils cherchent leur propre bien, c’est-à-dire s’ils sont rationnels ? Une telle justification implique un défaut de rationalité qui peut être lié à la paresse, à une courte-vue ou à un manque d’information… Elle s’appuie de plus sur un principe d’efficacité : la situation des plus défavorisés est censée s’améliorer, ce qui est empiriquement testable, par exemple en regardant a minima si l’emploi des personnes concernées est plus élevé à moyen ou long-terme.
Une seconde justification ne prend pas le point de vue des « assistés » mais celui des non-assistés censés financer le dispositif d’assistance, et notamment celui des travailleurs pauvres. Selon cette justification, les assistés doivent contribuer sous forme de contrepartie au versement des aides sociales. C’est un principe de justice : il s’agit de justice contributive selon la règle aristotélicienne « à chacun son dû ». Le montant d’heures obligatoires d’activité d’insertion proposé par le Président (15 à 20h hebdomadaires) tend à confirmer cette impression de justice contributive puisque le montant du RSA pour une personne seule – 607 euros – correspond environ à un demi-Smic net à temps-plein – 1 383 euros. Mais l’histoire des workhouses rappelée en introduction souligne la contradiction à demander une contribution sous forme de travail à ceux à qui on verse une allocation parce qu’ils sont dans l’incapacité de… contribuer (selon la Constitution, « tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ». Le risque est de demander aux assistés de casser des cailloux au bord d’une route afin de rassurer le contribuable – et/ou les travailleurs pauvres – quant à la pénibilité effective des conditions de vie des « assistés ».
Il existe une troisième justification à la conditionnalité des minima sociaux. Elle s’appuie sur l’application d’un principe de réciprocité. Pour faire très court[1], un revenu minimum garanti est justifié parce que, au sein d’une communauté politique, « on fait société ». Le revenu d’assistance ne peut donc financer des formes de séparatisme social ; selon les termes de Rawls, la société n’a pas à nourrir les surfeurs (voir notre discussion ici). La société est ainsi légitime à demander une réciprocité aux « assistés », sous la forme d’une obligation d’efforts d’insertion sociale et professionnelle. Cette demande de réciprocité est dans l’intérêt des bénéficiaires de minima sociaux dans la mesure où elle est la fondation d’un consentement social à un minimum social généreux.
Concernant le renforcement de la conditionnalité du RSA, le Président et le gouvernement alternent successivement entre ces justifications et parfois les confondent. Il n’est pas anodin que le Président commence son interview télévisée du 22 mars à ce sujet par l’argument suivant : « Beaucoup de travailleurs disent : « vous nous demandez des efforts (mais) il y a des gens qui ne travaillent jamais (et qui…) auront le minimum ». Le Président prend donc explicitement comme point de départ le point de vue des travailleurs, présumés en proie à une forme de lassitude de la solidarité, voire de ressentiment. Ce point de vue est une impasse car les efforts ou la contribution demandés aux allocataires ne sera jamais suffisante du point de vue des non-allocataires.
L’obligation est-elle efficace ?
Le discours défendant le renforcement de la conditionnalité confond également l’accompagnement et l’obligation d’accompagnement. Le rapport Guilluy (2023) peut ainsi souligner « qu’il est grand temps d’investir significativement dans l’accompagnement de celles et ceux qui en ont besoin » tout en insistant sur les sanctions des allocataires qui ne satisferaient pas aux exigences de l’accompagnement (le terme sanction est mentionné 85 fois dans le rapport). Il y a un décalage inquiétant entre cette fixation sur les sanctions des allocataires et le constat fait par la Cour des comptes, et rappelé dans le rapport Guilluy, de manquements de la part des pouvoirs publics et « d’un défaut de substance » dans les parcours d’accompagnement : « La durée moyenne des contrats (d’engagement réciproque) est inférieure à une année, le nombre d’actions est très faible (souvent moins de deux actions par contrat), les actions proposées sont peu engageantes et ne présentent que rarement les caractéristiques d’une démarche susceptible d’aider le bénéficiaire de manière concrète. » Á la lecture de ce rapport, dans un souci d’efficacité, l’obligation d’activités d’insertion devrait avant tout peser sur les pouvoirs publics : si l’objectif est que les allocataires effectuent ces activités, avant de les contraindre, il faudrait déjà leur en proposer. Une posture de défiance a priori va à l’encontre du principe de réciprocité.
La justification du durcissement de la conditionnalité en termes de meilleure insertion est un principe d’efficacité qui peut être testé empiriquement : que disent les études économiques sur les effets d’un durcissement de la conditionnalité en termes d’obligation d’accompagnement ? Soulignons d’abord qu’il est difficile de parler de consensus académique à ce sujet : les études existantes ont été réalisées dans plusieurs pays, notamment de l’Union européenne, dans des contextes économiques différents, sur des minima sociaux qui varient en niveau et avec des types de conditionnalité qui diffèrent d’une étude à l’autre. Les sanctions sont de plus souvent pilotées localement et dépendent parfois de l’arbitraire des référents (arbitraire qui peut évoluer selon le discours politique ambiant et/ou les mesures réellement votées). Cela dit, on peut dire avec un niveau de confiance élevé que le durcissement de la conditionnalité a un impact potentiellement important sur … le non-recours aux minima sociaux. En effet un durcissement de la conditionnalité aggrave un nombre important de facteurs expliquant le non-recours : crainte de la stigmatisation, complexité des règles, contrôle des bénéficiaires, valeur morale de « non-dépendance » à l’égard de la société, crainte d’une sanction arbitraire, défiance vis-à-vis d’une personne détenant une autorité (DREES, 2022)… Il n’est pas anodin que le non-recours soit estimé en France à 34% pour les éligibles au RSA un trimestre donné (20% de façon pérenne pour les foyers éligibles 3 trimestres consécutifs). À titre de comparaison, le non-recours aux allocations logement, qui concernent en partie le même public, est estimé à environ 5% et la différence s’explique en grande partie par le caractère conditionnel du RSA[2].
Quid des effets du durcissement de la conditionnalité du minimum social sur la situation professionnelle des allocataires ? Ces dispositifs augmentent-ils les chances pour ces publics à retrouver un emploi (stable et de qualité)? Sur ce point, le niveau de confiance dans les résultats empiriques (européens) est moins élevé en raison d’effets allant dans des directions opposées. Il y a des allocataires de minima sociaux pour lesquels l’accompagnement et l’obligation d’accompagnement ont un effet bénéfique en termes d’information ou de motivation, ce qui se traduit par une sortie vers l’emploi plus rapide. Cette sortie peut se faire soit avec une qualité de l’emploi non dégradée[3] (effet 1, +[4]), soit vers un emploi de qualité dégradée. Une sortie vers un emploi « dégradé » peut être un tremplin vers un emploi de meilleure qualité (effet 2a, +), ou être un frein (effet 2b, -). Cette deuxième possibilité, souvent ignorée, ne doit pas être sous-estimée : l’emploi de mauvaise qualité est souvent une trappe car il réduit – par rapport au chômage – la recherche d’emploi de meilleure qualité en raison des risques et du coût (notamment en temps) à passer d’un emploi à l’autre. En allant plus rapidement vers l’emploi, certains allocataires du RSA vont dépasser d’autres chômeurs dans la file d’attente et ces derniers resteront plus longtemps au chômage (effet 3, -). Cet effet d’équilibre n’est pas toujours bien évalué dans les études. Enfin, pour certains allocataires du RSA, l’obligation d’accompagnement n’entraînera pas une sortie vers l’emploi mais au contraire une sortie vers le bas, c’est-à-dire vers le non-recours. Or, le non-recours augmente la vulnérabilité du public visé et donc à terme, sa probabilité de sortir vers l’emploi stable et de qualité (4, -) : la vraie trappe à pauvreté est ainsi la pauvreté elle-même. Tous ces effets s’additionnent et l’impact global est difficile à estimer. Il est de toute façon difficile à résumer avec un chiffre ou une moyenne. Par exemple, dans leur revue de littérature d’études publiées en anglais, Pattaro et al. (2022) soulignent que « … les études sur le marché du travail, couvrant les deux tiers de [leur] échantillon, rapportaient systématiquement des impacts positifs pour l’emploi mais négatifs sur la qualité et la stabilité de l’emploi à plus long terme ainsi que des transitions accrues vers le non-emploi ou l’inactivité économique ». L’impact serait donc : emploi (+), qualité emploi (-), précarité (+), inactivité (+). Mais les auteurs signalent aussi des effets en termes de maltraitance des enfants et de dégradation du bien-être infantile ! Il ressort donc qu’à court-terme, les effets apparaissent positifs, alors qu’à long et très long-terme ils sont négatifs. La conditionnalité et les sanctions accroissent les inégalités parmi le public visé : le retour plus rapide à l’emploi concerne par construction ceux qui sont les plus proches de l’emploi tandis que la chute dans l’inactivité concerne ceux qui sont les plus éloignés.
Une politique efficace d’accompagnement vers l’emploi devrait viser à réduire ces inégalités, ce qui nécessite de mettre en place des politiques basées sur le volontariat, moins stigmatisantes, et non une obligation couplée à la sanction. Un accompagnement renforcé apparaît statistiquement plus efficace, en termes de retour à l’emploi, lorsqu’il bénéficie aux personnes les plus proches de l’emploi mais en termes d’intérêt général, il est probablement préférable de cibler au contraire les plus éloignés du marché du travail. De plus, le renforcement de la conditionnalité impliquerait d’accentuer la distinction, parmi les allocataires, entre ceux qui relèvent du parcours social et ceux qui relèvent du parcours professionnel. C’est un problème : quel que soit leur éloignement de l’emploi, un accompagnement utile pour chaque allocataire requiert l’accès à une large gamme d’interventions, sociales et professionnelles.
Les discours abstraits sur les « droits et devoirs » des « assistés » ne font que masquer la pauvreté de leurs droits (à un emploi, à un revenu convenable, à des politiques d’insertion). À viser un accompagnement intensif et obligatoire pour tous, mais à moindre coût, le risque est grand de mettre en place un système technocratique où les accompagnants font semblant d’accompagner des allocataires qui font semblant de se mobiliser.
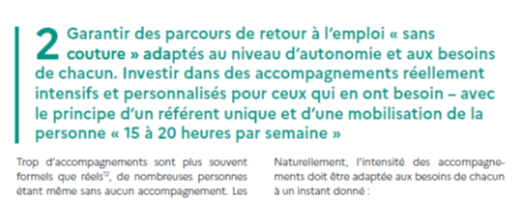
Que faire ? Le pari de la réciprocité
À l’inverse, suivant une logique de réciprocité, il faudrait revenir aux principes qui guidaient le Revenu minimum d’insertion créé en 1989. À l‘époque, c’était le revenu lui-même qui insérait (revenu d’insertion)[5] ; le devoir d’effort d’insertion pesait d’abord sur les pouvoirs publics[6] et la réciprocité était présumé ex-ante : le bénéficiaire des minima sociaux n’avait pas à faire preuve d’efforts avant de recevoir la prestation, mais celle-ci pouvait être suspendue dans quelques cas exceptionnels, en cas de manquement manifeste[7]. La réciprocité est toujours un pari et implique un certain niveau de confiance ; elle ne doit pas être confondue ni avec la logique rétributive, ni avec la logique paternaliste et punitive.
[1] Pour une argumentation complète, voir Rawls, Théorie de la Justice.
[2] Il existe tout de même deux autres différences importantes. Premièrement, les allocations logement peuvent être perçues comme une subvention, ce qui est moins stigmatisant qu’un revenu d’assistance. Deuxièmement, le calcul d’éligibilité était réalisé sur une base annuelle, ce qui permet un lissage des revenus. Il est préférable de comparer le non-recours de 5% au 20% du RSA qui ne recourent pas de façon pérenne. En effet, d’autres ont droit au RSA de façon ponctuelle sur 1 trimestre mais n’y recourent pas par manque d’information ou pour limiter le coût administratif ou parce qu’ils considèrent ne pas en avoir besoin.
[3] Par rapport aux emplois qui auraient été repris sans conditionnalité renforcée.
[4] On indique par « + » ou « – » si les effets de l’accompagnement sur l’emploi et sa qualité sont positifs ou négatifs.
[5] « L’important est qu’un moyen de vivre ou plutôt de survivre soit garanti à ceux qui n’ont rien, qui ne peuvent rien, qui ne sont rien. C’est la condition de leur réinsertion sociale » François Mitterrand, 1988, Lettre aux Français.
[6] Le titre 3 de la loi de 1989 commence à décrire le dispositif départemental d’insertion et les obligations qui incombent au Conseil départemental (chapitre 1), puis le dispositif local d’insertion (chapitre 2) puis enfin le contrat d’insertion et la nature des ‘engagements réciproques’ (chapitre 3). L’article 42-5 prévoit que : « L’insertion proposée aux bénéficiaires du Revenu minimum d’insertion et définie avec eux peut, notamment, prendre une ou plusieurs des formes suivantes ».
[7] Par dérogation aux articles 13 et 14, le représentant de l’État suspend le versement de l’allocation dans les cas suivants :
- Lorsque l’intéressé ne s’engage pas dans la démarche d’insertion, notamment en vue de signer le contrat d’insertion, ou son renouvellement, ou encore ne s’engage pas dans sa mise en œuvre ; l’absence à deux convocations consécutives sans motif grave entraîne la suspension de l’allocation ;
- Lorsque des éléments ou informations font apparaître que les revenus déclarés sont inexacts ou que l’intéressé exerce une activité professionnelle.