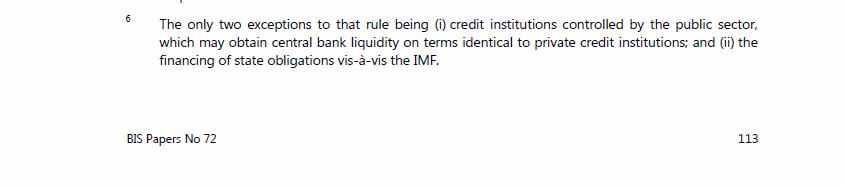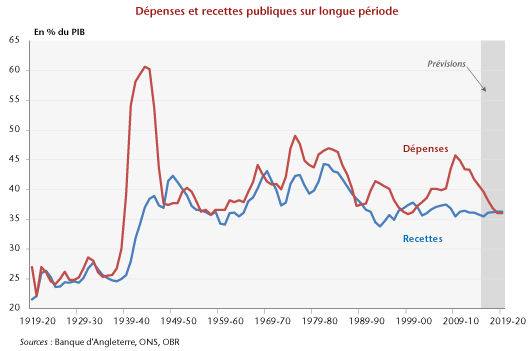Un nouvel arrangement pour le Royaume-Uni dans l’UE : les leçons européennes de l’accord du 19 février
par Catherine Mathieu et Henri Sterdyniak
A la suite des demandes d’un nouvel arrangement pour le Royaume-Uni dans l’UE formulées par David Cameron le 10 novembre 2015, le Conseil européen des 18 et 19 février a abouti à un accord. Compte-tenu de ce texte, le peuple britannique sera appelé aux urnes le 23 juin pour décider de rester ou non dans l’UE. Cet épisode soulève de nombreuses questions quant au fonctionnement de l’UE.
- – Le Royaume-Uni a mis en question les politiques européennes sur des points qu’il jugeait cruciaux pour lui-même et a obtenu, en grande partie, gain de cause. Sa fermeté a payé. Cela soulève des regrets de ce côté-ci de la Manche. Pourquoi la France (et l’Italie) n’ont-elles pas eu une attitude similaire en 2012, par exemple, quand l’Europe imposait la signature du traité budgétaire et la poursuite de politiques d’austérité ? Cela soulève des inquiétudes : ce qui a été autorisé à un grand pays sera-t-il toléré pour un plus petit ? La menace de départ du Royaume-Uni est crédible car l’UE est devenue très impopulaire parmi les peuples (particulièrement en Angleterre) et parce que le Royaume-Uni est autonome financièrement (il s’endette sans peine sur les marchés financiers) et économiquement (c’est un contributeur net au budget de l’UE). Un pays dépendant davantage de l’Europe n’aurait guère de choix. Cela soulève des craintes : ne verra-t-on pas d’autres pays suivre cet exemple à l’avenir ? L’Europe pourra-t-elle échapper au modèle d’Europe de club à la carte (chacun participe aux activités qui l’intéresse) ? Mais un modèle de participation forcée est-il préférable ? L’Europe doit permettre à un pays de s’abstraire de politiques qu’il juge néfaste.
- – Le Royaume-Uni organisera donc un référendum, ce qui est satisfaisant du point de vue démocratique. Les derniers référendums n’ont guère donné des résultats favorables à la construction européenne (en France et aux Pays-Bas en 2005, en Grèce en juillet 2015, au Danemark en décembre 2015). En même temps, les Britanniques n’auront le choix qu’entre quitter l’UE (la possibilité d’une nouvelle renégociation si le référendum donnait la majorité pour une sortie de l’UE étant clairement écartée par l’accord de février) ou y rester avec un statut allégé ; la voie selon laquelle le Royaume-Uni resterait dans l’Union et chercherait à la rendre plus sociale, celle préconisée par une partie des travaillistes et par les nationalistes écossais, ne sera pas proposée. C’est dommage.
- – Le Royaume-Uni s’exonère explicitement de la nécessité de l’approfondissement de l’UEM, d’une « union sans cesse plus étroite », d’une « intégration plus poussée », toutes formules qui figurent dans les traités. Le projet d’arrangement précise que ces notions ne constituent pas une base légale pour élargir les compétences de l’Union. Les Etats non membres de la zone euro conservent le droit d’évoluer, ou non, vers une intégration plus poussée. Cette précision est, selon nous, la bienvenue. Il ne serait pas légitime que les compétences de l’Union soient en permanence élargies sans l’accord des peuples. Dans la période récente, les cinq présidents et la Commission ont proposé de nouveaux pas vers le fédéralisme européen : création d’un Comité budgétaire européen, création de Conseils indépendants de compétitivité, conditionnement de l’octroi des fonds structurels au respect de la discipline budgétaire, à la réalisation des réformes structurelles, création d’un Trésor européen, évolution vers une Union financière, unification partielle des systèmes d’assurance chômage. Cette évolution renforcerait le pouvoir d’organismes technocratiques au détriment des gouvernements démocratiquement élus. Ne serait-il pas nécessaire que l’accord des peuples soit explicitement demandé et obtenu avant de s’engager dans cette voie ?
- – La sortie du Royaume-Uni, un certain éloignement de fait de certains pays d’Europe centrale et orientale (Pologne, Hongrie), les réticences du Danemark et de la Suède pourraient pousser à passer explicitement à une Union à deux vitesses, voire, pour reprendre une formulation de David Cameron d’une Union où les pays vont vers des destinations différentes. Les pays de la zone euro accepteraient, eux, de nouveaux transferts de souveraineté et bâtiraient une union budgétaire et politique poussée. Selon nous, ce projet devrait être soumis aux peuples.
- – En même temps, le projet d’accord stipule que l’Eurogroupe n’a pas de pouvoir législatif, celui-ci reste entre les mains de l’ensemble du Conseil. Le Royaume-Uni a fait préciser qu’un Etat non membre de la zone euro pourra demander au Conseil européen de se saisir d’une décision concernant la zone euro ou l’Union bancaire, dont il estime qu’elle nuit à ses intérêts. Le principe de l’autonomie de la zone euro n’a donc pas été proclamé.
- – Le Royaume-Uni a fait préciser qu’il n’est pas tenu de contribuer financièrement à la sauvegarde de la zone euro ou des établissements financiers de l’Union bancaire. Ce qui peut être jugé déplaisant vis-à-vis du principe de solidarité européenne, mais peut se comprendre. C’est parce que la mise en place de la zone euro a aboli le principe : « Chaque pays souverain bénéficie de l’appui total d’une banque centrale, prêteuse en dernier ressort » que le problème de sauvegarde se pose. Le Royaume-Uni (et ses banques) peut, lui, être soutenu par la Banque d’Angleterre.
- – Le Royaume-Uni a fait rappeler les principes de subsidiarité. Une nouvelle disposition prévoit que les parlements représentant 55% des Etats membres peuvent remettre en cause un texte législatif qui ne respecterait pas ce principe. Le Royaume-Uni a fait noter que les questions de justice, de sécurité, de liberté restaient de compétence nationale. Il est dommage que les pays attachés à la spécificité de leurs systèmes sociaux, de leurs systèmes de négociation salariale, n’aient pas fait de même.
- – Il est compréhensible que des pays, soucieux de souveraineté nationale, soient agacés (pour ne pas dire plus) par les intrusions incessantes de l’UE dans des domaines qui relèvent de la compétence nationale, où les interventions européennes n’apportent guère de valeur ajoutée. Il est compréhensible que ces pays refusent de devoir en permanence se justifier à Bruxelles sur leurs politiques économiques ou sur leurs règles économiques, sociales ou juridiques quand celles-ci n’ont aucune conséquence sur les autres Etats membres. L’Europe devra sans doute tenir compte de ce sentiment d’exaspération.
- – En ce qui concerne l’Union bancaire, le projet de texte est volontairement confus. Il est rappelé que le règlement uniforme, géré par l’Agence bancaire européenne (ABE), s’applique à toutes les banques de l’Union ; que la stabilité financière et des conditions égales de concurrence doivent être garanties. Mais, en même temps, il est écrit que les Etats membres qui ne participent pas à l’Union bancaire conservent la responsabilité de leurs systèmes bancaires et peuvent appliquer des dispositions particulières. Par ailleurs, les pays non-membres de la zone euro ont un droit de véto à l’ABE. Cela repose la question du contenu même de l’Union bancaire. Celle-ci permet-elle de prendre les mesures nécessaires pour réduire le poids de l’activité financière spéculative en Europe et d’orienter les banques vers le financement de l’économie réelle ? Ou son objectif est-il de libéraliser les marchés pour permettre le développement de l’activité financière en Europe, pour concurrencer Londres et les places financières extra-européennes ? Dans le premier cas, il aurait fallu mettre clairement le marché en main à Londres, lui dire que l’appartenance à l’UE suppose un contrôle étroit des activités financières. Lui dire que son départ autoriserait l’UE à prendre des mesures de contrôle des capitaux pour limiter les activités spéculatives et inciter les banques de la zone euro à y rapatrier leurs activités.
- – De même, il aurait fallu dire clairement à la Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et à l’Irlande que l’appartenance à l’UE suppose la fin des dispositifs permettant l’optimisation fiscale des firmes multinationales.
- – Le Royaume-Uni a fait adopter une déclaration affirmant à la fois la nécessité d’améliorer la règlementation et d’abroger les dispositions inutiles pour renforcer la compétitivité tout en maintenant des normes élevées de protection des consommateurs, des travailleurs, de la santé et de l’environnement. Cette compatibilité relève sans doute du vœu pieux.
- – Le texte reconnaît que la disparité des niveaux de salaires et de protection sociale dans les pays européens est difficilement compatible avec le principe de libre circulation des personnes en Europe. C’est un des non-dits de toujours de la construction européenne. Le Royaume-Uni, qui avait été l’un des seuls pays à ne pas prendre de mesures transitoires pour limiter l’entrée de travailleurs étrangers lors de l’adhésion des PECO en 2004, demande aujourd’hui que de telles mesures soient prévues en cas de futures adhésions. Le projet d’accord rappelle que le séjour d’un Européen dans un pays autre que le sien suppose qu’il ne soit pas à la charge du pays d’accueil, donc qu’il ait des ressources suffisantes ou qu’il y travaille.
- – La question du droit aux allocations familiales quand les enfants ne vivent pas dans le même pays qu’un de leur parent est inextricable. Dans la plupart des pays, les allocations familiales sont universelles (ne dépendent pas des cotisations des parents). On ne peut pas respecter en même temps les deux principes : tous les enfants vivant dans un pays donné ont droit à la même allocation ; tous les salariés travaillant dans un pays donné ont droit aux mêmes prestations. Le Royaume-Uni a obtenu le droit de pouvoir réduire les allocations en fonction du niveau de vie et des allocations familiales du pays de résidence des enfants. Mais ce droit ne pourra heureusement pas être étendu aux prestations retraites.
- – La plupart des pays européens ont aujourd’hui des mécanismes favorisant l’emploi des travailleurs non qualifiés. Grâce à des exonérations de cotisations sociales, à des crédits d’impôts et à des prestations spécifiques (comme la prime d’activité ou les allocations-logement en France), le revenu qu’ils perçoivent est fortement déconnecté de leur coût salarial. L’exemple britannique montre que ces dispositifs peuvent devenir problématiques en cas de libre circulation des actifs. Comment faire pour inciter les citoyens d’un pays à travailler sans trop attirer les travailleurs étrangers ? Là encore, c’est un non-dit de l’ouverture des frontières. Le point paradoxal est que c’est le Royaume-Uni qui soulève la question alors qu’il est proche du plein-emploi et qu’il prétendait que la flexibilité de son marché du travail lui permettait d’intégrer facilement les travailleurs étrangers. Ainsi, le Royaume-Uni a obtenu qu’un pays faisant face à un afflux exceptionnel de travailleurs en provenance d’autres Etats membres de l’UE puisse obtenir du Conseil le droit, pendant 7 ans, de n’accorder que progressivement les aides non-contributives aux nouveaux travailleurs des autres pays membres, ceci pendant un laps de temps pouvant aller jusqu’à 4 ans. Le Royaume-Uni a aussi fait préciser qu’il pourra utiliser ce droit immédiatement. Il s’agit d’une remise en cause de la citoyenneté européenne, mais ce concept était déjà bien écorné pour les inactifs et les chômeurs.
L’Union européenne, telle qu’elle se construit actuellement, soulève de nombreux problèmes. Les pays membres ont des intérêts et des points de vue divergents. En raison de la disparité des situations nationales (que ce soit la politique monétaire unique, la liberté de circulation des capitaux et des personnes), de nombreux dispositifs posent problème. Des règles sans fondement économique ont été introduites en matière de politique budgétaire. Dans nombre de pays, les classes dirigeantes, les responsables politiques, les hauts-fonctionnaires ont choisi de minimiser ces problèmes, pour ne pas contrarier la construction européenne. Des questions cruciales d’harmonisation fiscale, sociale, salariale, réglementaire ont été volontairement oubliées.
Le Royaume-Uni a toujours choisi de rester à l’écart de l’intégration européenne, en sauvegardant sa souveraineté. Aujourd’hui, il met le doigt sur les points sensibles. Se réjouir de son départ ne serait pas pertinent. L’utiliser pour progresser sans réflexion vers « une union toujours plus étroite » serait dangereux. L’Europe devrait se saisir de cette crise pour reconnaître qu’elle doit vivre avec une contradiction : les souverainetés nationales doivent être respectées tant que faire se peut ; l’Europe n’a pas de sens en elle-même, elle n’en a que si elle met en œuvre en projet, défendre un modèle spécifique de société, la faire évoluer pour intégrer la transition écologique, éradiquer la pauvreté et le chômage de masse, résoudre les déséquilibres européens de façon concertée et solidaire. Si l’accord négocié par les Britanniques pouvait y contribuer, ce serait une bonne chose, mais les pays européens auront-ils ce courage ?