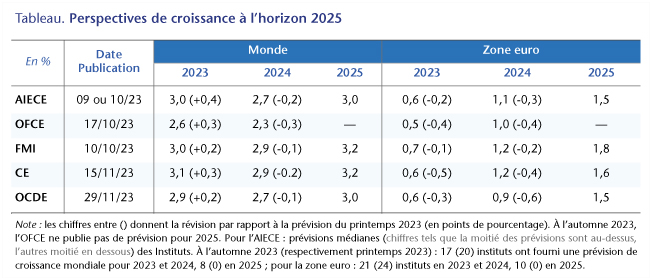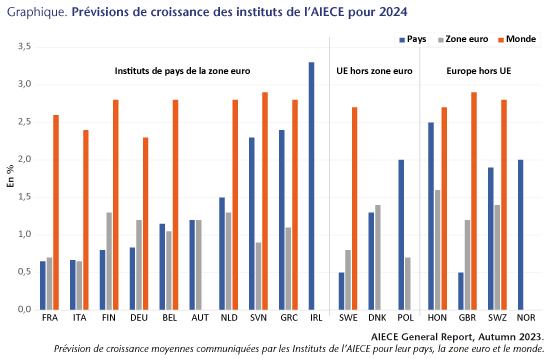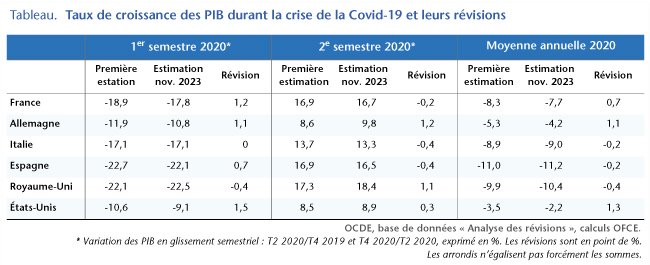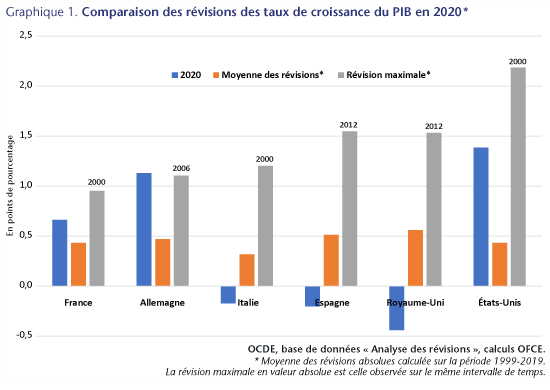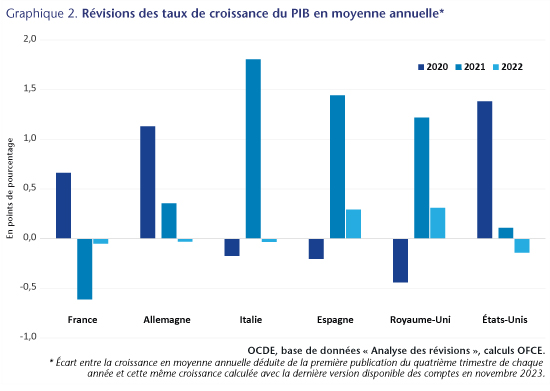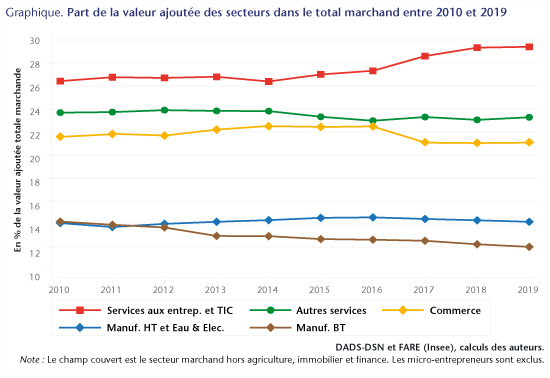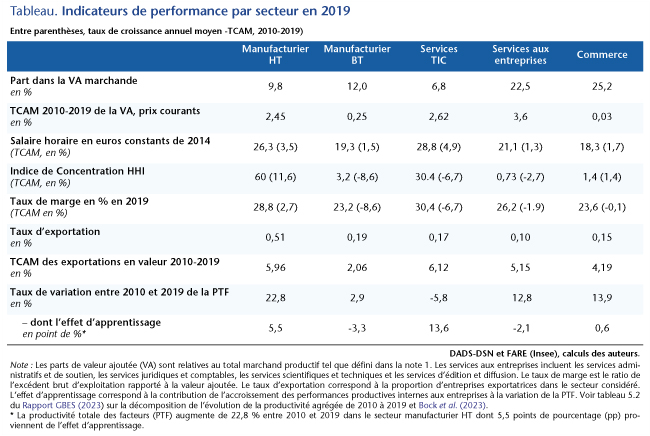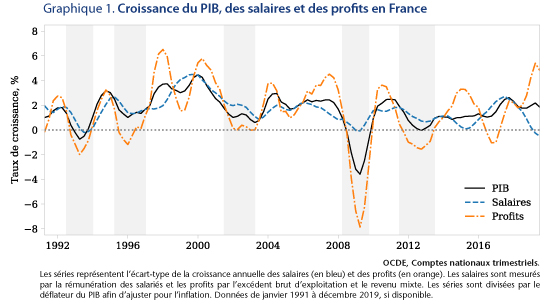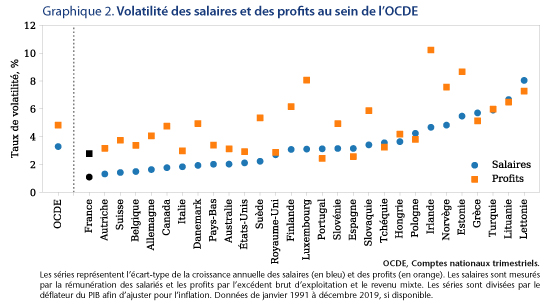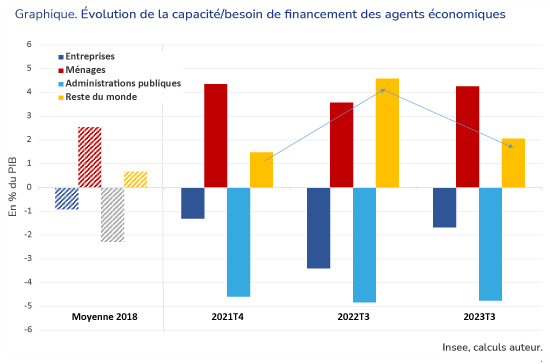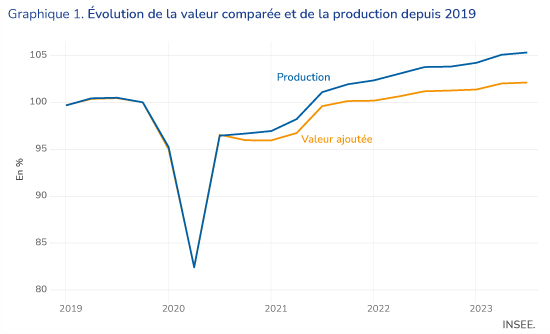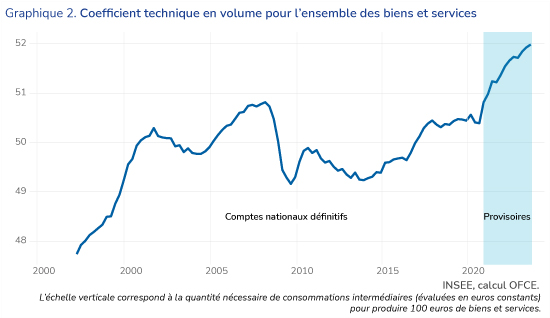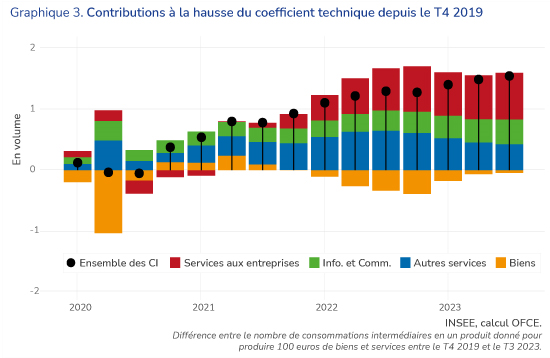La dollarisation en Argentine : un mirage de plus ?
Javier Milei, libertarien revendiqué, a été élu président de la République argentine le 19 novembre 2023 sur un programme électoral qui intégrait la proposition-choc de dollariser l’économie argentine[1]. Quel sens a cette proposition ? Est-elle réaliste ou viable ? J’avance dans ce billet que cette proposition s’explique par la volonté de se doter d’un mécanisme crédible de lutte contre l’inflation mais que la crédibilité de cet engagement est faible. La lutte contre l’inflation chronique doit passer par la fin du laxisme budgétaire pratiqué par les différentes autorités publiques argentines plutôt que par la mise en place d’un dispositif monétaire comme la dollarisation.
Javier Milei, le président argentin élu le 19 novembre dernier, a fait sensation comme candidat quand il a déclaré, se revendiquant d’une idéologie libertarienne, vouloir « dollariser » l’économie et donc la société argentines. L’extrémisme de ses propositions a été perçu par l’électorat comme une volonté de mettre à bas une organisation sociale inefficace et éliminer une classe politique incompétente et souvent corrompue.
Une fois élu, le président Milei a annoncé le 14 décembre 2023 renoncer temporairement à la dollarisation, « faute d’argent ». Plus précisément, faute de réserves en dollar suffisantes. Mais le ministre argentin de l’économie, Luis Caputo, a déclaré lors du récent forum économique mondial de Davos : « Les objectifs de fermeture de la Banque centrale et de dollarisation, loin d’être exclus, continuent d’être un objectif de ce gouvernement, mais les conditions pour y parvenir ne sont pas encore réunies. Nous devons d’abord stabiliser l’économie et dès que les conditions seront réunies, cela sera fait. »..
Le projet de l’équipe au pouvoir de dollariser l’économie argentine n’est donc pas abandonné. Que signifie-t-il ? Quelle chance de succès a-t-il ?
Avant toute chose, précisons ce que veut dire « dollariser l’économie argentine ». Deux formes de dollarisation sont envisageables. La dollarisation « exclusive » consiste pour un État souverain à donner cours légal exclusivement à une monnaie émise par un État étranger (par commodité, on évoquera les États-Unis comme le pays émetteur et leur monnaie, le dollar). En particulier, l’État « dollarisé » renonce à émettre sa propre monnaie et à exercer ainsi sa souveraineté monétaire. Toutes les transactions doivent être exécutées en dollars, tous les contrats passés entre agents doivent être libellés exclusivement en dollars, tous les comptes bancaires et financiers sont par conséquent tenus en dollars. La banque centrale elle-même n’effectue d’opérations qu’en dollars, en fonction des réserves dont elle dispose. Comme elle n’a aucune part à la politique monétaire décidée par le pays émetteur du dollar mais que cette monnaie circule librement entre les deux pays, il s’agit d’une union monétaire asymétrique[2]. La dollarisation « non-exclusive » (ou encore la substitution des monnaies) consiste pour un État à autoriser que certaines transactions soient effectuées dans une autre monnaie que celle qu’il émet et qu’il contrôle, et donc qu’une partie des patrimoines des agents résidents soit détenue dans une devise étrangère. Les cas de dollarisation non-exclusive sont nombreux (voir notamment Calvo & Gramont, 1992).
La proposition du président argentin nouvellement élu porte sur une dollarisation exclusive de l’économie monétaire argentine comme solution à l’hyperinflation endémique dont souffre l’Argentine depuis la deuxième moitié du XX° siècle.
En négligeant les coûts de la transition et en supposant que la dollarisation devienne pérenne, le gain attendu d’une telle mesure est connu, et c’est celui que recherche le président Milei. C’est la fin de l’hyperinflation puisque l’émission de monnaie domestique est supprimée, en admettant que le pays émetteur est caractérisé par une inflation faible et aisément anticipable et une croissance mesurée des différentes masses de moyens de paiement. La dollarisation est donc envisagée comme une solution extrême à une solution jugée incontrôlable.
Les coûts de la dollarisation sont non-négligeables. Le premier résulte de la renonciation à toute politique monétaire autonome, donc de la perte d’un instrument macroéconomique contribuant à la stabilisation du cycle économique et en particulier capable de gérer les chocs, intérieurs ou venus de l’extérieur. Le second, conséquence du premier, est la plus grande exposition aux chocs extérieurs puisque les chocs subis par le pays émetteur sont « amplifiés » dans le pays dollarisé à cause de la politique monétaire du pays émetteur qui ne correspond pas à sa situation spécifique. Le troisième est la perte des revenus du seigneuriage[3] pour le pays dollarisé, donc un accroissement de ses difficultés budgétaires. Le dernier enfin est la disparition du prêteur en dernier ressort, en cas de difficulté bancaire circonscrite à une banque ou systémique, puisque la banque centrale ne contrôle plus l’émission de moyens de paiement. Plus généralement, la politique prudentielle est rendue plus difficile puisque les banques domestiques sont mises en compétition directe avec les banques du pays émetteur (voir Berg & Borensztein, 2001).
Enfin, il faut rappeler les conditions de succès de la dollarisation : l’existence de réserves en dollar suffisantes et convenablement réparties dans la population. Si elles sont insuffisantes, l’inflation (des prix exprimés en monnaie domestiques) dans l’intervalle entre l’annonce de la dollarisation et sa mise en place sera positive et inversement proportionnelle à la quantité de réserves en dollar (Voir Caravello & alii, 2023). Enfin, si les réserves sont très inégalement réparties en fonction des revenus, le risque est grand que la partie la plus pauvre de la population se trouve brutalement sans moyens de paiement et donc soit poussée à des actions extrêmes pour subvenir à ses besoins. L’agitation sociale, pouvant être violente, déboucherait sur une crise politique dont la dollarisation serait la première victime.
La justification d’une politique de dollarisation en Argentine se trouve dans la situation d’inflation chronique et souvent très élevée dont ce pays n’arrive pas à sortir depuis les années 1950, et en particulier depuis la fin de la dictature militaire (1983). Devant l’incapacité des différents gouvernements à maîtriser l’inflation, il est logique qu’une solution extrême comme la dollarisation qui consiste à s’interdire toute manipulation monétaire apparaisse comme séduisante et raisonnable. Mais on peut s’interroger sur le fait de savoir s’il s’agit d’un pari audacieux ou d’un mirage de plus.
Pour répondre à cette question, il est utile de rappeler le précédent du système de caisse d’émission (« Currency board »)[4] mis en place à l’instigation du président argentin Carlos Menem en 1991. Le principe de la caisse d’émission est d’empêcher toute création discrétionnaire de liquidité en adossant l’émission de monnaie banque centrale sur ses réserves en devises, essentiellement en dollar. Le système n’empêche donc pas la circulation et l’usage d’une monnaie nationale, le peso dans le cas argentin. Il implique la détermination d’un taux de change fixe avec le dollar, l’adossement de toute l’émission monétaire interne sur des actifs libellés en dollars, et l’interdiction pour la Banque centrale de stériliser les mouvements de capitaux en balance des paiements. De fait, le peso est devenu quasi parfaitement substituable au dollar dans les années 1990, les coûts de conversion des deux devises étant extrêmement faibles et le dollar accepté comme moyen de paiement et unité de compte dans les opérations internes à l’Argentine. C’est en ce sens que la caisse d’émission est une forme atténuée de dollarisation. Le projet actuel de dollarisation peut donc se lire comme une nouvelle tentative de réformer le régime monétaire, bancaire et financier argentin par un ancrage plus strict encore sur le dollar.
L’expérience des années 1990 s’est terminée par une crise économique majeure préludant à son abandon en 2001 (voir Sgard, 2004). L’expérience a d’abord été réussie : les déficits publics ont été fortement réduits, des réformes importantes ont été adoptées. Mais la situation s’est progressivement dégradée jusqu’à la crise de 2001. L’échec s’explique par une combinaison de facteurs : l’irresponsabilité fiscale dont ont fait preuve tant les gouvernements des provinces argentines (qui ont émis des quasi-monnaies pour financer leurs déficits) que le gouvernement central qui, pris dans le jeu électoral, a laissé faire et a à son tour adopté une politique budgétaire laxiste conduisant à des déficits croissants, atteignant 6 % du PIB en 2000, donc un endettement extérieur croissant ; les crises de change connues par les pays voisins et la faiblesse des cours des produits agricoles exportés par l’Argentine à la fin de la décennie 1990. La perte de l’autonomie monétaire n’a pas permis de contrer ces tendances et a rendu le dispositif intenable, poussant l’Argentine vers le défaut souverain. La seule option était alors de modifier sévèrement le taux de change en sortant du système de caisse d’émission. Rien ne permet de penser que ces excès et ces mauvaises fortunes ne se répéteront pas.
La proposition de dollarisation témoigne d’une défiance renouvelée à l’égard du système de gouvernement politique argentin, les décideurs publics étant jugés incapable de se réfréner et d’adopter des règles de bonne conduite financière comme l’ont montré d’abord l’écroulement du currency board puis les manipulations monétaires pratiquées sous la présidence Kirchner et les erreurs de gestion du président Macri et de ses équipes. Cette défiance est largement partagée par la population, depuis longtemps dollarisée de facto (surtout les possédants, ayant accès à des marchés de capitaux internationaux), ce qui au demeurant facilite la transition vers une dollarisation exclusive. Face à ces errements, le choix de la dollarisation apparaît comme une forme paradoxale de pré-engagement pour gagner de la crédibilité dans la lutte contre les tentations inflationnistes. Il s’agit d’un pré-engagement asymétrique puisque cette politique s’effectue sans le concours des autorités américaines. L’Argentine n’a pas de soutien extérieur à sa politique à attendre. Dans ces conditions, la dollarisation crée une extrême vulnérabilité aux circonstances extérieures pour échapper à la vulnérabilité interne qui résulte de la tentation du financement monétaire des déficits publics, tout en créant de nouvelles formes de vulnérabilité interne.
Derrière les conditions techniques de son succès, la dollarisation ne peut fonctionner que si elle bénéficie d’un fort soutien interne à cette forme de pré-engagement qui n’a rien d’acquis. Que les agents privés ou les acteurs publics se défient progressivement ou brutalement de la solidité de la dollarisation ou qu’ils cherchent à échapper à ses contraintes, et ils trouveront les moyens de contourner l’obligation d’utiliser exclusivement le dollar dans leurs transactions. De plus, la dollarisation ne peut fonctionner que si elle dispose également d’un soutien externe des marchés financiers internationaux puisque les chocs externes ne peuvent plus être librement gérés par la politique macroéconomique / monétaire intérieure. Les déficits extérieurs éventuels ne pouvant être gérés par une politique monétaire visant à manipuler les taux de change doivent être financés par appel à des financements externes. Or l’économie argentine est particulièrement sujette à des chocs étant donné sa dépendance à l’égard des phénomènes météorologiques qui conditionnent sa capacité à obtenir les dollars en contrepartie de ses exportations de produits agricoles. De surcroît, ces chocs sont peu corrélés aux chocs qui affectent l’économie américaine et aux réponses des politiques macroéconomiques américaines qui y répondent. L’Argentine est ainsi vouée à subir la conjoncture américaine sans pouvoir répondre à ses propres chocs. Elle devient très dépendante de financements externes et de leurs modalités. Les partenaires extérieurs doivent être convaincus de la solidité de la dollarisation argentine pour la soutenir par leurs prêts en dollars. Leur défiance éventuelle se traduira par une augmentation des taux d’intérêt prêteurs qui rendront la situation macroéconomique plus fragile.
Apparaît ainsi un premier paradoxe : la dollarisation doit être soutenue à l’intérieur comme à l’extérieur pour être crédible, mais elle ne peut être soutenue que si elle est crédible. La notion de pré-engagement est justement là pour exprimer cette crédibilité. Or les pré-engagements ne sont quasiment jamais absolus mais sont le plus souvent limités (par des clauses de sauvegarde, par des bouleversements imprévus, par des configurations de jeu non prévues). Rien n’assure alors que la coordination des anticipations des multiples parties prenantes se produise dans le sens désiré. La dollarisation tient ainsi autant de la méthode Coué que du pré-engagement indestructible.
Ceci fait apparaître un deuxième paradoxe : si le soutien interne à la dollarisation comme forme de pré-engagement existe, il est raisonnable de penser que la société est en mesure d’admettre d’autres formes de pré-engagement, moins coûteuses que la dollarisation. Il devrait être possible de mettre en place des institutions (des formes de pré-engagement) plus adaptées aux particularités sociales et économiques argentines et plus à même de résoudre les problèmes qui sont à l’origine des phases d’hyperinflation que connaît de façon récurrente l’Argentine : l’irresponsabilité budgétaire des gouvernements provinciaux et national, à l’origine des déficits publics massifs, l’indépendance du judiciaire, le contrôle correct et non-partisan de la constitutionnalité des lois et des politiques publiques. L’idée que la dollarisation est la seule politique qui permet d’assurer la crédibilité d’un engagement de casser l’inflation, au prix d’un abandon d’une bonne part des capacités d’action de l’État, doit être remise en cause. Si les conditions d’ensemble font que la dollarisation est possible et viable, celle-ci ne peut être désirée puisque d’autres politiques sont alors moins coûteuses pour un même résultat, la maîtrise durable du processus inflationniste.
Des formes de pré-engagement allant plus directement au cœur du problème et probablement plus saines que la dollarisation car n’obérant pas la capacité de mener des politiques macroéconomiques actives (voire discrétionnaires) pour stabiliser le cycle, orienter le processus de croissance ou mettre en place des programmes de redistribution sont possibles si la dollarisation est possible, c’est-à-dire acceptée socialement et politiquement. En d’autres termes, c’est moins dans l’abandon de la souveraineté monétaire que dans la maîtrise des comptes publics et de l’ampleur des déficits publics que se trouve la clé du contrôle de l’inflation. Le président Milei devrait s’apercevoir bien vite qu’il ne suffit pas de se revendiquer libertarien pour mettre fin à la gabegie budgétaire argentine mais qu’il faut gérer au plus près les multiples canaux d’abus qui prospèrent dans le labyrinthe fiscal argentin (Voir Saiegh & Tommasi, 1999). Il s’agit moins de vouloir démanteler l’État (tâche irréaliste) que de le réformer en profondeur par la mise en place d’institutions et de dispositifs interdisant ces abus.
[1]Une présentation synthétique de la problématique macroéconomique argentine, suivie d’une analyse innovante de la dollarisation est donnée par Ivan Werning sur le site Markus’ academy (géré par Markus Brunnermeier, professeur à Princeton).
[2] Voir Kempf H., Economie des unions monétaires, Economica : 2019, chapitre 1. Voir également Hanke S. (2023), pour une liste des cas de dollarisation exclusive.
[3] Les revenus de seigneuriage sont les revenus que tire l’émetteur de moyens de paiement de leur création.
[4] Voir Chauvin, S., & Villa, P. (2003) et De la Torre A., Levy Yeyati E., Schmuckler S. (2003), « Living and Dying with Hard Pegs : the Rise and Fall of Argentina’s Currrency Board », Economía, Vol. 3, No. 2, pp. 43-107. 8