
L’investissement public
Compte rendu de la Journée d’études « L’Investissement public » du 15 décembre 2023 à Sciences Po Paris, dans le cadre du séminaire Théorie et économie […]

Compte rendu de la Journée d’études « L’Investissement public » du 15 décembre 2023 à Sciences Po Paris, dans le cadre du séminaire Théorie et économie […]
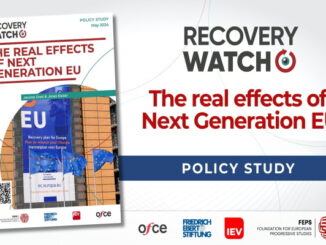
Jérôme Creel et Jonas Kaiser Dans une étude pour la Foundation for European Progressive Studies (FEPS), nous tentons d’évaluer les effets économiques de Next Generation […]

Jérôme Creel, Fipaddict, Clara Leonard, Nicolas Leron et Juliette de Pierrebourg Comment sortir du dilemme entre épuisement planétaire et contraintes budgétaires dans lequel se trouvent […]

par Hubert Kempf Dans le débat européen autour du plan Next Generation EU, la décision de 2020 de la Commission européenne d’émettre de la dette […]

par Jérôme Creel Dans sa communication du 9 novembre 2022, la Commission européenne a esquissé les contours du nouveau cadre budgétaire européen qui devrait, selon […]

par Xavier Ragot par Xavier Ragot L’économiste Paul Samuelson définissait la politique économique comme un art : l’art de définir les principales priorités et les moyens […]

par Massimo Amato et Francesco Saraceno Alors qu’en Europe le débat sur la gouvernance économique entre désormais dans le vif du sujet, avec la Commission […]

par Xavier Ragot Le débat macroéconomique est actuellement très animé. Le changement de politique économique aux États-Unis après l’élection de Joe Biden suscite un débat […]

par Pierre Aldama Entre 1999 et 2019, à la veille de la pandémie de la Covid-19, les dettes publiques avaient augmenté en moyenne de 20 points […]

Par Christophe Blot et Paul Hubert Pour faire face à la crise sanitaire et économique, les gouvernements ont déployé de nombreuses mesures d’urgence qui se […]
Copyright © 2025 | Thème WordPress par MH Themes