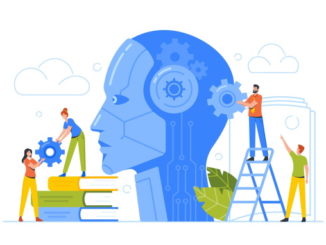
L’intelligence artificielle Made in France à la recherche de ses grands groupes industriels
par Johanna Deperi, Ludovic Dibiaggio, Mohamed Keita et Lionel Nesta Perçue comme la promesse de machines « intelligentes », l’intelligence artificielle (IA) est annoncée comme la source […]

