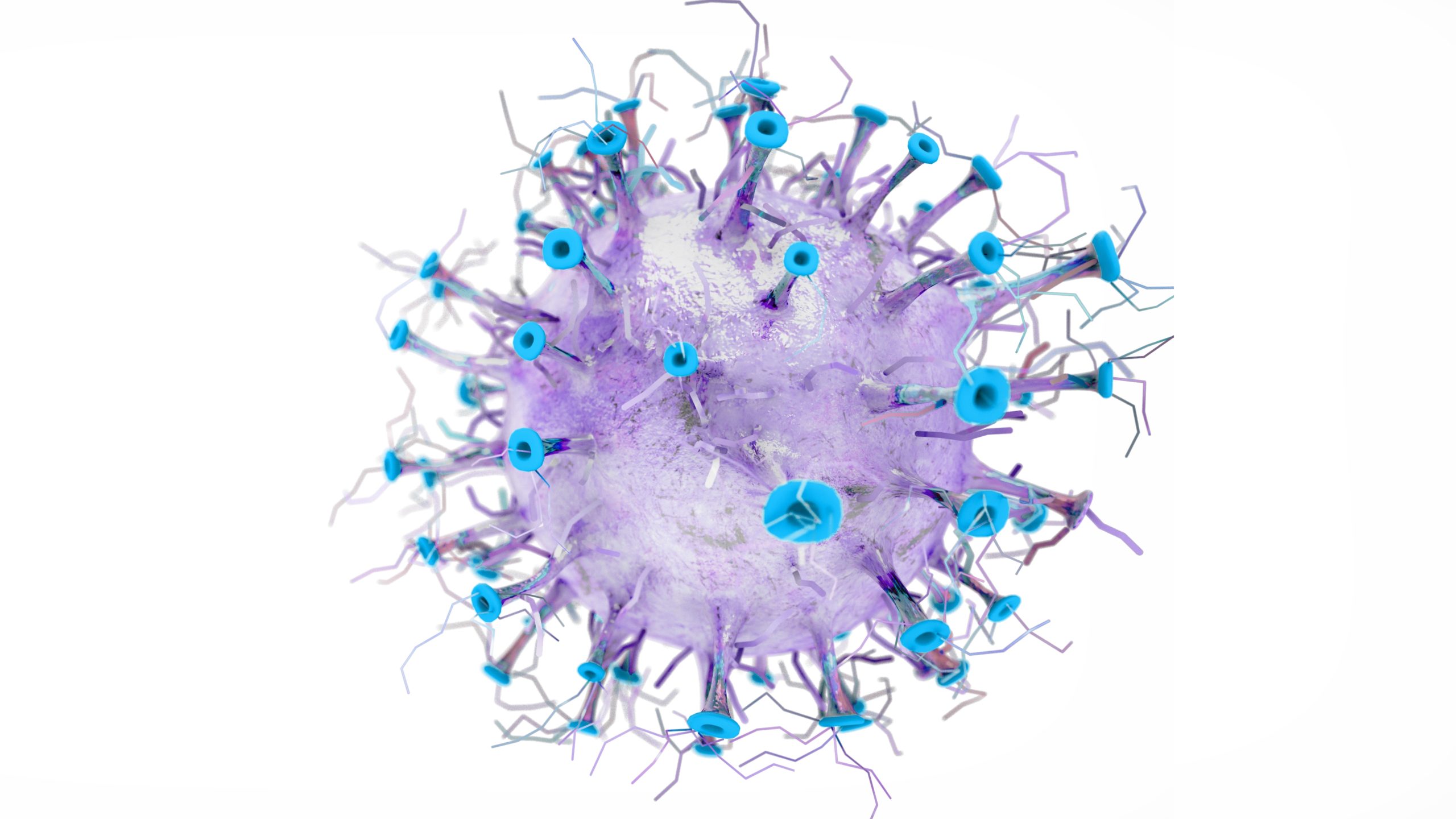Paradis fiscaux, profits délocalisés et biais de productivité mesurée : le cas de la France
par Vincent Aussilloux (France Stratégie), Jean-Charles Bricongne (Banque de France), Samuel Delpeuch (Sciences Po Paris) et Margarita Lopez Forero (Université d’Evry/Paris-Saclay) Comment les stratégies fiscales […]