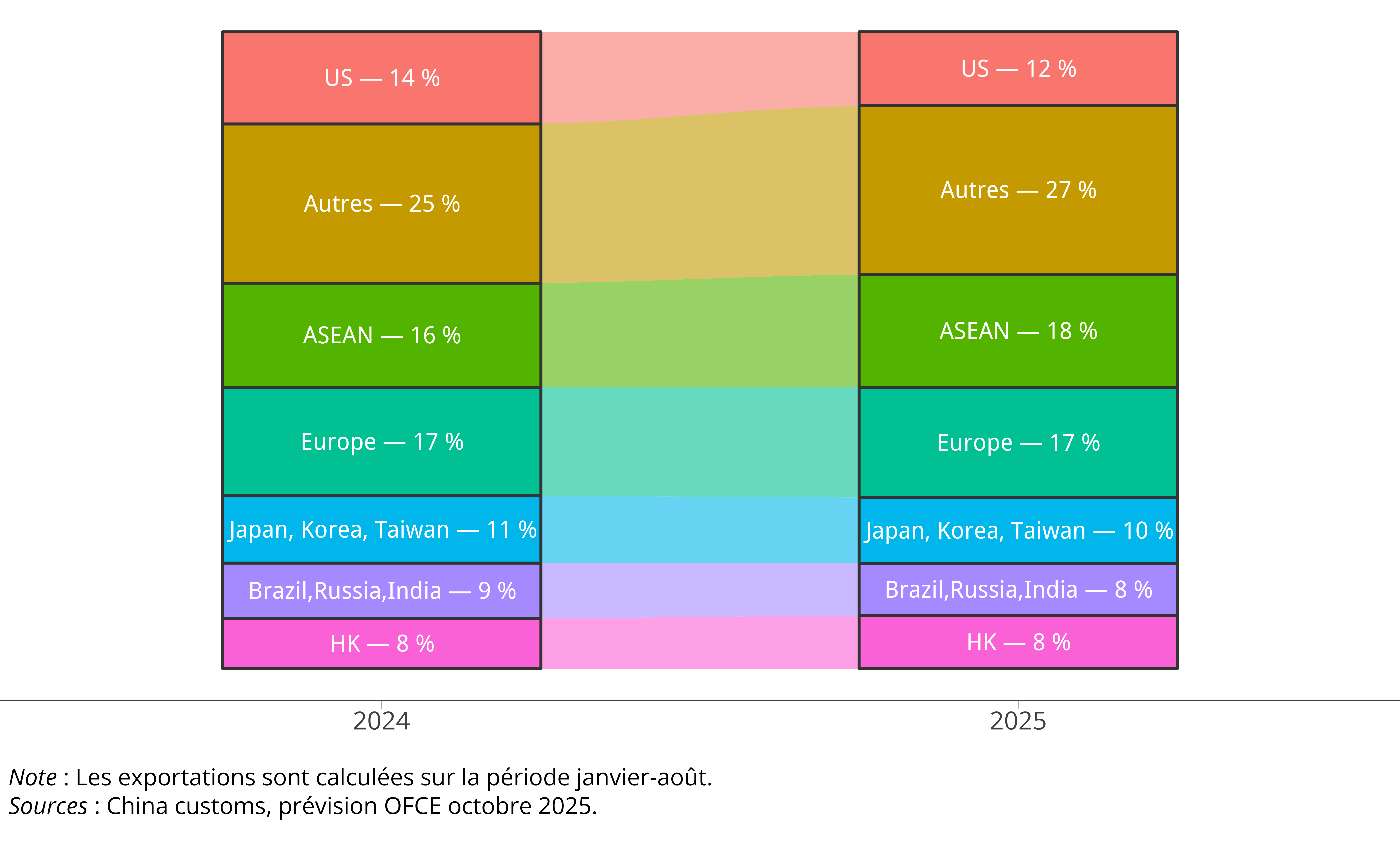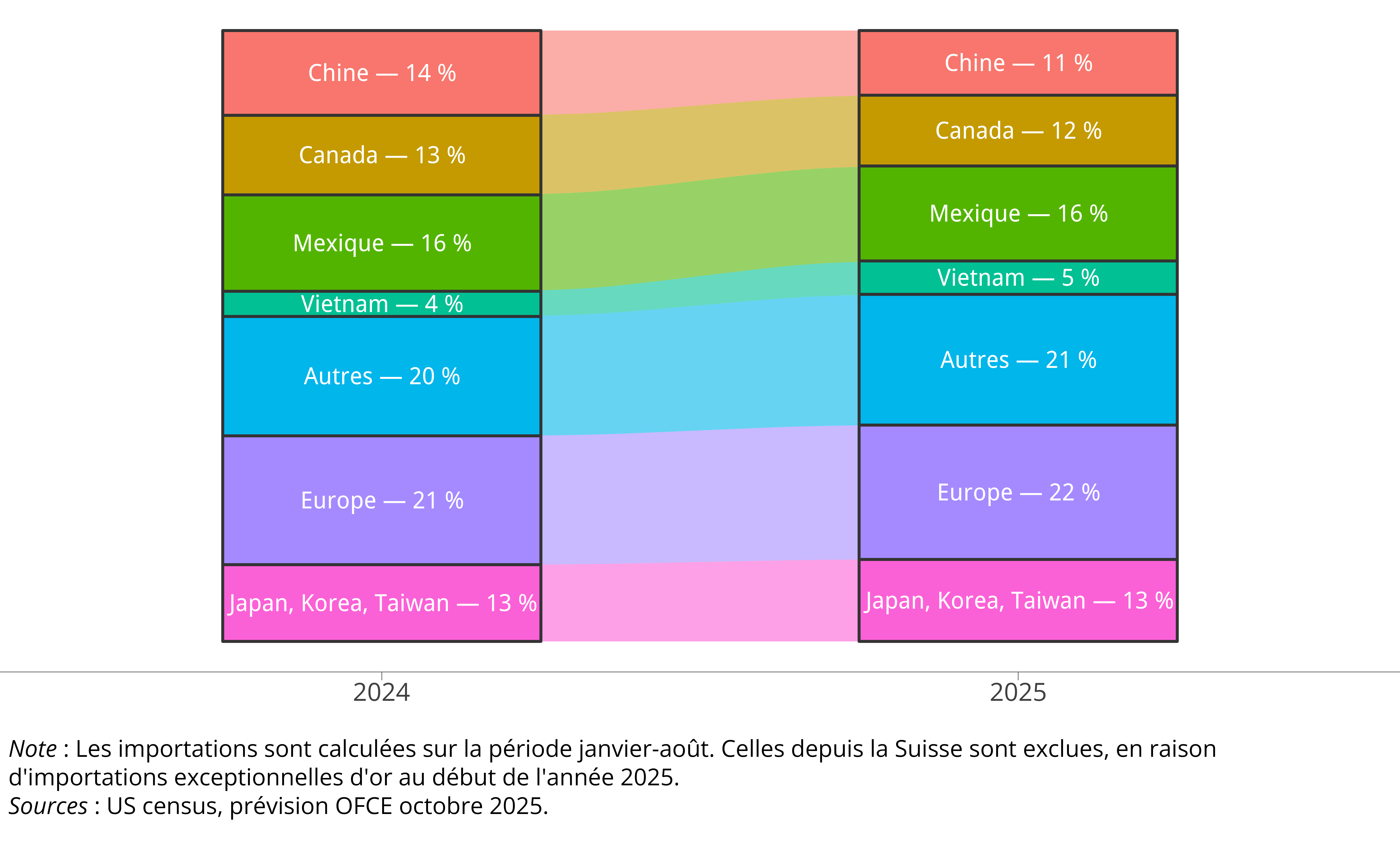1 « Beautiful deals » ou marchés de dupes ?
Lors de notre précédente prévision en avril, la guerre commerciale était déjà bien entamée. Le président américain avait lancé une offensive tous azimuths. Les pays qui ne voulaient pas subir les tarifs « réciproques » annoncés lors du « jour de la libération » devaient entamer des négociations. Les contreparties attendues par l’aministration Trump en échange de droits de douane « allégés » n’étaient pas totalement clairs, mais de nombreux pays se sont pliés à l’exercice. Des accords commerciaux ont été conclus avec l’Union européenne, le Japon, le Royaume-Uni, la Corée du Sud et plusieurs autres pays asiatiques: Vietnam, Indonésie, Philippines1. Des négociations sont encore en cours avec d’autres pays, notamment la Chine. Pour d’autres pays, les négociations semblent soit rompues2, soit n’ont jamais commencé, l’administration américaine n’ayant pas les moyens de conclure des accords détaillés avec 170 pays. Pour ces pays, le tarif sera fixé unilatéralement par les Etats-Unis, vraisemblablement entre 20 et 30%.
1 Tout du moins, de tels accords ont été annoncés par le président Trump via des messages sur les réseaux sociaux et dans certains cas des « fact sheets » publiés par la maison blanche. Les textes complets des différents accords n’ont pour le moment pas été publiés.
2 Cela semble notamment être le cas du Brésil, de l’Inde, et de la Suisse qui ont subi des hausses de tarifs punitives (respectivement 27,2 %, 43%, et 38,6 % )
3 Il est également possible que négociateurs américains et européens aient été sur la même longueur d’onde mais que le président républicain déforme délibérément le contenu de ces accords pour les présenter comme d’incroyables succès personnels.
La philosophie générale des accords conclus semble la suivante. Les Etats-Unis imposent des tarifs supplémentaires compris entre 10 et 20% (10 % pour le Royaume-Uni, 15% pour l’Union européenne, la Corée du Sud et le Japon et environ 20% pour les autres pays d’Asie). Le pays « partenaire » s’engage à abaisser ses propres barrières sur les produits américains. L’Union européenne, le Japon et la Corée du Sud se sont également engagés à augmenter leurs importations de biens fabriqués aux Etats-Unis et à effectuer des investissements directs aux Etats-Unis. Ainsi, l’Union européenne s’est elle engagée à importer pour 750 milliards de dollars de produits pétroliers et gaziers sur trois ans et à investir pour 600 milliards de dollars aux Etats-Unis d’ici 2029. Le Japon et la Corée du Sud ont promis d’investir respectivement 550 milliards de dollars et 350 milliards de dollars. Ce dernier point ne semble pas avoir été compris de la même manière par les négociateurs américains et leurs homologues européens, coréens et japonais. Pour ces derniers, il s’agit d’un montant indicatif regroupant tout les investissements directs réalisés par leurs entreprises aux Etats-Unis, incluant des projets qui auraient été réalisés de toutes façons. Pour les négociateurs américains, ou au moins pour le président Trump, il s’agit d’une somme d’argent donné au gouvernement américain qui peut en disposer à sa guise3!
2 Des effets déjà visibles sur le commerce international
La hausse des tarifs douaniers américains est déjà significative. Le tarif moyen pondéré pour les marchandises entrant aux Etats-Unis, calculé sur la structure des importations américaines en 2024, était de 2,3 % en janvier. Il est passé à 14,6 % en juillet puis à 17,9 % en août. La hausse du tarif effectif moyen, c’est à dire le rapport entre les recettes douanières et la valeur des importations est plus faible. Il est passé de 2,2 % en janvier à 9,7% en juillet, dernière donnée disponible. La différence entre le taux moyen pondéré et le taux effectif montre que la politique de l’administration Trump a déjà provoqué des changements dans la structure du commerce extérieur américain. Les poids des pays et des produits sont aujourd’hui très différents de ceux de 2024 qui entrent dans le calcul du taux moyen pondéré.
De fait, la politique de Donald Trump a déjà eu un impact significatif sur la structure des flux commerciaux notamment américains et chinois. graphique 1 et graphique 2 montrent la répartition des exportations chinoises par destination et celle des importations américaines par provenance sur les périodes janvier-aout 2025 et janvier-aout 2024. Les flux Chine-Etats-Unis ont baissé significativement. La Chine a principalement compensé en exportant vers les pays émergents hors Asie en particulier en Afrique et au Moyen-Orient et dans une moindre mesure vers les pays de l’ASEAN, dont Thailande, Indonésie, Malaisie, Vietnam, Philippines. Dans le dernier cas, il pourrait s’agir d’un phénomène de « reroutage » des exportations chinoises, i.e le transit des exportations chinoises vers les Etats-Unis par un pays intermédiaire sans réelle valeur ajoutée pour contourner les droits de douane. Le Vietnam, qui a déjà joué ce rôle d’intermédiaire lors de la première guerre commerciale en 2018, voit sa part augmenter à la fois dans les exportations chinoises et dans les importations américaines. Ce reroutage pourrait ainsi concerner entre 20% et un tiers des pertes d’exportations chinoises vers les Etats-Unis. En dehors du Vietnam, les Etats-Unis importent également moins depuis le Canada et davantage depuis l’Europe4.
4 Les données de commerce de biens entre les Etats-Unis et l’Europe peuvent cependant être difficile à interpréter, notamment en raison des statistiques irlandaises.
3 Qui paie la taxe douanière pour le moment ?
Corollaire immédiat de la hausse du tarif effectif moyen, les recettes fiscales liées aux droits de douane sont en forte hausse aux Etats-Unis. Elles sont passées de 6 milliards de dollars par mois en 2024 à 28 milliards de dollars en juillet. Pour une année pleine, la hausse des recettes pourrait être comprise entre 240 et 300 milliards de dollars, soit environ 1 point de PIB américain.
Qui paie cet impôt ? Les éléments disponibles aujourd’hui indiquent qu’il s’agit principalement des ménages et des entreprises américaines. C’est ce que suggèrent les données du Bureau of Labor Statistics sur le prix des biens importés aux Etats-Unis, qui est mesuré avant prise en compte des droits de douane. Le graphique 3 montre que ceux-ci n’ont pas évolué significativement à la baisse comme ils auraient dû le faire si les exportateurs n’avaient pas répercuté les droits de douane sur leurs clients américains5. Calculer la part déjà repercutée sur le consommateur est plus complexe et dépend des hypothèses effectuées sur la dynamique des prix en l’absence de droits de douane. En s’appuyant sur le travail de Cavallo et al. (2025), Hufbauer et Zhang (2025) suggèrent les entreprises américaines n’auraient répercuté pour le moment que 20% des hausses de droits de douane sur les consommateurs. Une autre étude calcule en revanche un « passthrough » de 70 % vers les consommateurs. Cette dernière ne distingue cependant pas finement entre biens domestiques et biens importés à l’inverse de la première. Une interprétation alternative est que les droits de douane ont non seulement un impact mécanique sur l’inflation américaine mais aussi un impact indirect en permettant aux producteurs domestiques d’augmenter plus facilement leurs prix.
5 Le prix « contrefactuel » repose sur l’hypothèse que le prix après droit de douane est maintenu à son niveau de décembre 2024. Bien évidemment, ce contrefactuel constant est critiquable. il est possible qu’en l’absence de droits de douane, les prix auraient monté. Par ailleurs, le mouvement de dépréciation du dollar observé depuis janvier peut aussi avoir fait monter les prix à l’importation. De nouvelles données seront nécessaires pour trancher la question. Les hausses de droits de douane sont toutefois importantes par rapport aux mouvements habituels des prix à l’importation, y compris les mouvements causés par des dépréciation du taux de change effectif du dollar. L’impact des mouvements de celui-ci sur les prix à d’importation est limité à court terme par la forte proportion d’importations dont le prix est fixé directement en dollar et par les mécanismes de couverture du risque de change.
4 Un impact modéré sur la croissance économique
La guerre commerciale devrait provoquer un ralentissement de la croissance du commerce international. Ainsi, les exportations mondiales devraient croitre de 4,5 % entre le quatrième trimestre 2024 et le quatrième trimestre 2026 contre 6 % entre le quatrième trimestre 2022 et le quatrième trimestre 2024. Les exportations américaines ne progresseraient ainsi que de 0,8 % en 2025 et 1,9 % en 2026 contre 3,6 % en 2024. Les exportations allemandes stagneraient en 2025 et croitraient de 1 % en 2026. Les exportations chinoises seraient également affectées en l’absence d’un accord commercial avec les Etats-Unis.
A l’échelle mondiale, des exportations plus faibles ont pour contrepartie des importations plus faibles et ont donc un effet neutre en première approximation sur le PIB. La recmposition du commerce international peut cependant induire une allocation moins efficace des ressources tandis que les recettes douanières supplémentaires aux Etats-Unis représentent une impulsion budgétaire négative si elles ne sont pas compensées par de nouvelles dépenses ou la baisse d’autres impôts. A ce stade, nous anticipons que ces deux effets négatifs resteraient contenus et seraient contrebalancés par un policy mix plus favorable (voir la synthese internationale pour plus de détails). Une nouvelle escalade sino-américaine pourrait remettre en cause ce scénario et ouvrir une nouvelle période d’incertitudes.