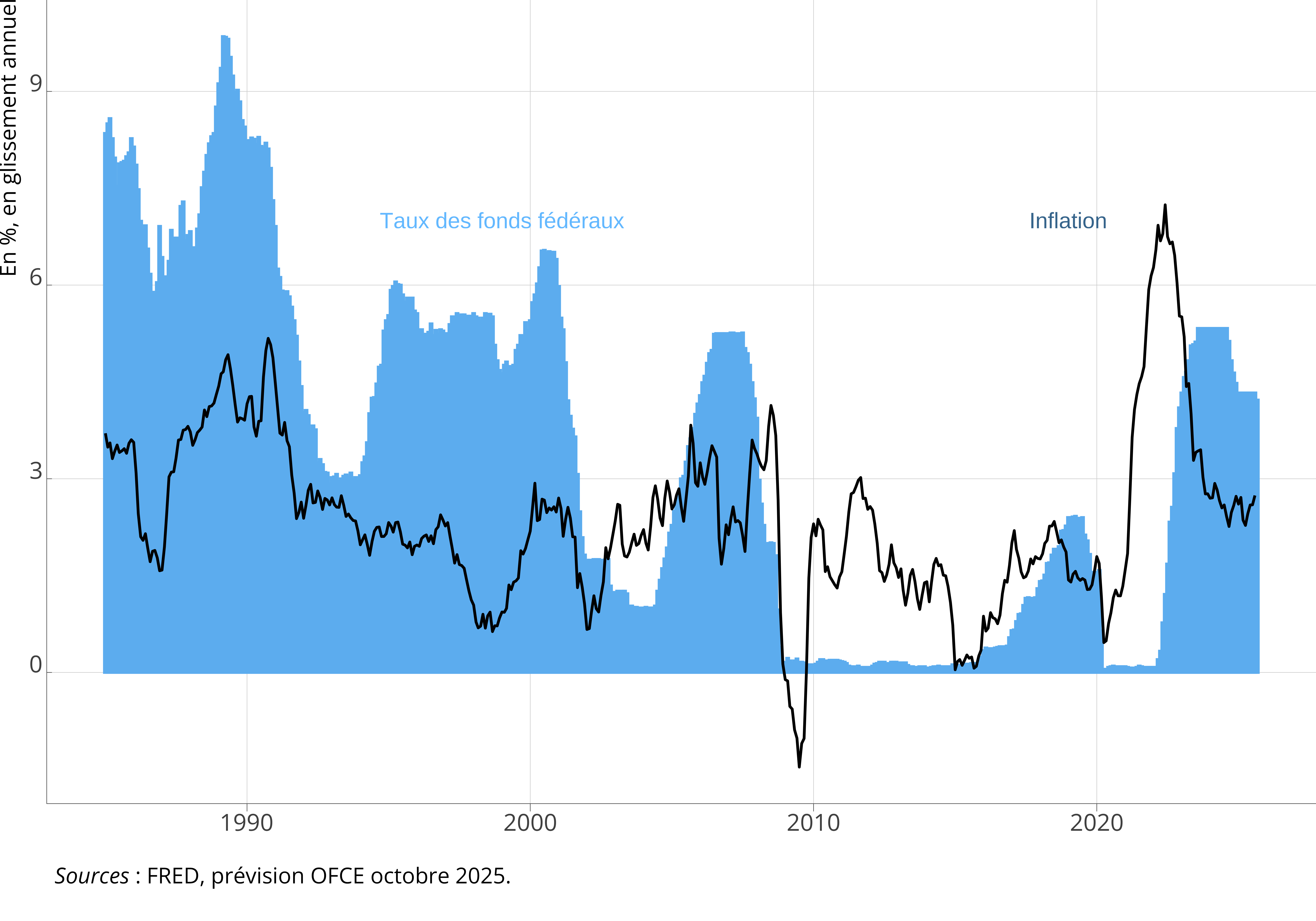1 La politique monétaire suit l’inflation
La poursuite de la baisse de l’inflation en 2024 a permis aux banques centrales des pays industrialisés et émergents de continuer à baisser les taux d’intérêt au cours des huit premiers mois de l’année 2025. La Banque du Japon et celle du Brésil font toutefois figure d’exception. Le Japon semble définitivement sortir d’une période prolongée de déflation ce qui permet à la banque centrale de normaliser la politique monétaire en ré-augmentant les taux de façon modérée et en réduisant sa politique d’achats de titres. Au Brésil l’inflation élevée – supérieure à 4% depuis mais 2024 – a conduit la banque centrale à durcir la politique monétaire, en augmentant le taux de 4,5 points depuis août 2024 pour le porter à 15%. Les autres banques centrales sont toutefois restées vigilantes à la fois parce que la convergence vers leur cible d’inflation n’était pas totalement garantie et parce que l’incertitude et la perspective de droits de douane plus élevés peuvent remettre en cause la baisse de l’inflation. C’est la raison pour laquelle la Réserve fédérale avait interrompu la baisse de taux amorcée en septembre 2024 et maintenu son taux à 4,5% entre janvier 2025 et septembre 2025. La décision récente de baisser le taux d’un quart de point s’explique par une situation plus dégradée qu’anticipée sur le marché du travail et non par l’inflation qui a au contraire ré-augmenté depuis avril.
2 To Trump or not to Trump
Ce dilemme devrait s’amplifier puisque l’inflation américaine se maintiendrait au-dessus de 3% en 2026, et ne baisserait que très modérément en fin d’année. Les différents indicateurs d’anticipation d’inflation semblent relativement cohérents avec ce scénario et confirment une révision des anticipations après la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles de 2024 (encadré 1). Pour autant, la situation n’est pas comparable à celle de 2022 qui avait vu l’inflation monter jusqu’à 7,2%1. Les tensions inflationnistes seraient relativement modérées et comparables aux épisodes observés pendant la Grande Modération. Lors de ces épisodes, la Réserve fédérale avait durci sa politique monétaire comme ce fut le cas par exemple à la fin des années 1980 ou entre 2005 et 2007, où l’inflation dépassait également 3% (graphique 1). De fait, le double mandat de la Réserve fédérale américaine lui donne de la souplesse pour arbitrer entre ses deux objectifs de stabilité des prix et de plein-emploi. Elle pourra donc justifier de nouvelles baisses de taux par l’impact négatif de la hausse des droits de douane sur la croissance et le chômage. Mais l’orientation de la politique monétaire pourrait aussi être implicitement liée aux pressions exercées par Donald Trump sur Jerome Powell. Pendant la campagne présidentielle, Donald Trump n’avait d’ailleurs pas caché sa volonté d’influencer les décisions de politique monétaire remettant en cause l’indépendance de la Réserve fédérale. Jusqu’en septembre, Jerome Powell avait résisté à ces pressions, et le FOMC avait privilégie le statu quo. Mais le mandat de Jerome Powell arrive à son terme en mai 2026 et le choix du nouveau président de la Réserve fédérale donnera l’occasion à Donald Trump de renforcer son influence. Le choix devrait se porter sur Stephen Miran, nommé en septembre au sein du FOMC, en remplacement d’Adriana Kugler dont le mandat arrivait à terme en janvier mais qui a démissionné.
1 Pic atteint en juin 2022 avec le déflateur de la consommation qui est l’indicateur ciblé par la Réserve fédérale. Le pic était à 9% avec l’indice des prix à la consommation.
:::
Pour autant, les décisions de la Réserve fédérale sont prises par les 12 membres votants du FOMC2. La nomination d’une nouvelle personnalité au sein du FOMC ne permet donc pas d’en assurer le contrôle. La tentative de renvoi de Lisa Cook est sans doute un moyen supplémentaire utilisé par Donald Trump pour accroître son influence. Dans tous les cas, il sera intéressant de voir quelle sera l’attitude des autres membres à partir de mai prochain. En effet, lors de la réunion de septembre, seul Stephen Miran avait indiqué préférer une baisse de 0,5 point du taux. De même que l’ensemble des décisions de statu quo prises entre janvier et juillet l’ont été à l’unanimité. Il y a donc dans l’ensemble un large consensus au sein du comité sur une certaine prudence. Dans notre scénario nous supposons que la banque centrale américaine poursuivra un assouplissement modéré pour amortir l’impact des différents chocs sur la croissance et prendra donc peut être le risque de perdre en crédibilité si elle semble céder aux exigences de Donald Trump.
2 Les membres votants sont les 7 membres du Board, le Président de la Réserve fédérale de New York et 4 membres votants à tour de rôle parmi les 11 présidents des Réserve fédérale régionales
3 La BCE sereine ?
La BCE se trouve dans une position assez différente. Son action ne fait l’objet de critiques accrues et son indépendance n’est pas contestée, contrairement à celle de la Réserve fédérale depuis l’élection de Donald Trump. Surtout, la situation économique de la zone euro diffère de celle des Etats-Unis puisque l’inflation y est bien plus faible. Par ailleurs, la BCE a continué de baisser son taux directeur, fixé à 2% en juin 2025. La principale interrogation réside dans l’opportunité de poursuivre ou non l’assouplissement monétaire. Le risque inflationniste semble modéré. Les enquêtes auprès des professionnels suggèrent une inflation sous-jacente proche de 2% en 2026. Les risques à la baisse sur la croissance sont sans doute plus importants ce qui plaiderait pour une baisse supplémentaire en fin d’année 2026 avant une stabilisation du taux de politique monétaire.